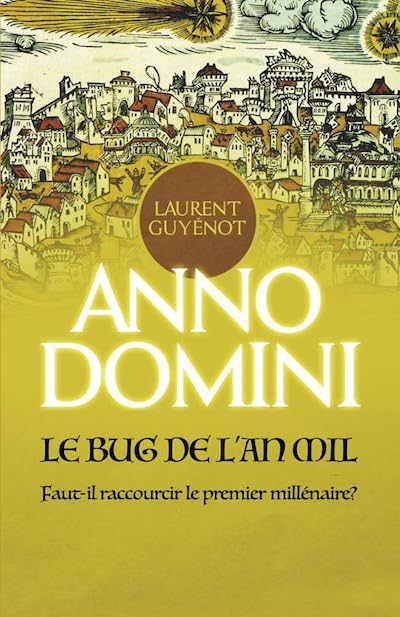Fiodor Dostoïevski a écrit que le catholicisme romain « a proclamé un Christ nouveau bien différent de l’ancien, un Christ qui se laisse séduire par la troisième tentation du démon : les royaumes de la terre ! » [1] C’est le principal reproche de l’orthodoxie au catholicisme romain. Il est légitime et on ne peut le contester sans mauvaise foi.
Contrairement au patriarche de Constantinople ou plus tard à celui de Moscou, qui ne revendiquent que le « glaive spirituel », le pape revendique également, durant le Moyen Âge, le « glaive temporel ». C’est pourquoi, non seulement il possède l’une des principautés les plus riches d’Italie, mais il prétend régner sur les rois et les empereurs (lire « Les racines médiévales de la désunion européenne »), et mobiliser leur classe militaire pour les envoyer coloniser la Palestine et, en 1204, conquérir et saccager Constantinople (lire « La Croisade est terminée »).
La fausse donation, péché originel de la papauté
Pour justifier leur projet de monarchie universelle, les papes ont employé une armée de légistes qui ont élaboré un nouveau droit canonique pour prévaloir sur le droit féodal et coutumier, tout en faisant apparaître leur nouveau système comme le plus ancien grâce à des contrefaçons.
La contrefaçon médiévale la plus célèbre est la « donation de Constantin ». Ce faux célèbre, fabriqué dans un scriptorium du pape entre 750 et 850, est inclus dans un recueil d’une centaine d’autres faux décrets et actes synodaux connus aujourd’hui sous le nom de décrétales pseudo-isidoriennes. Le but principal de ces faux décrets était d’inventer des précédents pour l’exercice de l’autorité souveraine de l’évêque de Rome sur l’Église universelle d’une part, et sur tous les souverains d’Europe d’autre part. Ces faux furent incorporés au XIIe siècle dans le Decretum de Gratien qui deviendra la base de tout le droit canonique.
La donation de Constantin est la pièce maîtresse de cette entreprise de falsification massive de l’histoire. Elle peut être considérée comme la Constitution qu’a donnée l’Église romaine à l’Europe pour en faire l’instrument du nouvel ordre mondial qu’elle ambitionnait. Ce mensonge d’une audace inouïe est, en quelque sorte, le péché originel d’un Occident qui se transformera, au fil des siècles, en un « Empire du mensonge » aux ambitions impériales sans limites.
Rappelons le contenu. Par ce document, l’empereur Constantin le Grand, reconnaissant d’avoir été guéri de la lèpre par l’eau du baptême, cède « à Sylvestre le pontife universel et à tous ses successeurs jusqu’à la fin du monde » tous les insignes impériaux – pallium, sceptre, diadème, tiare, manteau de pourpre, tunique écarlate –, c’est-à-dire la totalité de « la grandeur impériale et la gloire de notre puissance ». Constantin lui cède aussi « tant notre palais [du Latran] que la ville de Rome et toutes les provinces, localités et cités de l’Italie ou des régions occidentales ». Et pour bien manifester son renoncement à tout droit sur l’Occident, Constantin décide de se retirer en Orient. Sur cette base, les papes vont prétendre avoir reçu l’autorité impériale et le droit de la conférer à l’empereur de leur choix, ou de la lui retirer s’il s’en montre indigne. C’est en vertu de ce principe que Grégoire VII force l’empereur germanique Henri IV à s’humilier devant lui et reconnaître sa suzeraineté à Canossa en janvier 1077.
Ayant reçu de Constantin le pouvoir temporel sur tout l’Occident, les papes s’efforceront également de transformer tous les royaumes en fiefs, et leurs rois en vassaux. Alexandre II (1061-1073) accorde ainsi l’Angleterre à Guillaume de Normandie, qui, sous bannière papale, défait les Saxons rebelles à Rome. Plus tard Adrien IV (1154-1159) concède l’Irlande (également indomptée par Rome) comme « possession héréditaire » au petit-fils de Guillaume, le roi Henri II Plantagenêt, car « toutes les îles sont censées appartenir à l’Église romaine de droit ancien, selon la donation de Constantin, qui les a richement dotées » [2]. Lentement mais sûrement, de coup d’État en coup d’État, et grâce au rayon paralysant de l’excommunication, le pape est devenu le souverain le plus puissant d’Europe, damant le pion à l’Empereur en titre. Tout cela grâce à la fausse donation de Constantin.
Le faussaire ne s’est pas contenté d’affirmer que le pape détient la suprématie temporelle sur tout l’Occident. Il lui confère également la suprématie spirituelle sur le monde entier, c’est-à-dire, en pratique, sur toute la chrétienté orientale. Constantin le Grand aurait en effet décrété que l’évêque de Rome « gouvernera les quatre patriarcats, Alexandrie, Antioche, Jérusalem et Constantinople, ainsi que toutes les Églises de Dieu dans le monde entier. Et le pontife qui présidera actuellement aux destinées de la très sainte Église romaine sera le plus haut, le chef de tous les prêtres dans le monde entier, et toutes choses seront réglées selon ses décisions ». Là réside la grande trahison que dénoncent les orthodoxes, attachés au principe de la collégialité de l’Église (sobornost pour les Russes). La donation est, bien évidemment, la cause première de ce que nous appelons le schisme d’Orient, mais que les orthodoxes appellent le schisme d’Occident.

Lorsque cette Donation commença à être utilisée intensivement comme arme juridique, au XIe siècle, il y eut des contestations. En 1001, en réponse à une demande du pape Sylvestre II de « restituer » au Saint-Siège huit comtés d’Italie, l’empereur Otton III dénonce « l’incurie et l’incapacité » des pontifes, ainsi que « les mensonges forgés par eux-mêmes » rédigés « en lettres d’or » et placés « sous le nom du grand Constantin [3]. Au début du XIIIe siècle, Walther von der Vogelweide, un poète proche de Frédéric II, n’en conteste pas l’origine mais y voit un grand malheur, qui a inversé l’ordre naturel du monde et causé des souffrances infinies à l’Europe [4]. Frédéric II s’entoure de légistes pour la déclarer invalide. Mais Innocent IV répond que, tout pouvoir appartenant au Christ représenté sur terre par le pape, la donation n’est, de toute manière, qu’une « restitution ». Dans la seconde partie du XIVe siècle, tandis que les contestations se font plus nombreuses, le clerc Pierre Jame d’Aurillac déclare que la question de l’authenticité de la donation ne se pose pas, parce qu’à l’évidence elle est conforme à la volonté de Dieu [5].
Il fallut attendre le XVe siècle pour que commence à être reconnu le caractère frauduleux de la donation de Constantin, par une analyse critique assez simple qui aujourd’hui n’est plus remise en question (par exemple, comment Constantin peut-il évoquer le patriarcat de Constantinople qui n’existe pas encore ?). Et cependant, aucune excuse officielle ne fut jamais présentée par le Vatican pour cette ruse diabolique. En fait, rien ne changea en profondeur dans le discours et l’attitude de la papauté. Bien au contraire, dans une fuite en avant qui ressemble à l’acte désespéré d’un menteur démasqué, on verra Pie IX proclamer au concile de Vatican (1870) le dogme (rétroactif) de l’infaillibilité papale. On ne demande pas aux catholiques de reconnaître l’infaillibilité de Dieu, mais ils doivent reconnaître l’infaillibilité du pape.
Constantin le Grand Mystère
Constantin le Grand a servi de caution au projet théocratique des papes. Mais dans quelle mesure ? Ont-ils seulement fabriqué sa fausse donation, ou bien d’autres choses encore ? Quel crédit, en fait, doit-on accorder à sa biographie supposément écrite par Eusèbe de Césarée ? Les récents éditeurs académiques de cette Vita Constantini admettent qu’ « elle s’est avérée extrêmement controversée », certains chercheurs étant « très sceptiques ».
« En effet, l’intégrité d’Eusebius en tant qu’écrivain a souvent été attaquée et sa paternité de la VC [Vita Constantini] niée par des chercheurs questionnant la valeur des informations qu’elle fournit, la discussion se concentrant particulièrement sur les nombreux documents impériaux qui sont cités textuellement. » [6]
La Vita Constantini est censée avoir été écrite en grec, mais elle n’était connue jusqu’au XIIIe siècle que dans la traduction latine attribuée au légendaire saint Jérôme, tout comme l’Histoire ecclésiastique du même auteur (l’autobiographie de l’Église, en quelque sorte). En vérité, rien ne permet de garantir qu’elle a été écrite en Orient, et avant le VIIIe siècle. Il se peut qu’elle soit aussi fausse que la donation de Constantin.
Hors Eusèbe, il n’y a pas le moindre indice que Constantin était chrétien ou même favorable au christianisme. Deux panégyriques de Constantin ont été conservés et ils ne font aucune mention du christianisme. Au lieu de cela, l’un contient le récit d’une vision reçue par Constantin du dieu-soleil Apollon, « avec la victoire qui l’accompagnait », après quoi Constantin se plaça sous la protection de Sol Invictus.
Ce que (Pseudo)-Eusèbe rapporte dans sa Vie de Constantin est à l’évidence une réécriture chrétienne de cette légende païenne : en marchant sur Rome pour renverser Maxence, Constantin vit de ses propres yeux dans le ciel, en plein midi, une croix surgissant de la lumière du soleil, portant le message, « par ce signe, tu vaincras ». La nuit suivante, le Christ lui apparut en rêve pour confirmer la vision. Constantin fit peindre le signe sur les boucliers de tous ses soldats et remporta la bataille du pont Milvius. C’est ainsi que, si l’on en croit cette histoire, le Christ serait devenu un dieu militaire.
L’auteur nous jure ses grands dieux qu’il a entendu cette histoire de la bouche même de Constantin :
« Pendant qu’il faisait cette prière, il eut une merveilleuse vision, et qui paraîtrait peut-être incroyable, si elle était rapportée par un autre. Mais personne ne doit faire difficulté de la croire, puisque ce Prince me l’a racontée lui-même longtemps depuis, lorsque j’ai eu l’honneur d’entrer dans ses bonnes grâces, et que l’événement en a confirmé la vérité. » (I,28)
Sont-ce là les paroles d’un bon biographe, ou d’un mauvais menteur ? Le mensonge, en l’occurrence, est prouvé. L’arc de triomphe que Constantin fit bâtir à Rome pour commémorer sa victoire sur Maxence contient de nombreux représentations de divinités païennes, en particulier du dieu solaire Apollon, mais pas une seule petite référence au Christ qui, nous dit Eusèbe, lui aurait procuré la victoire.
Eusèbe décrit ainsi l’étendard militaire que fit faire Constantin (aujourd’hui appelé le labarum) :
« J’ai vu l’étendard que les orfèvres firent par l’ordre de ce Prince, et il m’est aisé d’en décrire ici la figure. C’est comme une lance, couverte de lames d’or, qui a un travers qui fait la croix. Il y a en haut de la pique une couronne enrichie d’or et de pierreries. Le nom de notre Sauveur est marqué sur cette couronne par les deux premières lettres ; dont la seconde est un peu coupée. Les empereurs ont porté depuis ces deux mêmes lettres sur leur casque. » (I,31)
Ce « chrisme » ou « christogramme », constitué par les lettres grecques Chi (X) et Rho (P) entrecroisées, est aujourd’hui le blason de la papauté. Or l’archéologie et la numismatique ont prouvé qu’il est beaucoup plus ancien que le christianisme. On le trouve par exemple sur un drachme de Ptolémée III Évergète (246-222 av. J.-C.). Il apparaît même sur une monnaie de Maxence, que Constantin aurait vaincu précisément par ce signe [7]. Il est clair que le Chi-Rho était un symbole impérial pré-chrétien.

Mais sa signification originelle reste mystérieuse. Constatant qu’il est généralement entouré d’une tresse végétale, on a supposé que le symbole faisait référence à un principe cosmique associé à la résurrection (anastasis) de la Nature. Certains y voient un talisman emprunté au culte de Mithra, qui s’était généralisé dans la noblesse romaine. Les analogies entre Mithra et Jésus sont si nombreuses que Justin et Tertullien accusaient Mithra d’imitatio diabolica. On sait aussi que plusieurs églises italiennes, dont la basilique Saint-Pierre, ont été construites sur des cryptes mithriaques [8]. Notez sur ce frontispices de la basilique Saint-Pierre, que le P se trouve devant sur le X, suggérant un mot commençant par P. Se pourrait-il que ce soit en fait une contraction du mot latin PAX ? L’hypothèse n’est pas très satisfaisante, parce que le chrisme est souvent accompagné des lettres α et ω.

L’important est ceci : nous n’avons par la moindre confirmation archéologique d’un quelconque intérêt de Constantin pour le christianisme. Et nous avons de sérieuses raisons de croire qu’Eusèbe ment. On sait que Constantin se fit représenter en dieu solaire Apollon à Rome aussi bien qu’à Constantinople, où se tenait une colonne de porphyre de trente mètres surmontée par une statue du dieu avec le visage de Constantin portant une couronne solaire irradiante [9]. On note que la fête de Sol Invictus était célébrée le 25 décembre et que la première référence au 25 décembre comme date de naissance du Christ se trouve dans la Depositio Martyrum datée de 354, soit longtemps après la mort de Constantin. Ce n’est qu’en 380 que l’empereur Théodose Ier interdit définitivement le culte de Sol Invictus, pour faire du 25 décembre une fête exclusivement chrétienne. C’est un indice fort que le christianisme a détourné des rites et des symboles du culte de Sol Invictus dont Constantin avait voulu faire la religion de l’Empire.
On admet qu’il y eut un changement de politique religieuse entre Constantin et Théodose. Mais le changement était peut-être beaucoup plus profond qu’on ne le croit. Le culte de Sol Invictus a été remplacé par le culte du messie Jésus. Le remplacement n’a pu se faire qu’en réécrivant l’histoire. Théodose devait affirmer sa continuité avec Constantin, tout en rompant avec son héritage ; il a chargé pseudo-Eusèbe (qui est aussi probablement pseudo-Jérôme) d’écrire l’histoire officielle de l’Église.
Signalons encore un autre aspect problématique de la foi chrétienne de Constantin. On nous a appris que Constantin aurait convoqué et présidé le premier concile de Nicée en 325, et obligé tous les évêques présents à signer la profession de foi élaborée à l’occasion contre la doctrine d’Arius. Mais Constantin aurait par la suite favorisé l’arianisme et aurait été baptisé dans cette « hérésie » par son parent Eusèbe de Nicomédie, alors patriarche de Constantinople. Son fils Constance II aurait suivi la même voie. Est-il concevable qu’un empereur désavoue ainsi sa propre politique religieuse, détruisant du même coup l’unité de l’Église qu’il venait péniblement d’obtenir ? L’arianisme est lui-même un grand mystère ; il n’a laissé aucun vestige matériel, même en Espagne où il est supposé avoir été la religion de la classe dominante pendant trois siècles. C’est une source de perplexité pour des chercheurs comme Ralf Bockmann (« The Non-Archaeology of Arianism », 2014) ou Alexandra Chavarria Arnau (« Finding invisible Arians », 2017) [10].
René Guénon a rappelé « l’obscurité presque impénétrable qui entoure tout ce qui se rapporte aux origines et aux premiers temps du Christianisme, obscurité telle que, si l’on y réfléchit bien, elle paraît ne pas pouvoir être simplement accidentelle et avoir été expressément voulue » [11]. Il y a tant d’incohérences dans les cinq premiers siècles de l’histoire du christianisme. Certaines sont occasionnellement reconnues par des universitaires peu soupçonneux. Voici, par exemple, une remarque de l’éditeur de la Consolation de la philosophie de Boèce (vers 524) :
« Ce qu’on remarque surtout dans les ouvrages de Boèce, dans ceux, du moins, qui sont authentiques, c’est l’absence de toute allusion, si lointaine qu’on la suppose, à la religion chrétienne. À n’en juger que par ses écrits, on pourrait croire que cette religion était de la veille seulement apparue sur la terre et que l’enseignement de sa morale et de ses dogmes était encore confiné au fond des ergastules et des catacombes. » [12]
Boèce a écrit la Consolatio en attendant la mort en prison. Il est considéré comme un saint et un martyr chrétien. Est-ce crédible ?
Comment déplace-t-on un empire ?
La Vita Constantini est probablement contemporaine de la déclaration de Constantin, et aussi fausse qu’elle. Elle reproduit et élabore les grands thèmes de la donation de Constantin, à commencer par le déplacement de la capitale de l’Empire romain de Rome à Byzance, pour laisser au pape l’imperium sur tout l’Occident.
Cette notion de translatio imperii est saturée de contradictions. Premièrement, Constantin n’a pas déplacé sa capitale vers l’Est, puisqu’il était lui-même originaire de Moésie, dans les Balkans. On admet que Constantin n’avait jamais mis les pieds à Rome avant de la conquérir sur Maxence. Constantin n’était pas un Italien accidentellement né en Moésie : son père Constance était également originaire de Moésie, tout comme son collègue et rival Licinius, et tout comme son prédécesseur Dioclétien, dont le palais se situe à Split, aujourd’hui en Croatie, et qui vécut principalement plus à l’est encore, à Nicomédie, sur la rive orientale du Bosphore. Et l’origine orientale des empereurs n’était pas nouvelle. Comme l’écrit Warwick Ball dans Rome in the East : « À l’époque de l’expansion maximale de Rome, des empereurs originaires d’Orient commençaient à la gouverner : les empereurs Caracalla et Geta étaient à moitié puniques et à moitié syriens, tandis qu’Elagabalus, Sévère Alexandre et Philippe l’Arabe étaient entièrement syriens. » [13] Dans ces conditions, que reste-t-il de « romain » à Rome ?
Deuxièmement, Constantin n’a pas pu déplacer la capitale impériale de Rome à Byzance, car Rome avait déjà cessé d’être la capitale impériale, ayant été remplacée par Milan en 286. Sous Dioclétien, toute l’Italie était tombée dans l’anarchie pendant la « crise du troisième siècle » (235-284), et Rome était déjà « une ville morte » [14].
Peut-on vraiment, d’ailleurs, croire au transfert d’une capitale impériale à plus de mille kilomètres de distance, avec sa noblesse sénatoriale et son administration, entraînant la métamorphose d’un empire romain en un autre empire romain ayant une structure politique, une langue, une culture et une religion totalement différentes ? Et dans quel but ? Ferdinand Lot, grand spécialiste de l’Antiquité tardive, s’est longuement posé la question et conclut que « la fondation de Constantinople est une énigme politique ». Dans un effort désespéré pour lui donner sens, il conclut que « Constantinople est née du caprice d’un despote en proie à une intense exaltation religieuse », et que, par cette « folie politique », « Constantin a cru régénérer l’Empire romain, [mais que], sans s’en douter, il a fondé l’Empire si justement appelé “byzantin” » [15].
Voilà qui est tiré par les cheveux. Il faut constater ici l’échec de l’historiographie académique de rendre crédible un récit qui doit plutôt être analysé comme un élément de propagande produit par les mêmes cerveaux que la donation de Constantin. Ce paradigme de la translatio imperii n’est peut-être qu’une légende inventée pour masquer le mouvement opposé et bien réel de la translatio studii, le transfert vers l’Occident de la culture grecque préservée et enrichie par Byzance, qui commence avant les croisades et culmine en pillage systématique au XIIIe siècle (lire « Le révisionnisme byzantin d’Anthony Kaldellis »).
Bizarreries spatio-temporelles
Lorsqu’on commence à se poser des questions sur Constantin et sur la relation entre les deux empires romains, des étrangetés chronologiques apparaissent, et elles finissent par atteindre une masse critique qui fait s’effondrer sous vos pieds tout ce que vous avez cru savoir sur Rome.
Ce narratif est fondé sur des sources dont la traçabilité avant le XIe siècle est impossible, et dont un bon nombre n’apparaît pas avant le XIVe ou le XVe siècle. Plusieurs savants philologues prétendent par exemple avoir démontré que les œuvres de Tacite, découvertes au XVe siècle par Poggio Bracciolini (1380-1459), « trahissent la plume d’un humaniste du XVe siècle » (Polydor Hochart) [16].
Le narratif est contredit par l’architecture. « Où est la Rome du Moyen Âge, demandait l’historien James Bryce, la Rome où les pèlerins affluaient, d’où venaient les commandements qui faisaient s’incliner les rois ? [...] À cette question, il n’y a pas de réponse. Rome, la mère des arts, n’a guère de bâtiment pour commémorer cette époque. » [17] En vérité, il y a peut-être une réponse : ce trou noir du Moyen Âge est une illusion. Ce que nous prenons pour les constructions antiques de Rome sont des constructions médiévales, et parfois même de la fin du Moyen Âge.
On a toujours su que l’Antiquité romaine était, dans une certaine mesure, un fantôme conjuré par les hommes qui ont produit sa « Renaissance ». Mais dans quelle mesure, exactement ? Considérons le fait qu’en 1144 fut fondée la « Commune de Rome », avec celle de Pise en 1085, Milan en 1097, Gène en 1099, Florence en 1100. Rome utilisait l’acronyme SPQR sur ses bâtiments et ses pièces. Quarante-deux autres villes médiévales italiennes utilisaient l’acronyme SPQ suivi de l’initiale du nom de la ville, comme SPQP pour Pise, SPQT pour Tusculum ou SPQL pour Lucera, etc. [18] En 1362, le poète romain Antonio Pucci expliquait dans son Livre d’histoires diverses, que SPQR signifiait, en italien : Sanato Popolo Qumune Romano, soit « Le Sénat et le peuple de la commune de Rome » [19]. Comment concilier ces faits avec la théorie que SPQR remonte à la République romaine fondée en 509 avant notre ère et veut dire Senatus Populusque Romanus ? Certes, on doit tenir compte du fait que SPQR apparaît sur l’arc de Septime Sévère, sur l’arc de Trajan, et sur l’arc de Titus. Mais comment être sûr de la date de construction de ces arcs de triomphe [20] ? On peut donc lire avec une certaine perplexité ce qu’écrit Robert Folz sur la Commune de Rome :
« Dans un milieu où le passé était l’objet d’un engouement aussi grand qu’à Rome, une tentative de création nouvelle devait prendre forcément l’aspect d’une restauration du passé : le conseil de la commune s’appela sénat, l’ère sénatoriale fut employée dans la datation des actes, tandis que reparaissait aussi le signe SPQR. Tout se passa donc comme si l’on revenait à la tradition de la Rome républicaine. » [21]
Ou, selon une autre manière de voir les choses : tout se passa comme si ceux qui disaient revenir à la Rome républicaine la faisaient en réalité surgir de leur imagination. C’était une pratique courante, dans un monde ou antiquité signifiait prestige, et prestige signifiait pouvoir. Par exemple, lorsque les villes de Reims et de Trèves se disputaient l’honneur de couronner l’empereur Otton le Grand, Reims prétendit avoir été fondée par Remus après qu’il fut expulsé de Rome par son frère Romulus ; Trèves répondit en affirmant avoir été fondée par Trebeta, fils de Ninus et contemporain d’Abraham. Dans cette rivalité mimétique, chacune de ces deux villes produisit des documents pour soutenir ses prétentions fantaisistes [22]. Certains patriotes romains de la fin du Moyen Âge avaient le mobile et les moyens de fabriquer la Rome républicaine antique. Pétrarque (1304-1374), qui a « découvert » Cicéron et est aussitôt devenu cicéronien dans le fond et dans la forme, était la figure de prou d’un mouvement visant a faire revenir la papauté à Rome ; « son intention, on l’oublie trop volontiers ou on le néglige, était délibérément politique », écrit le médiéviste Jacques Heers. Il était « un des écrivains les plus virulents de son temps, engagé dans une grande querelle contre la papauté d’Avignon, et cet acharnement à combattre commandait ses options tant politiques que culturelles » [23].
Ce sont là des hypothèses hardies. Je les explore dans mon livre Anno Domini. Le bug de l’an mil. J’entends les objections et j’en tiens compte. C’est une recherche inaboutie, et il y a plus de questions que de réponses. Mais s’il y a une chose que nous avons apprise ces dernières années, c’est que l’histoire officielle est, bien souvent, un récit mensonger, et parfois une inversion totale de la vérité.
Une conclusion me semble bien assurée : l’Empire du mensonge ne date pas d’hier. La fausse donation de Constantin et la fausse biographie de Constantin en sont le péché originel.
Disponible chez Kontre Kulture !













 et
et  !
!