« Nous sommes des machines à survie, des robots aveuglément programmés pour préserver ces molécules égoïstes que l’on appelle des gènes. » Ainsi s’exprime Richard Dawkins dans Le Gène égoïste [1]. Comme il le constatait en 1989, sa théorie « est devenue l’orthodoxie des manuels scolaires », car elle est simplement « une conséquence logique du néodarwinisme orthodoxe, mais exprimée comme une image nouvelle ».
L’image est trompeuse. Dawkins ne croit pas littéralement que les gènes sont des entités égoïstes animées par une volonté de se répliquer. S’ils l’étaient, ils seraient comme des sortes d’âmes transgénérationnelles. Dans le modèle néodarwinien, les gènes ne sont pas des âmes, mais simplement des molécules régies par les lois déterministes de la chimie. Et ils sont le résultat d’une série d’accidents chimiques sur des millions d’années, à partir de la première protéine capable de s’autorépliquer.
J’ai déjà écrit pour E&R deux articles critiques sur le darwinisme : « Généalogie du darwinisme » et « Le singe devenu dieu » (où je montrais le lien logique entre darwinisme et transhumanisme). Je vais ici prolonger cette critique, présenter brièvement l’alternative, en particulier la théorie de Rupert Sheldrake, et conclure par une réflexion « métagénétique » pour sortir du paradigme individualiste. Je voudrais ainsi apporter une modeste contribution au débat passionnant entre Alain Soral, Xavier Poussard et Lucien Cerise animé par Monsieur K, en rappelant que l’essence du vivant est le génétique, et que, pour l’être humain, le génétique, ou le générationnel, est la substance organique du politique.
La catastrophe darwinienne
Nietzsche l’avait prédit dans la seconde de ses Considérations inactuelles : le darwinisme est un poison civilisationnel.
« [Si de telles idées], avec la folie de l’enseignement qui règne aujourd’hui, sont jetées au peuple pendant une génération encore, personne ne devra s’étonner si le peuple périt d’égoïsme et de mesquinerie, ossifié dans l’unique préoccupation de lui-même. Il commencera par s’effriter et par cesser d’être un peuple. À sa place, nous verrons peut-être apparaître, sur la scène de l’avenir, un enchevêtrement d’égoïsmes individuels, de fraternisations en vue de l’exploitation rapace de ceux qui ne sont pas des "frères", et d’autres créations semblables de l’utilitarisme commun. »
Bien qu’il disait tenir la théorie de Darwin « pour vraie, mais pour mortelle », Nietzsche en critiqua la nature mécanique, qui néglige la « volonté de puissance » inhérente à la vie, dont il avait appris l’importance chez son maître Arthur Schopenhauer. Dans sa préface à la seconde édition de La Volonté dans la nature (1836), soit cinq ans avant la parution de L’Origine des espèces, Schopenhauer avait mis en garde contre :
« le zèle et l’activité incomparables affichés dans toutes les branches des sciences naturelles qui, comme cette recherche est principalement entre les mains de gens qui n’ont rien appris d’autre, menace de conduire à un matérialisme grossier et stupide, dont le côté le plus immédiatement offensant est moins la bestialité morale de ses résultats ultimes, que l’incroyable absurdité de ses premiers principes ; car de cette manière, même la force vitale est niée, et la nature organique est dégradée en un simple jeu de hasard des forces chimiques. »
Pour mesurer où nous a conduit cette conception mécanique de la vie, un bon indicateur est le succès planétaire de la dernière star darwinienne Yuval Noah Harari. Ses livres se sont vendus à près de 30 millions d’exemplaires en 60 langues. Dans Sapiens (2015, publié initialement en hébreu), il enfonce le clou de la morale darwinienne : « La vie n’a pas de scénario, pas d’auteur, pas de metteur en scène, pas de producteur – et pas de sens. » Puis dans Homo Deus (2017), il nous apporte la bonne nouvelle transhumaniste, l’autodéification de l’Homme par le miracle de la haute technologie : « ayant sorti l’humanité de la brutalité des luttes pour la survie, nous allons chercher à hisser les hommes au rang de dieux, à transformer Homo sapiens en Homo deus. »
« les bio-ingénieurs vont [...] se saisir du vieux corps de Sapiens et en réécrire délibérément le code génétique, recâbler ses circuits cérébraux, modifier son équilibre biochimique, voire lui faire pousser des membres nouveaux. [...] Le génie cyborg ira plus loin, et fusionnera le corps organique avec des appareils non organiques, tels que des mains bioniques, des yeux artificiels ou des millions de nanorobots qui navigueront dans nos vaisseaux sanguins, diagnostiqueront les problèmes et répareront les dommages. »

Désormais, la « machine-robot » de Dawkins peut commencer à se transformer en un immortel zombie électronique. Un tel fantasme d’immortalité physique et d’omnipotence est risible à notre époque de covidophobie aiguë, mais il y a un lien très étroit : il s’agit toujours d’enfoncer dans le crâne des masses ahuries que le but de la vie est d’éviter la mort (la mort physique individuelle, s’entend).
La conception mécanique du vivant
La maladie mentale qui conduit l’Homme à se prendre pour une machine a été inoculée aux Européens par le Français René Descartes (1596-1650). Descartes était fasciné depuis son enfance par les nouvelles machines de son époque. Comme tout homme intelligent et instruit, il était aussi impressionné par les descriptions mécaniques du Système solaire faites par Kepler et Galilée. Il voulut donc étendre ce modèle au monde vivant. « Mon but, écrivait Kepler en 1605, est de montrer que la machine céleste ne doit pas être comparée à un organisme divin mais plutôt à une horloge. » L’analogie de l’horloge convenait aux êtres célestes, dont les mouvements réguliers avaient fourni à l’Homme ses mesures du temps. La découverte que les mouvements des planètes pouvaient être conceptualisés en termes purement mathématiques conduirait à la théorie révolutionnaire de la gravitation d’Isaac Newton. En revanche, la théorie de Descartes sur la machine animale n’a conduit à aucun progrès en biologie. En vivisectant des chiens, il a observé que le cœur fonctionnait comme une pompe, mais on le savait déjà.
Selon la tradition platonicienne et aristotélicienne, adoptée par Thomas d’Aquin, les êtres vivants différaient essentiellement de la matière inanimée par leur principe vital, leur anima. Mais voyant « l’organisme cosmique » désormais privé de son anima mundi et converti en mécanisme, Descartes a voulu se débarrasser de l’anima aussi chez les animaux, et prouver que les organismes biologiques eux-mêmes étaient en réalité des mécanismes biologiques. Il fut assez prudent pour faire une exception pour l’Homme, à qui il accordait une âme rationnelle logée dans la glande pinéale.
La théorie cartésienne, c’est-à-dire mécanique, de la vie eut un succès limité et a été constamment combattue par une école de pensée qu’on a appelée « vitalisme » au XIXe siècle. Les vitalistes affirment que les phénomènes de la vie ne peuvent pas être entièrement expliqués par des lois mécaniques ou chimiques dérivées de l’étude des systèmes inanimés, et que les processus de morphogenèse et de reproduction nécessitent un facteur causal irréductible à ces lois. Les vitalistes ont été parmi les premiers à théoriser l’évolution des espèces, qui pourrait s’expliquer si « l’élan vital » (Henri Bergson, L’Évolution créatrice, 1907) inclut une sorte de « volonté d’évoluer » à la Schopenhauer. Bergson écrit :
« Plus on fixe son attention sur cette continuité de la vie, plus on voit l’évolution organique se rapprocher de celle d’une conscience, où le passé presse contre le présent et en fait jaillir une forme nouvelle, incommensurable avec ses antécédents. »
En 1802, Jean-Baptiste de Lamarck pensa vaincre le vitalisme avec sa doctrine du transformisme, qui expliquait comment les espèces évoluaient les unes à partir des autres par héritage des caractères acquis. Darwin proposa ensuite un mécanisme d’évolution différent (« descente avec modification »), sans nier le facteur lamarckien (ce que fera son disciple zélé August Weismann).
Le darwinisme marque le triomphe de la théorie mécanique de la vie. Mais il a en outre l’avantage de rendre inutile l’« hypothèse Dieu » : les machines nécessitent normalement un concepteur (Newton imaginait Dieu « très doué en mécanique et en géométrie »), mais les organismes n’en ont pas besoin s’ils ont évolué progressivement par variation et sélection naturelle. Seuls « le hasard et la nécessité » (Jacques Monod, 1970) ont créé toutes les formes de vie, de la bactérie à l’Homme.
Avec la redécouverte des lois de l’hérédité de Mendel, le darwinisme a évolué vers ce que Julian Huxley a appelé la « synthèse moderne » (rebaptisée plus tard néodarwinisme). Dans les années 1930, grâce au microscope électronique, la quête de l’explication de la vie passe du niveau cellulaire au niveau moléculaire. La biologie s’efforce de devenir une branche de la chimie. Francis Crick, qui partagea le prix Nobel pour la découverte de la structure de l’ADN, a rendu ce programme très explicite dans son livre Of Molecules and Men (1966) : « Le but ultime de la modernité en biologie est en fait d’expliquer tous les phénomènes biologiques en termes physico-chimiques. » [2]
Paradoxalement, c’est l’accent mis sur le niveau moléculaire qui a dévoilé la complexité époustouflante du vivant, laquelle pose aujourd’hui un défi gigantesque au modèle simpliste de l’évolution darwinienne par mutations accidentelles et sélection naturelle.
Le dessein intelligent
Michael Behe est un biochimiste de premier plan qui défend l’hypothèse du « dessein intelligent » (Intelligent Design). Il explique dans son livre Darwin’s Black Box :
« La biochimie a démontré que tout appareil biologique impliquant plus d’une cellule (comme un organe ou un tissu) est nécessairement un réseau complexe de nombreux systèmes identifiables différents, d’une complexité effroyable. La cellule de réplication autosuffisante "la plus simple" a la capacité de produire des milliers de protéines différentes, et d’autres molécules, à des moments différents et dans des conditions variables. Synthèse, dégradation, génération d’énergie, réplication, maintenance de l’architecture cellulaire, mobilité, régulation, réparation, communication : toutes ces fonctions ont lieu dans pratiquement chaque cellule, et chaque fonction elle-même nécessite l’interaction de nombreuses parties. » [3]
Une telle complexité peut-elle être le résultat d’une série d’erreurs accidentelles dans la réplication des gènes ? Il est important de comprendre en effet que, selon Darwin, le seul processus créatif dans l’évolution réside dans « des variations produites accidentellement ». La sélection naturelle ne crée rien ; elle n’agit que négativement en éliminant les variations désavantageuses. Elle n’est pour rien dans l’apparition des variations avantageuses, qui est le résultat d’accidents dans la réplication de l’ADN.
Puisque les tenants du « dessein intelligent » soutiennent que la complexité de la vie, qui devient de plus en plus grande avec chaque nouvelle découverte, est la preuve la plus convaincante de l’existence de Dieu – ou de l’Esprit –, les scientifiques déicides sont entrés en mode croisade contre ces hérétiques. D’où la campagne agressive pour interdire les professeurs d’université favorables à l’Intelligent Design, bien documentée dans le film Expelled : No Intelligent Allowed (à voir en français ici sur Égalité et Réconciliation). Il y a maintenant une sélection darwinienne dans le milieu universitaire pour éliminer les scientifiques non darwiniens. J’en ai fait moi-même l’expérience à un faible niveau, lorsque, muni de mon doctorat en « Études médiévales anglaises », j’ai postulé en 2010 pour un poste d’assistant à l’université ; après m’avoir dit que je correspondais exactement au profil recherché, on m’a soudain claqué la porte au nez pour la raison – qui m’a clairement été signifiée – que j’avais traduit, édité et préfacé le livre de Phillip Johnson, Le Darwinisme en question. Science ou métaphysique ?
Stephen Meyer, qui défend également la théorie du dessein intelligent dans son livre Darwin’s Doubt, écrit :
« Les entités qui confèrent des avantages fonctionnels aux organismes – de nouveaux gènes et les protéines qu’ils codent – constituent de longues chaînes linéaires de sous-unités séquencées avec précision, des bases nucléotidiques dans le cas des gènes et des acides aminés dans le cas des protéines. Pourtant, selon la théorie néodarwinienne, ces entités complexes et hautement spécifiées doivent d’abord apparaître et fournir un certain avantage avant que la sélection naturelle puisse agir pour les préserver. Étant donné le nombre de bases présentes dans les gènes et les acides aminés présents dans les protéines fonctionnelles, un grand nombre de changements dans la disposition de ces sous-unités moléculaires devraient se produire avant qu’une nouvelle protéine fonctionnelle et sélectionnable puisse apparaître. Pour que même la plus petite unité d’innovation fonctionnelle – une nouvelle protéine – se produise, de nombreux réarrangements improbables des bases nucléotidiques devraient se produire avant que la sélection naturelle n’ait quelque chose de nouveau et d’avantageux à sélectionner. » [4]
Meyer souligne que la révolution de la biochimie a conduit à la prise de conscience que la vie n’est pas fondamentalement une question de matière ; c’est une question d’information. Et l’information ne peut être produite que par une intelligence. L’ADN « code » des informations, qui peuvent être « transcrites » en molécules d’ARN, puis « traduites » en une séquence d’acides aminés au fur et à mesure que des molécules de protéines sont synthétisées. « Depuis que la révolution de la biologie moléculaire a mis en évidence la primauté de l’information sur le maintien et la fonction des systèmes vivants, les questions sur l’origine de l’information sont passées au premier plan des discussions sur la théorie de l’évolution. » [5] Des changements aléatoires ou accidentels dans toute séquence contenant des informations ne font que dégrader les informations et ne peuvent en aucun cas ajouter de nouvelles informations. C’est pourquoi le défi majeur du darwinisme est venu des mathématiciens : en 1966, un groupe distingué de mathématiciens, d’ingénieurs et de scientifiques s’est réuni pour un colloque à l’Institut Wistar de Philadelphie intitulé « Les défis mathématiques de l’interprétation néodarwinienne de l’évolution ». [6]
La Résonance Morphique
Pour Stephen Meyer, « la découverte d’informations numériques même dans les cellules vivantes les plus simples indique l’activité préalable d’une intelligence créatrice à l’œuvre à l’origine de la première vie ». Mais cette « intelligence créatrice » ne doit pas nécessairement être conçue comme un Dieu exclusivement transcendant, extérieur à sa création. En d’autres termes, le paradigme du dessein intelligent ne doit pas être réduit à une version moderne de l’horloger (en l’occurrence le concepteur d’ordinateurs), qui crée de temps en temps de nouveaux modèles. Il est également possible de suivre une ligne de pensée plus panthéiste ou animiste et de supposer que l’intelligence est inhérente à la vie elle-même. Des documentaires sur « l’intelligence des plantes » peuvent nous aider à le concevoir (ici ou ici, vidéos en anglais non sous-titrées).
Il existe, en fait, un foisonnement de théories tentant de dépasser ou abandonner le darwinisme sans pour autant se satisfaire du « dessein intelligent ». Un site leur est consacré : www.thethirdwayofevolution.com. Certains des savants cités s’intéressent aux processus épigénétiques, d’autres explorent les mécanismes holistiques de la vie (comme Denis Noble, auteur de La Musique de la vie. La biologie au-delà du génome). Est mentionné dans ce site le professeur Didier Raoult, auteur en 2010 de Dépasser Darwin.
Mais je voudrais ici présenter, pour ceux qui ne le connaissent pas, le biologiste de Cambridge Rupert Sheldrake, connu pour sa théorie des « champs morphogénétiques ». Il n’a pas inventé cette notion et en attribue le crédit à Hans Spemann, Alexander Gurwitsch et Paul Weiss, qui, au début des années 1920, ont proposé que la morphogenèse soit organisée par champs « développementaux », « embryonnaires » ou « morphogénétiques ». Ces champs organisent le développement de l’embryon et guident les processus de régulation et de régénération après dommages. Sheldrake écrit dans The Presence of the Past (traduit en français sous le titre La Mémoire de l’Univers, Éditions du Rocher, 2002) :
« La nature spécifique des champs, selon Weiss, signifie que chaque espèce d’organisme a son propre champ morphogénétique, bien que les champs d’espèces apparentées puissent être similaires. De plus, au sein de l’organisme, il existe des champs subsidiaires dans le champ global de l’organisme, en fait une hiérarchie imbriquée de champs dans les champs. » [7]
La notion de champs, initialement introduite pour expliquer le magnétisme, puis la gravitation, tend aujourd’hui à s’imposer dans tous les domaines de la physique, comme l’explique le physicien David Tong dans cette conférence (en anglais, non sous-titrée en français) à Cambridge. D’une certaine manière, cette notion réconcilie la pensée scientifique avec l’idéalisme platonicien. Werner Heisenberg, l’un des fondateurs de la mécanique quantique, a déclaré :
« Je pense que la physique moderne a tranché en faveur de Platon. Car les plus petites unités de matière ne sont pas des objets physiques au sens ordinaire du terme, mais des formes, des idées qui ne sauraient être exprimées de manière claire qu’en langage mathématique. » [8]
Penser en termes de champs est nécessaire en biologie, soutient Sheldrake, parce que l’information génétique ne peut pas être localisée uniquement dans les gènes. Sheldrake écrit dans Morphic Resonance : The Nature of Formative Causation (Une nouvelle science de la vie : l’hypothèse de la causalité formative, Éditions du Rocher, 2003) :
« Le concept de programmes génétiques est basé sur une analogie avec les programmes informatiques. La métaphore implique que l’œuf fécondé contient un programme prédéterminé qui coordonne en quelque sorte le développement de l’organisme. Mais le programme génétique doit impliquer quelque chose de plus que la structure chimique de l’ADN, car des copies identiques d’ADN sont transmises à toutes les cellules ; si toutes les cellules étaient programmées de la même manière, elles ne pourraient pas se développer différemment. » [9]
Une partie de l’information qui « donne forme » à l’organisme n’est donc pas matériellement codée ; elle est contenue dans les champs morphogénétiques et non dans l’ADN. Sheldrake utilise une métaphore simple qui rend l’idée facile à comprendre :
« Considérez l’analogie suivante. La musique qui sort du haut-parleur d’un poste radio dépend à la fois : 1) des structures matérielles du poste et de l’énergie qui l’alimente et 2) de la transmission sur laquelle le poste est réglé. La musique peut bien sûr être affectée par des changements dans le câblage, les transistors, les condensateurs, etc., et elle s’arrête lorsque les piles sont retirées. Quelqu’un ne sachant rien de la transmission de vibrations invisibles, immatérielles et inaudibles à travers le champ électromagnétique pourrait conclure que la musique pourrait être entièrement expliquée en termes de composants de la radio, de la manière dont ils étaient disposés et de l’énergie dont leur fonctionnement dépendait. S’il envisageait la possibilité que quelque chose vienne de l’extérieur, il la rejetterait en découvrant que l’appareil pesait le même poids allumé et éteint. Il devrait donc supposer que les schémas rythmiques et harmoniques de la musique sont apparus dans l’appareil à la suite d’interactions extrêmement compliquées entre ses parties. Après une étude et une analyse minutieuses de l’ensemble, il pourrait même être en mesure d’en faire une réplique qui produirait exactement les mêmes sons que l’original, et il considérerait probablement ce résultat comme une preuve frappante de sa théorie. Mais malgré son exploit, il resterait complètement ignorant du fait qu’en réalité la musique provenait d’un studio de radiodiffusion à des centaines de kilomètres de là. » [10]
Sur la notion de champs morphogénétiques, Sheldrake construit celle de « résonance morphique ». Puisque les champs morphogénétiques contiennent une mémoire inhérente, cette mémoire n’est pas immuable, mais est influencée par rétroaction. En d’autres termes, tous les organismes (ou organes, ou cellules) animés par un certain champ entrent en résonance les uns avec les autres, et cette résonance constitue le champ lui-même.
« La résonance morphique a lieu sur la base de la similitude. Plus un organisme est similaire aux organismes précédents, plus leur influence sur lui par résonance morphique est grande. Et plus il y a eu de tels organismes, plus leur influence cumulative est puissante. » [11]
C’est ce que Sheldrake appelle aussi la « causalité formative » : « selon l’hypothèse de la causalité formative, la forme d’un système dépend de l’influence morphique cumulative des systèmes similaires précédents » ; « Les champs morphiques ne sont pas définis avec précision mais sont des structures de probabilité qui dépendent de la distribution statistique de formes similaires précédentes. » [12] Cela n’explique toujours pas l’apparition de nouvelles espèces. À mon sens, la théorie de Sheldrake n’exclut pas, bien au contraire, l’hypothèse d’une Intelligence créatrice suprême, qui serait comme le cœur nucléaire du Champ morphique universel, ce dernier étant assimilable au Logos ou à la Sophia des néoplatoniciens.
L’âme génétique
Je connais la théorie de Sheldrake depuis une vingtaine d’années, et elle n’a cessé d’accompagner ma réflexion depuis. J’y ai repensé récemment en lisant de nombreux articles américains par des auteurs réagissant à l’agression culturelle sans précédent contre la « race blanche » ou la « civilisation blanche ». Nombre de ces auteurs formulent leur défense de la civilisation blanche selon le paradigme darwinien, et je pense que c’est une stratégie désastreuse, car le darwinisme ne donne aucun sens à la vie. Comment le darwinisme pourrait-il insuffler une nouvelle âme aux peuples européens alors qu’il s’agit d’une théorie matérialiste qui n’accorde aucune place aux forces spirituelles. Le darwinisme mécanise la vie et déshumanise l’humain. C’est d’ailleurs une arme maniée avec beaucoup plus d’efficacité par les adversaires de la civilisation blanche : le catéchisme darwinien n’affirme-t-il pas en effet que les races n’existent pas – surtout la race blanche ?
La théorie de Sheldrake permet de penser une anthropologie qui accorde toute son importance à la nature généalogique de l’être humain, mais sans réduire celle-ci à sa dimension matérielle, chimique. La résonnance morphique, dont Sheldrake étend et teste l’application aux domaines psychologiques et même parapsychologiques, suggère que les hommes sont liés spirituellement de manière organique et holistique, c’est-à-dire que l’âme individuelle est enveloppée dans une hiérarchie d’âmes groupales, et que cette hiérarchie est fondée non pas exclusivement mais principalement sur la consanguinité. Ce modèle rejoint la théorie de Ludwig Gumplowicz (1838-1909), l’un des pionniers de la sociologie, qui fait du « sentiment syngénique » fondé sur la consanguinité le principal facteur de cohésion des sociétés humaines.
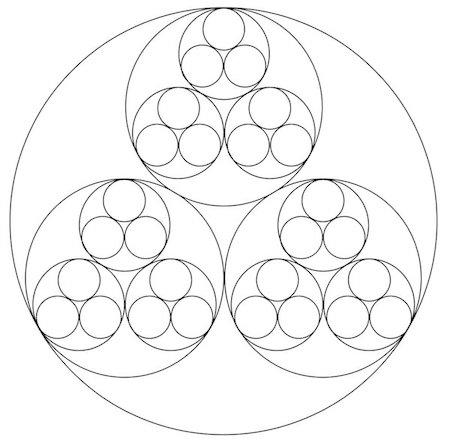
- Représentation symbolique d’un système holistique
En définitive, la métaphore de Dawkins n’est pas sans valeur, si seulement nous lui restituons une dimension spirituelle. Les gènes, écrit-il, « nous ont créés, corps et esprit ; et leur préservation est la raison ultime de notre existence ». Préservation n’est pas le bon concept ; on ne peut que partager ses gènes. Mais cela mis à part, dans une conception sheldrakienne du génétique, on est conduit à concevoir que l’Homme, en tant qu’être spirituel et non seulement matériel, est un être essentiellement collectif, qui s’inscrit dans une lignée.
Le « sang » est le nom que l’on donnait jadis aux qualités spirituelles et morales qui se transmettent des parents aux enfants, lorsqu’on ne savait encore rien de l’ADN. Cette notion traditionnelle du « sang » est totalement étrangère à la modernité. Le « sang » n’évoque pour la plupart des Européens ou des Américains qu’une substance chimique qui prolonge notre misérable vie individuelle.
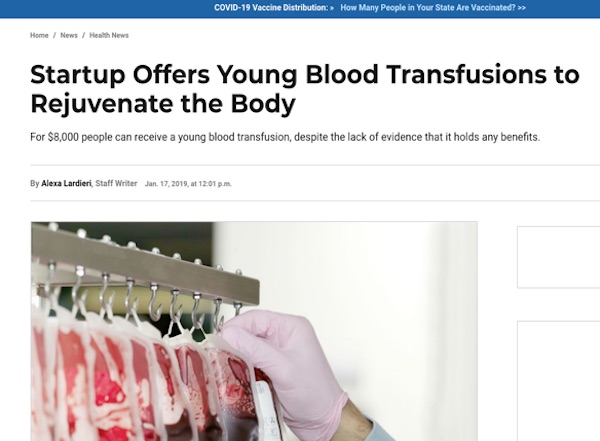
- Une startup propose des transfusion de sang jeune pour rajeunir le corps
Le sang, au sens traditionnel d’âme génétique, est l’impensable de l’individualisme matérialiste, qui est le fondement théorique de la société libérale des droits de l’homme. L’individu est déclaré être la réalité humaine ultime, en fait la seule réalité humaine. Sur le plan politique, cela a justifié les théories « contractualistes », qui commencent avec Thomas Hobbes (Léviathan, 1651) et passent par Adam Smith (La Richesse des nations, 1776). Postulant, comme Hobbes, que les hommes sont motivés exclusivement par leur intérêt personnel et matériel, Smith imagine que, par la magie de la libre concurrence, la somme des individualismes égoïstes engendrerait une société juste. Selon lui, les hommes contribuent mieux au bien public lorsqu’ils ne s’occupent que de leur bien personnel. Nous connaissons le résultat ; l’argent n’est pas le sang d’une société organique faite de cellules et d’organes, mais le carburant d’une société mécanique où les individus sont interchangeables. Le patrimoine génétique et le syngénisme sont la véritable richesse des nations.
Il faut sans doute avoir atteint un certain âge pour comprendre combien la personnalité et la destinée des hommes sont formées, à leur insu, par leur généalogie, par l’histoire des générations dont ils découlent. À la fin de sa vie, Carl Jung évoquait « l’étrange communauté de destin qui me rattache à mes ancêtres », ainsi que le « sentiment d’être sous l’influence de choses et de problèmes qui furent laissés incomplets et sans réponses par mes parents, mes grands-parents et mes autres ancêtres » [13]. La psychologie transgénérationnelle a apporté de nombreuses confirmations de l’intuition de Jung. Un de ses pionniers était Ivan Boszormenyi-Nagy, qui s’est intéressé à ces « loyautés invisibles » qui nous rattachent inconsciemment à nos ancêtres et façonnent notre destin de façon largement inconsciente, sur la base d’un système de valeurs, de dettes et de mérites : « L’élaboration de la loyauté est déterminée par l’histoire de la famille et par le type de justice que cette famille pratique et par les mythes familiaux. Elle trouve résonance en chacun des membres de la famille. » [14] Vincent de Gaulejac, dans L’Histoire en héritage. Roman familial et trajectoire sociale, évoque les « nœuds sociopsychiques » et « impasses généalogiques » qui peuvent parasiter le destin d’un individu cherchant à se déraciner de sa famille :
« À vouloir rompre à tout prix, il reste attaché sans comprendre pourquoi. À tenter de se construire dans un ailleurs, il reste surdéterminé par une filiation qui s’impose à lui quand bien même il penserait lui échapper. Ces inscriptions inconscientes conduisent à postuler l’existence d’un passé généalogique qui s’impose au sujet et structure son fonctionnement psychique. » [15]
Cette part de déterminisme généalogique, bien qu’incontestable, est une aberration du point de vue de l’utopie libérale. Mais il faut bien admettre qu’elle est également étrangère au christianisme, et que l’individualisme philosophique qui sous-tend la modernité est en partie le rejeton du christianisme (voir Louis Dumont, « La genèse chrétienne de l’individualisme moderne », dans Essais sur l’individualisme [16]).
À l’inverse, les Juifs reconnaissent et valorisent cette vérité anthropologique du sang, inscrite au cœur de la Bible hébraïque. Les Juifs, a écrit Martin Buber, font du sang « la couche la plus profonde et la plus puissante de [leur] être ». Le Juif perçoit « quelle confluence de sang l’a produit. […] Il sent dans cette immortalité des générations une communauté de sang » [17]. Nathan Wachtel, dans un livre sur la dispersion marrane, rappelle que le terme « nation », qui vient du latin natio, « naissance », a d’abord été utilisé au XVIe siècle par les marranes portugais et espagnols dispersés à travers le monde, « qui ne professent pas officiellement la même foi religieuse, et cependant partagent le sentiment d’appartenir à une même collectivité, désignée lapidairement par un mot : la Naçã » [18].
Notre faiblesse à nous, Goyim européens, est l’individualisme. Notre sens du sang, de la lignée, est faible, et s’affaiblit d’année en année, produisant des êtres fragiles, incapables de se donner un destin commun, même au niveau familial. Il y aura bientôt un siècle, un mouvement européen était entièrement basé sur le droit naturel du sang (voir à ce sujet Johann Chapoutot, La Loi du sang. Penser et agir en nazi, Gallimard, 2014). La dénazification de l’Europe s’est depuis accompagnée d’une guerre sans pitié contre tout ce qui ressemble de près ou de loin à cette idéologie du sang (lire mon article « Jusqu’où ira la dénazification ? »)
L’anthropologie moderne a démontré que le réseau complexe de parenté qui enveloppe chaque personne de la naissance à la mort forme la structure distinctive de chaque société. Notre ancien système de parenté, hérité du monde romain et organisé autour de l’autorité du père, après avoir été affaibli par le christianisme, est aujourd’hui déchiqueté avec une sauvagerie inouïe.
Chacun de nous est membre d’un arbre généalogique : c’est notre identité première. Il me semble que l’affirmation de cette loi naturelle devrait revenir au premier plan dans un puissant mouvement culturel. Que nous voulions sauver notre civilisation ou en préparer une nouvelle, nous devrions peut-être travailler à la restauration du clan. La définition la plus simple du clan est « la communauté au sein de laquelle on ne se marie pas ». Il s’agit de la famille élargie, de trois ou quatre générations, auxquels il faut ajouter les aïeuls, dont la présence symbolique est primordiale. Construire une nouvelle culture du clan est un grand défi, car le clan ne peut se maintenir que sur la base des hiérarchies naturelles, qui se heurtent à nos « valeurs » démocratiques et mercantiles.
Mais si nous donnons la priorité à la construction de grandes familles solidaires et durables, des hommes et des femmes de valeur en sortiront – des héros, peut-être. Cela me rappelle d’ailleurs quelque chose que Laurence Leamer a écrit sur les Kennedy :
« Joseph P. Kennedy a créé une grande chose dans sa vie, et c’était sa famille. […] Joe enseignait aux siens que le sang régnait et qu’ils devaient se faire confiance et s’aventurer dans un monde dangereux plein de trahisons et d’incertitudes, pour retourner toujours dans le sanctuaire de la famille. » [19]














 et
et  !
!










