Le cinéma est le langage d’une société qui raconte son histoire. Écrire sa propre légende, c’est expliquer aux générations futures qui l’on était, ce que l’on faisait, c’est s’accomplir, comme indiqué sur le plus haut étage de la pyramide de Maslow. On comprend dès lors le potentiel subversif et rassembleur du cinéma. Le pouvoir diviseur le comprend aussi et a depuis longtemps investi cette catégorie, l’a retourné en une force de dissuasion travaillant à peupler l’imaginaire des colonisés de récits paralysants. Colonisation de peuplement de l’imaginaire.
Traits d’esprit dans la grisaille
Le cinéma permet à un pays de se reconnaître en des acteurs qui le « représentent » comme disaient les rappeurs d’avant Internet (époque Fonky Family). Les acteurs sont des points de repère auxquels peut se référer le groupe. En cherchant quels acteurs ont le mieux représenté le type français on pense généralement aux Gabin, Lino, Marielle, Rochefort. On oublie les seconds rôles qui gagnent à être connus pour quelques scènes marquantes. Claude Piéplu qui joue le commissaire Andréani dans Rabbi Jacob, Jean Carmet le maître-chien du Château de ma mère, Richard Bohringer le clochard gouailleur d’Une époque formidable, Bruno Crémer le sergent Wilsdorff de La 317e Section, François Levantal le policier intègre de Gangsters, Claude Rich le bellâtre insolent des Tontons flingueurs, Jacques François le distingué pharmacien du père Noël est une ordure.
Dans ce registre des bons acteurs français méconnus il faut ajouter Thierry Frémont et Patrick Bouchitey dans ce petit film culte : Les Démons de Jésus. Sorti en janvier 1997, ce discret chef-d’œuvre au budget modeste est une sorte de Seul contre tous débarrassé du nihilisme, nimbé d’une petite lumière que nous osons, au vu du titre, qualifier de divine. Dans une banlieue-dortoir de Paris, pendant l’hiver 1968, une famille de gitans sédentarisés vit de bricole, de musique et de traits d’esprit. Ils fréquentent au café du coin les ouvriers des usines voisines et sont en lutte d’une part avec les immigrés italiens joueurs de poker qui convoitent leur sœur, d’autre part avec la police qui se languit de les faire condamner. En somme les prolétaires productifs sont unis contre le parasitisme importé et la prédation d’État. Nos gitans sédentarisés se prénomment Jésus, Marie, Joseph, et leur nom de famille est Jacob, cela ne s’invente pas.

La France est la synthèse de deux zones limitrophes qui ont servi de repoussoir dans la formation de sa spécificité : l’Italie et l’Angleterre. De ces deux extrémités, l’une de soleil et de bonne humeur, l’autre de pluie et de laconisme, la France a hérité de la voie médiane faite de grisaille et d’esprit. Le film s’inscrit dans cette filiation. Laissons les touristes se repaître des turlutaines sur le pays romantique. La France, pays dur, pays de ciel gris, pays d’entrepôts logistiques ouverts la nuit, l’hiver, dans la campagne, que des magasiniers approvisionnement sous les néons aveuglants, parce que « c’est la norme d’éclairage qu’est comme ça ». Pour tenir bon chaque jour nous avons la langue française et l’esprit qui la met en marche. Tradition du langage imagé, sens de l’analogie, de la métaphore et de l’euphémisme, dont les Villon, d’Aubigné, La Fontaine, Chénier, Rostand et Céline ont été à chaque siècle depuis 1440 les grands chantres.
Et combien de braves gars que nous avons connus au lycée étaient des Rostand qui s’ignoraient ? Quand on repense un peu à ces bons mots lâchés froidement qui déclenchaient le fou rire de toute une bande, à ces trouvailles d’expression qui captaient l’attention de l’auditoire, on imagine quelle œuvre ces camarades auraient produite s’ils avaient creusé davantage la veine qui leur souriait. La rue française est une haute école de l’esprit, de cet art anti-matériel, jubilatoire et salvateur qui vous donne de dédramatiser une passe difficile, de repartir du bon pied dans la vie. Les Démons de Jésus est de ce tonneau. La pauvreté, la noirceur des nuits, le climat et l’ennui n’ont pas de prise sur les personnages. C’est Franck Margerin mis en film. Ce qui commence dérisoire finit par dérider l’assistance, et qu’importent les démêlés passés du cinéaste Bernie Bonvoisin, ses choix idéologiques, ses prises de parole publiques. Sur le long terme, cet artiste restera célèbre pour deux œuvres principales : sa chanson Antisocial et son film Les Démons de Jésus. Le jugement politique cède devant la qualité du travail fini.
La méthode de Caravage
Les grands peintres ont longtemps chargé de marron, de verdâtre et de noir le fond de leurs toiles pour mieux faire resplendir les zones claires : la flamme d’une bougie, la figure gracieuse d’une communiante, un coin de ciel. C’est une méthode éprouvée jusque dans le paysage immatériel de nos vies quotidiennes où les moments de grâce opèrent d’une manière analogue. Il en va encore ainsi de ce film sur la banlieue où les jeunes femmes sont d’autant plus jolies que l’arrière-plan est laid.
« Remarquons en passant que ce qu’un rayon de soleil perçant soudainement les nuages est pour un beau paysage, le rire qui s’y épanouit l’est pour un beau visage. Donc, ridete, puellae, ridete ! [riez, jeunes filles, riez] », dit Schopenhauer.
Mention spéciale à Nadia Farès, la jeune sœur de la famille un peu trop émancipée, et à Fabienne Babe pour sa petite voix perchée qui donne la réplique à Thierry Frémont, notamment dans les scènes de fâcherie. Bernie Bonvoisin a rappelé, avec un brio dans les dialogues qui ne s’était plus vu depuis Audiard et Lautner, que la chambrette n’est pas l’insulte, que l’homme de la rue parle parfois comme Cyrano et que la femme qui vient lui faire des remontrances offusquées, qui vient lui jouer sa comédie de petite effrontée, est souvent une admiratrice secrète.
La beauté qui vient d’en bas est un thème connu depuis Balzac. Gabrielle Chanel, Laetita Casta, Marlène Jobert et d’autres mignonnes venaient de milieux modestes. Dans le film, Nadia Farès et Fabienne Babe sont deux jeunes caissières d’un quartier populaire, milieu âpre où la noblesse humaine repose sur une attitude devant la vie, se révèle par un geste, une parole, un refus. C’est une chose agréable que de voir une jolie femme qui sait parler, chez qui la conversation dépasse le moi-je de la démocratie de marché et d’opinion pour exprimer un surmoi, une sorte de fidélité. Charles Péguy évoquant ses souvenirs d’enfance dans l’Orléanais dit :
« Nous avons connu un temps où quand une bonne femme disait un mot, c’était sa race même, son être, son peuple qui parlait, qui sortait. Et quand un ouvrier allumait sa cigarette, ce qu’il allait vous dire n’était pas ce que le journaliste avait dit dans le journal de ce matin. » (L’Argent).

Une œuvre du peintre flamand Lucas de Heer datée de 1560 représente trois dames de haute lignée et tout à droite une femme d’extraction plus modeste, épouse d’un commerçant. Cette dernière est plus distinguée, les traits de son visage sont plus fins que ceux des dames nobles aux têtes rondes, aux yeux globuleux. La vraie noblesse se révèle parfois chez les gens les plus simples tandis que d’autres, occupés à contempler leur arbre généalogique en se flattant de noble, de mythique, ou de sémitique extraction, peuvent se conduire avec la dernière vilénie. La vertu comme seule vraie noblesse quelle que soit la classe sociale est le thème du merveilleux film Gosford Park, c’est aussi l’idiosyncrasie des deux petites caissières futées dans Les Démons de Jésus.

Le film « social » était une spécialité européenne des années 1930 à 1960. Sur les trente dernières années, les réussites en ce domaine se comptent sur les doigts d’une main au moment où elles auraient dû fleurir de témoignages plus intenses que jamais, au moment où la destruction d’un prolétariat poussé au chômage par les fermetures d’usine, interdit de produire et de se reproduire, tournait en une mise à mort plus cruelle que jamais. Les Italiens ont eu Gomorra (2004), les Anglais Nil by Mouth (1997), nous avons eu Les Démons de Jésus la même année. Le point commun de ces trois films est la ligne de respect pour la figure du père que garde la morale finale. Même si cet homme a été faillible, buveur ou brutal, celui qui tient la maison est respecté, pardonné, aimé, et sur cette base toutes les résurrections sont possibles.
Le récit national libre d’idéologie est une fête de retrouvailles avec le village natal, c’est la joie de voir votre prochain, votre bon voisin, exprimer mieux que vous ce que vous pensiez en votre for intérieur sans pouvoir le dire. C’est le pays aimé remis dans son ordre profond, où les hommes sont braves et spirituels, où les femmes sont prudes et débrouillardes, où ces deux pôles distincts se cherchent comme l’orage et la terre.
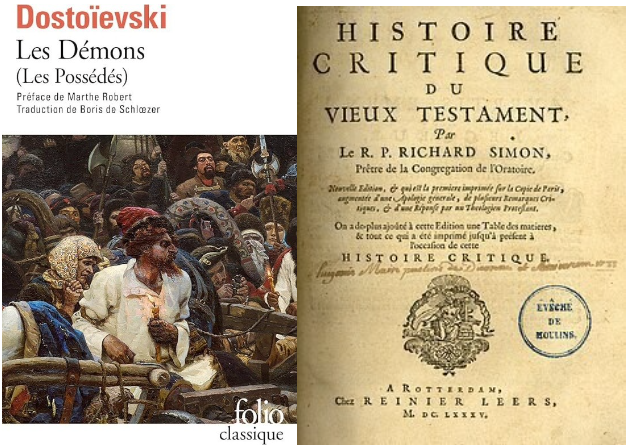
Lecture dialectique de la Bible
Contre l’opinion générale, Nicolas Bonnal décrit les années de Gaulle comme le début de la catastrophe. Et s’il nous fallait abonder dans ce sens nous dirions que la France saurait tout à fait être la France sans la grandeur, oh si, que cela s’est déjà vu du temps du roi de Bourges. Tandis que sans la chaleur, sans la blancheur, sans le chant en chœur... cela est plus douteux. Sur un territoire réduit à la stricte métropole, où même à la portion congrue des frontières de 1419, un seul million d’hommes reste le surgeon potentiel de cent autres millions tant qu’il sait qui il est et ce qu’il doit faire. « Ne crains pas, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le Royaume », dit le Jésus de l’Évangile.
Chaque époque est le jugement de l’époque précédente. La succession d’erreurs commises à partir de Louis XIV est une ardoise de dettes oubliées que la main invisible d’un débiteur a soudain présentée pour paiement immédiat entre 1960 et 1970. Tout a changé pendant cette décennie décisive et n’a plus bougé depuis : la religion, les colonies, la natalité, la barre d’immeuble, le mariage, la contraception, l’immigration, le cheptel féminin considéré comme un marché, l’ordre social, la prière et la défense, l’or et la monnaie, la production et la consommation. La fin de tout, la fin des chansons, la fin des campagnes, et la fin de ce qui détermine tout le reste, la fin de cette piété religieuse tranquille, populaire, évidente.
Vivre comme si Dieu n’existait pas, pour des raisons de paresse, de révolte, d’indifférence, c’est prétendre avec superbe connaître mieux la vie que nos ancêtres, c’est monsieur Dubois 2025 qui juge monsieur Dubois 1625, c’est ne plus comprendre notre place sous les Cieux, c’est déclarer sans le dire, sans même le savoir, y être illégitime et se résoudre à s’en faire bientôt chasser. C’est proclamer, comme l’a démontré Dostoïevski, que si Dieu n’existe pas alors tout est permis, alors tout est pour de faux. Ainsi les invasions modernes toutes brutales soient-elles, tant qu’elles sont teintées d’arrière-plan religieux même ténu, deviendraient fondées au plan de la dialectique historique : elles seraient la punition immanente du reniement des apostats. L’athéisme, en somme, c’est vraiment donner d’une main le bâton pour se faire battre et s’autoflageller avec l’autre. Nous en sommes là.
Sur les catégories vitales de l’éducation, de la vertu féminine et de la reproduction, Patrick Buisson, renseigné sur la dialectique historique, identifiait le succès des religions exogènes à un « miroir de nos renoncements ». Le rappeur Ideal J, plus littéral, demandait en 1998 si « deux p* qui s’embrassent en plein Paris, les scènes de cul à la télé, le dévergondage des femmes dans le monde entier, seraient l’enfer qui nous est prédestiné ». Ce hardi scribe sous l’arbre à palabre a depuis modifié les paroles de son ancienne question oratoire, allez savoir pourquoi.
Qui sommes-nous, que devons-nous faire, comment devons-nous vivre ? Le fanatisme est la réponse extravertie à ces angoisses existentielles. Mais la tranquillité existentielle issue de l’humanisme débouche sur toutes les dégénérescences quand elle cesse (et l’on hausse les épaules exactement ici) de chercher Dieu.
L’aviateur Antoine de Saint-Exupéry répondait à ces hausseurs d’épaules dans l’une des dernières lettres de sa vie.
« Il n’y a qu’un problème, un seul de par le monde. Rendre aux hommes une signification spirituelle, des inquiétudes spirituelles. Faire pleuvoir sur eux quelque chose qui ressemble à un chant grégorien. Si j’avais la foi, il est bien certain que, passé cette époque de "job nécessaire et ingrat" je ne supporterais plus que Solesmes. On ne peut plus vivre de frigidaires, de politique, de bilans et de mots croisés, voyez-vous ! On ne peut plus. On ne peut plus vivre sans poésie, couleur ni amour. Rien qu’à entendre un chant villageois du XVe siècle, on mesure la pente descendue. »
En renonçant à son droit d’aînesse pour un plat de lentilles, une partie du peuple français n’a-t-il pas joué dans les années 1960 le rôle de l’Ésaü de la Genèse ? Ainsi fut-il dépossédé de tous ses biens par une autre tribu mimant le rôle de Jacob, saisissant l’occasion pour « livrer le pays à une dévastation » (Ésaïe 24:1) qui n’a pas cessé depuis. La Bible on le sait, est dans sa lecture talmudique le mode d’emploi du fanatisme. Elle peut constituer au minimum, pour un matérialiste endurci, un outil performant d’explication du monde. L’étude des textes bibliques est une discipline qui ouvre des perspectives immenses dont nul ne parle à la télévision. Il est compréhensible d’enrager contre la Bible vu la manière dont s’en réclament certains chapeaux noirs. Ce qui est fructueux c’est de lire les événements en cours à la lumière de l’interprétation chrétienne de la Bible compilée dans le recueil Catena Aurea au fil des siècles, collection de réponses décisives, véritables prises de judo qui renversent le fanatisme d’aussi haut qu’il vous prenait, d’aussi fort qu’il vous malmenait. Il faut apprendre ces prises et les appliquer lors du combat. Le diable veut vous écœurer de la Bible en brouillant les pistes, en vous y désignant comme le méchant condamné d’avance, mais Jacob et Ésaü sont des figures, des surmois, non des essences personnifiées sur terre par des lignées fixes. Refuser l’étude biblique revient à refuser l’entraînement de boxe au prétexte que c’est un sport de caillera. Résultat, caillera vous mettra.
« N’avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain, et que tu as un démon ? Jésus répliqua : Je n’ai point de démon ; mais j’honore mon Père, et vous m’outragez. Je ne cherche point ma gloire ; il en est un qui la cherche et qui juge. » (Jean, chapitre 8)
Si tout est dialectique il importe d’identifier qui joue le rôle de qui à quel moment. Par exemple il est facile de démontrer que la figure d’Édom « le rouge », fils d’Ésaü, présente selon les époques des accointances tantôt avec les uniformes rouges de l’armée anglaise, tantôt avec le drapeau de l’empire ottoman ou de l’URSS, peut-être avec le nom de la banque Rothschild (« bouclier rouge »), ou encore avec la Synagogue en général. En effet, ressentiment, échafaudages de plans, sang des autres jamais sur les mains, prééminence du matériel, claustration dans l’orgueil et complots tramés par proxy sont tous des éléments qui caractérisent Ésaü et Édom dans la Bible. Ainsi ce serait donc nous Jacob comme la famille de Jésus dans le film qui nous intéresse ? Mais, le démon étant polymorphe, pas de conclusion hâtive…
La famille Jacob du film Les Démons de Jésus incarne le Français heureux chez lui, le gentil. C’est aux fruits qu’il porte que l’on reconnaît l’arbre, pas aux titres savants dont les botanistes l’ont affublé, quelle que soit par ailleurs l’étymologie du terme « gentil ». Primauté du concret sur le nominalisme.
S’il est un démon contre lequel nous luttons tous à chaque instant dans une guerre sainte et intérieure qu’autrui ignore, c’est le démon du doute (assimilé dans l’Ancien Testament à la figure d’Amalek), le démon premier, le plus dangereux de tous car si vous le laissez prospérer, il aboutit au désespoir, dernier stade d’une spirale négative qu’il a initiée. Dostoïevski le savait, d’où le titre d’un des livres les plus étonnants de toute la littérature occidentale. Les démons sont autant de monstres que combat le Christ messie de Dieu, et vous avec lui votre vie durant.














 et
et  !
!








