En France, tout le monde profite du chômage : politiques, patrons, syndicats, formateurs, chômeurs (indemnisés), tous, sauf les employés sous pression et les chômeurs relégués. Le politique se fait élire sur des promesses antichômage, le grand patron augmente ses marges en compressant les effectifs, le syndicat justifie son existence et ses prébendes, le secteur de la « formation » se gave sans rendre de comptes... tandis que l’armée des travailleurs précaires tremble et se soumet, abandonnant la solution collective pour le salut personnel. Et là, le système est sans pitié. Il n’a donc absolument pas intérêt au plein-emploi, ce leurre anesthésiant pour foules sentimentales.
Le chômage, d’après tous les observateurs, est la plaie nationale numéro un. Or, si on se tourne vers les 40 dernières années, dites du « chômage de masse », on réalise que personne, dans les différentes formes de pouvoir (politique, syndical, patronal) ne s’est vraiment attaqué à la chose, la considérant comme une fatalité, voire une opportunité. Aujourd’hui, en 2016, il y a tellement de corps intermédiaires qui profitent du chômage, qu’on ne voit pas qui prendra la décision politique de l’éradiquer.
Dernier exemple en date, le papier du très libéral – on a le droit – Nicolas Bouzou (sur la vidéo du 5 décembre 2014 face à l’économiste Bernard Maris, qui mourra un mois plus tard dans la tuerie de Charlie Hebdo) dans Le Figaro du 11 janvier intitulé Emploi, l’échec de la France. Selon cet économiste, qui officiait dans la Matinale de Canal+ à l’époque de Maïtena Biraben, « le taux de chômage pourrait être réduit de moitié si nos dirigeants, en recourant à la pédagogie, prenaient les bonnes mesures ». Il évoque alors les fameuses réformes, jamais réalisées, connues de tous, mais qui font peur au politique :
![]() alléger le coût du travail pour les salariés les moins qualifiés
alléger le coût du travail pour les salariés les moins qualifiés
![]() introduire un contrat de travail à durée indéterminée flexible
introduire un contrat de travail à durée indéterminée flexible
![]() affecter une part importante de la formation professionnelle vers les demandeurs d’emploi
affecter une part importante de la formation professionnelle vers les demandeurs d’emploi
![]() rendre les indemnisations chômage dégressives à partir de neuf ou douze mois
rendre les indemnisations chômage dégressives à partir de neuf ou douze mois
![]() faire en sorte que l’activité paie toujours plus que l’inactivité
faire en sorte que l’activité paie toujours plus que l’inactivité
![]() faire monter en puissance l’apprentissage dans les filières manuelles
faire monter en puissance l’apprentissage dans les filières manuelles
Bouzou avance l’exemple de l’Autriche, avec son système éducatif d’apprentissage qui ne laisse personne en plan. Inversement, un pays beaucoup plus sévère que la France en ce qui concerne les indemnités de chômage, faibles et rapidement dégressives. Les Autrichiens sont fortement incités se remettre au travail ! Autre mentalité… Une sous-indemnisation compensée par un puissant système de formation, qui touche 40% des jeunes. On rappelle que dans la France de 2015, plus de 24% des jeunes (15-24 ans) sont au chômage (chiffres INSEE), contre, par exemple, 50% en Espagne. 48,8%, pour être précis. Mais moins de 10% en Allemagne. Le « new deal » européen lancé par la France et l’Allemagne en 2013 pour aider les moins de 25 ans – 6 milliards de crédits pour accéder à une formation, un apprentissage ou un contrat d’alternance –, n’a pas dégonflé les chiffres chez nous.
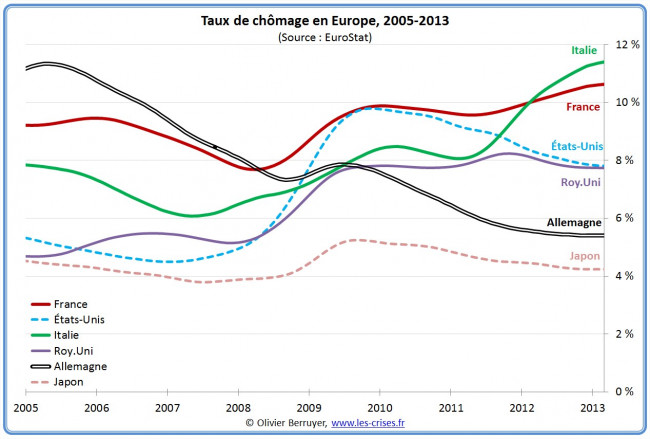
Lundi 11 janvier, le Premier ministre Manuel Valls recevait les représentants des syndicats et du patronat pour, merci de ne pas rire, trouver des solutions contre le chômage. Une séquence connue, qui ressemble à une pièce de théâtre sans fin, et qui n’intéresse plus personne, tant elle est stérile. Tout le monde fait semblant, joue sa partition dans les médias, tandis que les entreprises débauchent. La simple nomination d’incompétents au ministère du Travail (qui devrait s’appeler ministère du Chômage) et leur rapide turn-over indiquent que le poste est jugé doublement dangereux pour la carrière politique : éjectable, et pris entre le chien patronal et l’os syndical (ou la réciproque). Derniers zigotos en date : la gaffeuse El Khomri et le pleutre Rebsamen. Mais ne nous laissons pas égarer par la politique politicienne, faite justement pour enfumer les questions sérieuses.
Le plan d’urgence pour l’emploi, 250ème du nom, s’appuie sur la formation d’un demi-million de chômeurs, une 35ème relance de l’apprentissage, et un 146ème soutien financier aux PME qui embauchent. Toujours pas trace d’un petit allègement fiscal aux 2 millions de très petites entreprises, qui sont quasiment interdites d’embauche, tant le moindre emploi leur coûterait cher. La moitié d’entre elles n’employant d’ailleurs pas de salarié. Ensemble, elles représentent 2,3 millions de salariés. Pourtant, il y a là un vivier. Des chiffres d’affaires qui ne demandent qu’à grossir. On parle aussi d’une 453ème simplification du Code du Travail, que Gérard Filoche défend mordicus, au sein du même Parti socialiste – celui du très libéral Macron –, et d’un assouplissement du contrat de travail qui, selon les organisations patronales, est responsable à lui tout seul de « la peur de licencier ». Et de son corollaire, la peur d’embaucher.
Le Figaro du 12 janvier rappelle que les 400 000 CNE (contrats nouvelle embauche), qui avaient été créés en moins de 18 mois à partir d’août 2005, sous Villepin), n’avaient pas résisté à leurs « failles juridiques ». Rappel : le CNE permettait à tout employeur d’une entreprise de moins de 20 salariés (comprenant les TPE, donc) de licencier sans motif pendant une période de « consolidation » de deux ans. 400 000 contrats, un autre succès que celui des piètres « contrats de génération » d’Hollande un an après son arrivée à l’Élysée, avec ses 4 000 euros d’aide annuelle pour l’embauche d’un jeune de mois de 26 ans en CDI, avec le maintien d’un senior de plus de 57 ans. Le truc acrobatique simple à réaliser… Des 100 000 contrats par an envisagés par le ministère du Travail, on tombera à… 10 000, péniblement atteints la première année. Pour arriver au chiffre colossal de 33 000 en deux ans. Méconnaissance de la vie économique de base du pays, sortie tout droit des cerveaux énarqués et hecisés de nos élites.

- Le ministre de l’Économie Emmanuel Macron et le leader du Medef Pierre Gattaz sur le campus de la grande école HEC, le 27 août 2015, à la clôture de l’université d’été du syndicat patronal
Pierre Gattaz, le patron du Medef, espère ainsi inclure dans le contrat de travail la clause de « licenciement en cas de baisse du chiffre d’affaires ». Petit bémol, en passant : des entreprises qui font du bénéfice ne se gênent pas pour licencier, voir l’exemple des employés Pentair de Ham. Sans tomber dans le bolchevisme, il manque la réciproque à cette proposition patronale. Une tendance à la déréglementation qui passe mal chez nos syndicats de gauche, faut-il le rappeler. Ainsi, Philippe Martinez, le patron de la CGT, est-il mécaniquement monté au créneau : « Ce n’est pas en favorisant les licenciements qu’on va créer de l’emploi. »
Pour les syndicats, globalement, toucher au contrat de travail est un casus belli. Le Figaro rappelle, avec honnêteté, qu’en trois ans de hollandisme, les prélèvements des entreprises ont baissé de 41 milliards d’euros. Dans ce plan ficelé en dernière minute, face aux sondages qui placent le chômage en préoccupation numéro un des Français (à 77%, loin devant le terrorisme – dommage pour Valls, qui mise sur la terreur plus que sur le social pour 2017), qui surgit en catastrophe dans la dernière ligne droit du quinquennat, on sent comme une urgence artificielle.
De toute façon, si les socialistes – ou les antisocialistes – voulaient vraiment faire quelque chose contre le chômage, ils seraient obligés de tout mettre à plat, et de s’engouffrer dans un maquis d’aides et de contraintes plus épineux, épais et dangereux que les montagnes corses infestées de nationalistes en cavale. Un foutoir de soutiens plus ou moins directs, à plus ou moins bon escient, et relativement clientélistes, à défaut d’une vraie politique.
Mais qu’est-ce qui ne va pas, dans notre cher pays, pour que plusieurs millions de personnes se retrouvent sur le carreau ?
On retire de ces 5 à 7 millions de non-travailleurs ceux qui ne veulent effectivement pas travailler, ou qui « profitent » du système d’indemnisation, alignant leur vie sur de faibles revenus, augmentés d’un peu de « black » ou de débrouille (jardin potager, solidarité familiale), ce qui est une philosophie… antisystème, avec le (petit) chèque du système en fin de mois.
Car survivre sans travailler est difficile, et parfois délictueux. Avec un tel chômage de masse, notre système économique produit une population déconnectée du cycle de production-consommation (de masse), formant des dissidents… malgré eux. Parmi ces malgré-nous, des anti-travail politisés ou organisés, mais aussi des inadaptés à la société actuelle. Qu’ils soient sous ou mal formés par l’Éducation nationale et ses prolongements (université, écoles professionnelles), ou qu’ils soient dépassés par la vie moderne et ses contraintes de plus en plus complexes. Ce petit peuple laborieux qui auparavant occupait des emplois subalternes et invisibles, est rattrapé par la pauvreté, parfois par la misère. Ce qui n’empêche pas les médias de le punir en lui mettant sa situation sur le dos, acculant des millions de culpabilisés en défense, brisant un peu plus ce qu’il leur reste de forces morales.

- Les journaux d’information unidirectionnelle dénoncent "la France des assistés" et les rendent responsables de leur situation
On se demande alors, pourquoi ces gens-là ne sont-ils pas mieux formés ?
Parce que l’école française pâtit de son élitisme, qui produit une superélite, à côté d’une masse de non-gagnants, et une bonne dose de vrais perdants. En faisant perdre confiance en eux à trop d’enfants dès l’école primaire, par l’apprentissage de l’échec, on fabrique des adultes qui ne peuvent plus s’en sortir par eux-mêmes, et qui se tournent vers l’État, Providence qui se raréfie. La France des assistés est là. C’est elle-même qui les produit. Tous les discours sur les problèmes de la formation professionnelle (inadaptation au « marché », gabegie) viennent donc trop tard. C’est en amont qu’on peut agir, en formant des enfants équilibrés, physiquement et intellectuellement, des jeunes sûrs d’eux face aux bouleversements de l’avenir. Mais là, ça fait déjà beaucoup pour l’école française, dépassée par le bas et sabotée par le haut, dans une mâchoire doublement violente. Ce n’est donc pas cette école, lourde à tous points de vue et enlisée, qui assurera ce changement, mais des petites structures pédagogiques parallèles. Nous y reviendrons.
À chaque fois que l’État décide de s’en prendre au chômage, les grandes envolées lyriques de la ligne de départ finissent par s’ensabler dans le maquis administratif, et les résistances des corps intermédiaires, publics ou privés (déjà, le Pôle Emploi externalise une partie de l’accompagnement/placement)). Il y a 30 ans, quand le PS fit le choix du libéralisme économique et de la déréglementation, la droite n’est évidemment pas revenue dessus, appuyant encore plus fort sur cette pédale commune.

- Mars 2005, Paris Match organise une séance photo avec Sarkozy et Hollande, qui défendent tous deux le “oui” à la Constitution européenne
L’alternance – qui porte très mal son nom – est évidemment profondément et uniquement libérale, mais on ne voit pas ce que l’employé français y a gagné. Il y a même perdu, concrètement : entre la puissance du marché (donc de la finance et de la banque), l’accroissement du pouvoir politique des très grandes entreprises (par rapport aux PME, toujours cet élitisme suicidaire), et la concurrence mondialiste, l’employé français a été le grand perdant de la guerre économique déclenchée contre lui depuis 1975.
Ceux qui disent que tout irait mieux avec plus de déréglementation ou moins de « résistances » sociales ont peut-être raison, mais qui veut faire l’expérience… américaine en France ? Qui veut perdre ses dents sans pouvoir aller chez le dentiste ? À part ceux qui les ont déjà perdues, on ne voit pas beaucoup de candidats.
Les syndicats (doit-on ajouter divisés ?) sont trop faibles chez nous, pour pouvoir peser dans cette guerre. Les Français se sont détournés de ces défenseurs officiels, pour de bonnes et de mauvaises raisons. Le patronat a gagné, mais pas complètement, sa guerre contre les petits salariés et les chômeurs. Augmentant la pression au départ sur l’employé, et la difficulté du retour pour le chômeur. L’économique et le profit, c’est l’affaire du grand patronat ; le social et ses dégâts, celle du gouvernement d’alternance, réduit à ramasser les blessés du heurt économico-social.

La société à deux vitesses est là, avec deux France qui se font face : celle qui travaille, et celle qui ne peut plus travailler. Avec un fossé grandissant entre les deux, rempli par la petite flûte politicienne, prélude à un pouvoir de plus en plus répressif. Le terrorisme social intérieur est peut-être plus à craindre pour le gouvernement de l’Alternance que le terrorisme pseudo-religieux venu de l’étranger. On ne pourra pas éternellement éteindre l’incendie qui couve avec des contre-feux.













 et
et  !
!








