Dans les dernières semaines précédant son investiture pour un second mandat, le président élu Donald Trump n’a cessé de multiplier des déclarations qui, pour le moins, défient la prudence diplomatique. Non content d’évoquer une guerre commerciale avec les voisins immédiats des États-Unis, il s’est permis de caresser l’idée d’acquérir le Groenland, de restaurer la mainmise américaine sur le canal de Panama, et même, dans un élan de fantaisie impériale, de suggérer que le Canada devienne le 51e État de l’Union. Une rhétorique propre à inquiéter les chancelleries autant qu’à galvaniser ses partisans.
Le 10 décembre dernier, Donald Trump, fraîchement désigné par les urnes comme président des États- Unis, s’est permis une boutade d’un goût douteux à l’encontre de Justin Trudeau, Premier ministre du Canada, qu’il relégua au rang fictif de « gouverneur du grand État du Canada ». Les deux hommes venaient pourtant de se rencontrer sous les lustres dorés de Mar-a-Lago pour aborder une question cruciale : l’avenir des échanges entre leurs nations et la menace que Trump brandit comme une épée de Damoclès : l’imposition de droits de douane de 25 % si le Canada ne parvenait pas à juguler le flot incessant de migrants illégaux et de substances illicites traversant la frontière vers les États-Unis [1].
Face à ces saillies, le Canada, avec ce flegme qui lui est propre, a choisi de répondre par la modération. Mme Kirsten Hillman, ambassadrice canadienne à Washington, a pris le parti de l’apaisement : « Je crois que le président élu s’amuse un peu », a-t-elle déclaré. Et, avec une assurance empreinte de dignité : « Le Canada sait qui il est. Nous avons une forte identité et nous savons la défendre. » [2]
Le 22 décembre, lors d’un meeting en Arizona, Donald Trump réitéra son projet d’inscrire les cartels de la drogue sur la liste des organisations terroristes étrangères. Cette nouvelle désignation, dont l’intérêt stratégique est double, se révèle une manœuvre audacieuse et révélatrice de l’évolution de la politique américaine à l’égard de son voisin du sud. D’un côté, elle offre aux autorités américaines la possibilité d’interrompre le flot d’argent illicite, d’attaquer les sources financières qui alimentent ces réseaux criminels et de renforcer la mainmise des procureurs fédéraux pour infliger des sanctions sévères aux membres et alliés des cartels. Mais la véritable portée de cette mesure réside dans le pouvoir militaire qu’elle confère au Président : en vertu de la loi de 2001, cette classification permettrait une intervention directe, y compris des opérations militaires sur le territoire mexicain. Le président américain a même évoqué la possibilité de larguer des bombes sur les laboratoires de fentanyl, ou d’envoyer des forces spéciales américaines pour éliminer les figures de proue du narcotrafic [3].
Mais le vainqueur des dernières élections américaines ne s’arrêta pas là, le Panama eut également l’insigne honneur de se voir adresser un avertissement retentissant. Fidèle à son style incisif, Donald Trump a lancé une injonction péremptoire : que le canal de Panama revienne aux États-Unis si le pays qui en avait la gestion persistait à en administrer le fonctionnement selon des modalités qu’il jugeait contraires aux intérêts de son pays. Avec cette verve qui lui est propre, le 47e président américain dénonça les « prix et tarifs de passage exorbitants » que le Panama osait imposer aux navires traversant cette artère stratégique, rappelant, dans une rhétorique de bienfaiteur outragé, la « générosité extraordinaire » dont les États-Unis avaient jadis gratifié ce petit État d’Amérique central. Il proclama, avec la ferveur d’un tribun obsédé par les enjeux de domination, que le canal demeurait un « atout national vital », une clef de la prospérité et de la sécurité américaine, fruit des sacrifices héroïques consentis par son pays en 1914 pour mener à bien cet exploit d’ingénierie.
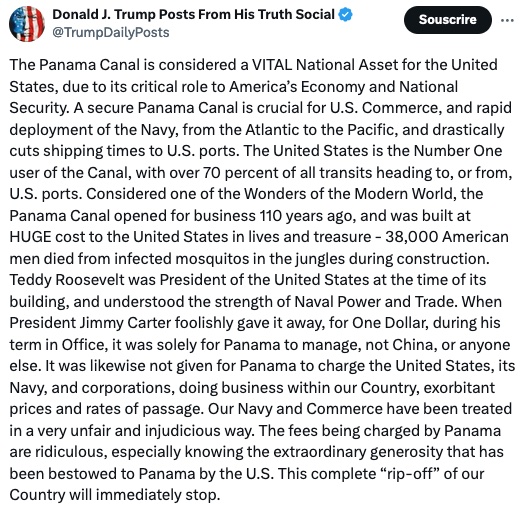
« Le canal de Panama est considéré comme un atout national VITAL pour les États-Unis, en raison de son rôle essentiel dans l’économie et la sécurité nationale des États-Unis. Un canal de Panama sécurisé est crucial pour le commerce américain et le déploiement rapide de la marine, de l’Atlantique au Pacifique, et réduit considérablement les délais de transport vers les ports américains. Les États-Unis sont le premier utilisateur du canal, avec plus de 70 % de tous les transits à destination ou en provenance de ports américains. Considéré comme l’une des merveilles du monde moderne, le canal de Panama a été ouvert il y a 110 ans et sa construction a coûté ÉNORMEMENT aux États-Unis en vies humaines et en argent : 38 000 Américains sont morts à cause de moustiques infectés dans les jungles pendant la construction. Teddy Roosevelt était président des États-Unis au moment de sa construction et comprenait la force de la puissance navale et du commerce. Quand le président Jimmy Carter l’a bêtement donné, pour un dollar, pendant son mandat, c’était uniquement au Panama, et non à la Chine ou à qui que ce soit d’autre, de le gérer. Il n’était pas non plus permis au Panama de facturer aux États-Unis, à sa marine et aux sociétés qui font des affaires dans notre pays des prix et des tarifs de passage exorbitants. Les accusations portées contre notre marine et notre commerce par le Panama sont ridicules, surtout si l’on connaît la générosité extraordinaire qui a été accordée au Panama par les États-Unis. Cette "arnaque" complète envers notre pays cessera immédiatement… »
Ce coup de semonce inattendu, qui semblait tout droit sorti des pages d’une histoire impériale, surgit vingt-cinq ans après que Washington eût consenti à transférer au Panama la souveraineté pleine et entière sur ce joyau d’acier et d’eau, conformément aux traités Torrijos-Carter de 1977. Mais le futur locataire de la Maison-Blanche, dans un mélange de nostalgie et de calcul, semble déterminé à ranimer une dispute que l’on aurait pu croire reléguée aux marges des archives diplomatiques.
Face à cette montée rhétorique, José Raúl Mulino, président panaméen, rejette sèchement les insinuations américaines : « Chaque mètre carré du canal de Panama et de ses zones adjacentes fait partie du Panama, et cela continuera d’en être ainsi. » La réponse, digne et ferme, tente de rappeler l’évidence : le Panama n’est plus un protectorat. Mais Trump, homme peu accoutumé à courber l’échine, répliqua d’un laconique et menaçant « On verra ça ! », aussitôt suivi d’une mise en scène provocante : une image où flottait un drapeau américain, fièrement dressé au milieu du canal, légendé d’un ironique « Bienvenue sur le canal des États-Unis ! » [4]

Il s’est trouvé qu’en décembre dernier, M. Trump, dans son style toujours abrupt et déconcertant, déclarait sur son réseau social Truth Social que les États-Unis ambitionnaient de devenir propriétaires du Groenland, cette immense terre glacée, afin de « garantir la sécurité nationale » et de servir, disait-il, « la liberté dans le monde entier » [5].
Le Groenland, bien que doté d’un gouvernement local, demeure sous la souveraineté de la couronne danoise. Longtemps une colonie, il fut intégré en 1953 comme un district à part entière du Danemark, conférant aux Groenlandais la citoyenneté danoise. Cependant, cette dépendance institutionnelle n’a jamais effacé l’importance stratégique de cette île immense, dont la position entre l’Amérique et l’Europe attire l’attention des grandes puissances.
L’idée d’un Groenland américain ne date pas d’hier. Sous la présidence d’Andrew Johnson, dès les années 1860, Washington s’intéressait déjà à l’acquisition de ce territoire nordique. M. Trump lui-même n’en est pas à sa première tentative. En 2019, lors de son premier mandat, il avait déjà évoqué l’achat de l’île, une suggestion qui, à l’époque, suscita plus de moqueries que d’intérêt sérieux. Pourtant, l’annulation d’une visite au Danemark, provoquée par le refus net du Premier ministre danois, Mme Frederiksen, montrait bien que le président américain prenait l’affaire à cœur [6].
Aujourd’hui, le contexte a changé. Cette fois, Copenhague ne se contente pas d’une fin de non-recevoir. Prenant au sérieux la réitération de cette ambition américaine, le gouvernement danois a annoncé un renforcement substantiel de ses capacités de défense au Groenland. M. Troels Lund Poulsen, ministre de la Défense, a détaillé un plan ambitieux : acquisition de navires d’inspection, déploiement de drones à longue portée, et augmentation des forces arctiques, y compris les fameux traîneaux à chiens qui symbolisent l’adaptation au rude climat groenlandais. On prévoit même de moderniser l’un des principaux aéroports de l’île pour accueillir des chasseurs F-35, ces instruments modernes de dissuasion [7].
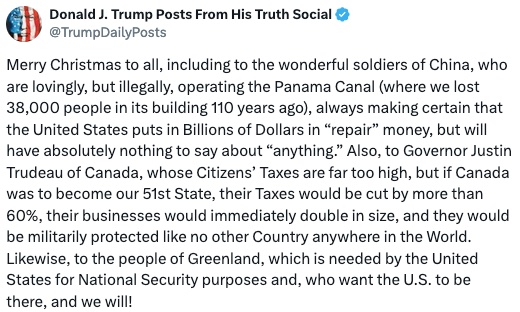
« Joyeux Noël à tous, y compris aux merveilleux soldats chinois qui exploitent avec amour mais illégalement le canal de Panama […] et qui s’assurent toujours que les États-Unis investissent des milliards de dollars en argent de "réparation", mais n’auront absolument rien à dire sur "quoi que ce soit". Aussi, au gouverneur Justin Trudeau du Canada, dont les impôts des citoyens sont beaucoup trop élevés, mais si le Canada devait devenir notre 51e État, leurs impôts seraient réduits de plus de 60 %, leurs entreprises doubleraient immédiatement de taille et ils seraient militairement protégés comme aucun autre pays au monde. De même, aux habitants du Groenland, dont les États-Unis ont besoin à des fins de sécurité nationale et qui souhaitent que les États-Unis soient là, et nous le seront. »
Le jour de Noël, cette période bénie où les hommes sont censés se tourner vers la réconciliation, voilà que le président Trump, dans sa constance, ne pouvait s’empêcher de livrer une nouvelle tirade sous la forme d’un tweet dévastateur. Dans un excès de verbe, il souhait un Joyeux Noël aux « merveilleux soldats chinois qui exploitent avec amour illégalement le canal de Panama ». Ensuite, dans un élan provocateur, Trump tourna son regard vers le nord et apostropha Justin Trudeau, qu’il réduisit à la fonction de « gouverneur » d’une province canadienne. Avec une désinvolture teintée de condescendance, il l’exhorta à réfléchir sérieusement aux bienfaits qu’apporterait une adhésion du Canada comme 51e État de l’Union. Pour conclure cette étrange missive, il rappela – avec le ton martial qui le caractérise – que le Groenland demeurait une priorité absolue pour « la sécurité nationale » des États-Unis.
Ces propos, qui auraient pu figurer dans une lettre adressée au père Noël, ne manqueraient pas de secouer les fondements de la diplomatie internationale et de nourrir les discussions des chroniqueurs du monde entier. Notons toutefois l’absence singulière d’une référence aux narcotrafiquants mexicains dans cette envolée de Noël. Était-ce un oubli ? Une distraction provoquée par les plaisirs de la fête ? Ou bien le signe qu’il préférait, pour une fois, épargner ses voisins du sud de ses habituelles invectives ?
Retour du « Grand Jeu » ou bluffs mesurés ?

Donald Trump ne s’est pas encore installé dans le Bureau ovale qu’il paraît déjà nourrir des ambitions d’expansion territoriale des États-Unis, qui, si elles devaient advenir, seraient comparables sans doute aux grandes acquisitions historiques de la nation, telles que l’achat de la Louisiane à la France ou l’accord ayant permis d’arracher l’Alaska à la Russie.
L’expansionnisme soudain que l’on prête à Donald Trump intrigue et déconcerte. Cet homme, qui n’a cessé de vilipender les aventures impériales de ses prédécesseurs, se serait-il converti à une politique qu’il avait autrefois méprisée ? L’invasion de l’Irak par George W. Bush, dénoncée avec véhémence, ou encore les errements de la guerre du Vietnam, dont il se tint prudemment à distance, semblent aujourd’hui des vestiges d’une critique qu’il aurait remisée. Pourtant, n’est-ce pas lui qui, à la fin de son mandat, se targuait de n’avoir engagé les États-Unis dans aucune nouvelle guerre ? Le voilà désormais suspecté de vouloir déplacer ses pièces sur l’échiquier mondial avec une hardiesse nouvelle. Mais quel jeu joue-t-il, au juste ? Aurions-nous mal compris le sens de son slogan de campagne « Make America Great Again » ?
Certains analystes comparent la situation présente au « Grand Jeu » impérialiste du XIXe siècle. Ce terme fait référence à la lutte stratégique entre les puissances impérialistes britanniques et russes au XIXe siècle, qui s’est concentrée sur l’extension de leurs sphères d’influence en Asie centrale. Ce jeu géopolitique visait à prendre possession de territoires clés afin d’assurer la domination économique, militaire et politique. L’un des grands principes du Grand Jeu était l’absence de respect pour la souveraineté des nations impliquées. Les puissances européennes de l’époque cherchaient à imposer leur contrôle sur des territoires, souvent par des moyens violents ou coercitifs.
Parmi les tenants de cette hypothèse, nous trouvons par exemple Brett Bruen, ancien directeur de l’engagement mondial à la Maison-Blanche de Barack Obama. Il s’étonne qu’au XXIe siècle, des puissances mondiales essayent encore de prendre, que ce soit par la force ou la pression, des territoires à d’autres pays. En Europe de l’Est, la Russie de Vladimir Poutine a déjà annexé quatre régions ukrainiennes et il est possible que d’autres les rejoignent prochainement. Le Proche-Orient semble suivre une dynamique similaire. Il est possible que dans un avenir plus au moins proche, la Turquie et Israël étendent également leurs territoires respectifs sur les ruines encore fumantes de la Syrie. Tandis qu’en Asie, la Chine cherche elle aussi à s’emparer de vastes étendues de la mer de Chine méridionale et a Taïwan en ligne de mire. Face à cette configuration, les États-Unis chercheraient-ils eux-aussi à avancer leurs pions, même si cela doit se faire au détriment de leurs propres alliées ?
L’intention déclarée de Donald Trump de classer les cartels de la drogue comme « organisations terroristes étrangères » suscite une appréhension légitime au sein du gouvernement mexicain. Ce geste, loin d’être anodin, s’inscrit dans une logique familière de la politique américaine, où la désignation d’un ennemi sous le sceau infamant de « terroriste » ouvre souvent la voie à une intervention armée. L’histoire récente en offre des exemples abondants, et il n’est pas besoin d’une sagacité exceptionnelle pour déceler dans cette stratégie une constante : les nations ainsi visées se trouvent presque toujours, par un hasard troublant, riches en ressources naturelles ou stratégiques.
Ainsi, en établissant une équivalence hasardeuse entre les barons de la drogue mexicains et les combattants fanatiques de Daech, Washington s’arroge le droit de projeter sa puissance militaire au sud du Rio Grande, comme il l’avait fait dans les montagnes de l’Afghanistan ou les plaines ravagées de la Syrie. Une fois encore, la bannière de la lutte contre le mal sert de prétexte à l’interventionnisme, masquant à peine la volonté de domination.
Mais ce n’est pas seulement une violation de souveraineté qui se dessine à l’horizon ; c’est aussi un écho historique aux tragédies du passé. Les narcotrafiquants, dans leur rôle d’antagonistes modernes, rappellent involontairement les colons anglo-saxons des années 1820, venus s’installer au Texas, alors territoire mexicain. Ce chapitre tragique de l’histoire illustre une constante : le Mexique, faible politiquement mais riche en territoires et en ressources, n’a jamais cessé d’être perçu comme une proie par son puissant voisin du nord.
En 1836, après une rébellion fomentée sous le prétexte de droits bafoués, les colons texans proclamèrent leur indépendance, une première étape vers l’annexion orchestrée par Washington en 1845. La suite est connue : une guerre brutale, un déferlement de troupes américaines sur le nord du Mexique, la prise de Mexico, et enfin l’humiliation du traité de Guadalupe Hidalgo en 1848. Ce dernier arracha au Mexique près de la moitié de son territoire, un espace immense où s’élèvent aujourd’hui des États comme la Californie, l’Arizona et le Nouveau-Mexique.
Cette annexion, perçue aux États-Unis comme un triomphe de l’expansion nationale, reste pour le Mexique une plaie béante, symbole d’une spoliation impérialiste. Et dans cette dynamique de conquête, les frontières cessent d’être des lignes inviolables pour devenir des zones de pression, des lieux où s’affrontent les ambitions et les injustices.
En somme, les ambitions américaines vis-à-vis des cartels ne peuvent être détachées de ce passé colonial, où chaque action dissimule un projet plus vaste. La guerre contre la drogue, sous ses oripeaux de croisade morale, pourrait bien n’être qu’un nouvel épisode du même jeu de domination, où le Mexique, une fois de plus, serait la victime désignée.
N’oublions pas que les États-Unis ont déjà envahi le Panama en 1989, non seulement pour renverser le dictateur militaire Manuel Noriega, accusé de trafic de drogue, mais aussi, sous prétexte de défendre les intérêts vitaux de la nation américaine. Le président George H. W. Bush, dans une de ses allocutions, justifiait cette agression en évoquant la nécessité de « protéger la vie des Américains », de restaurer une « démocratie » qu’ils jugeaient dévoyée, d’amener Noriega devant la justice, et, bien sûr, de « garantir l’intégrité des traités du canal de Panama ».
Dans l’histoire des États-Unis, l’idée même d’acheter des territoires étrangers s’inscrit comme une constante dans la logique expansionniste qui fonde la nation. Si l’on se remémore l’acquisition de la Louisiane sous le président Jefferson ou celle de l’Alaska sous Andrew Jackson, il est cependant moins connu que ce dernier nourrissait l’ambition d’acquérir un autre territoire, bien plus lointain et mystérieux : le Groenland. Bien que cette proposition ne sût jamais aboutir, elle n’en demeure pas moins emblématique de cette volonté américaine d’étendre ses frontières, non pas en se contentant de terres voisines, mais en jetant son regard avide sur des terres au cœur de l’Arctique.
Andrew Jackson, qui succéda à Abraham Lincoln après la guerre de Sécession, régna dans un climat de reconstruction intérieure, entre réconciliation nationale et tensions politiques avec le Congrès. Cependant, au-delà des déchirements domestiques, il sut poursuivre l’héritage de l’expansionnisme américain, avec la même ferveur qui avait guidé les Pères fondateurs. En 1867, il orchestre l’achat de l’Alaska, une transaction qui, pour la somme de 7,2 millions de dollars, permet aux États-Unis de s’approprier un territoire immense, vierge de toute importance immédiate mais riche de promesses économiques et stratégiques. Cette vision, qui mêle pragmatisme et rêve impérial, ne s’arrête pas là : dans son esprit, un autre joyau géographique s’ouvre à la convoitise.
Le Groenland, alors sous la souveraineté du Danemark, apparaissait comme un objet de désir de plus en plus tangible. Si l’île restait largement ignorée des contemporains, sa position géographique unique, à l’interface des océans Atlantique et Arctique, suffisait à éveiller l’intérêt des stratèges. Ce morceau de terre glacée, perçu alors comme une terra incognita, cachait sous ses couches de glace des ressources naturelles inestimables et un rôle géopolitique qui n’avait pas encore été pleinement compris.
Depuis lors, l’importance du Groenland sur l’échiquier géopolitique mondial n’a cessé de croître, tout comme les convoitises qu’elle suscite. L’île, avec ses ressources minérales et son rôle crucial dans la géopolitique arctique, devient un enjeu stratégique majeur. Situé à la croisée de l’Atlantique Nord et de l’Arctique, le Groenland se trouve sur la route des échanges maritimes entre l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Asie. Le réchauffement climatique rend en outre les voies maritimes arctiques, comme le passage du Nord-Ouest, de plus en plus accessibles, renforçant ainsi la position géostratégique de l’île. Son sous-sol regorge de minerais essentiels, tels que les terres rares, l’uranium, l’or, le zinc et le fer, indispensables aux industries de haute technologie et énergétiques. De plus, des réserves potentielles de pétrole et de gaz attendent leur exploitation, bien que des défis environnementaux et climatiques compliquent leur extraction. C’est dans ce contexte que Trump, toujours soucieux de contrer l’influence croissante de la Chine dans cette région stratégique, nourrit un regain d’intérêt pour l’île. À moins que ce soit le désir d’accomplir le rêve resté inachevé d’Andrew Jackson, le président qui – à en croire Thierry Meyssan – inspirerait le plus la politique de Donald Trump [8].
D’aucuns imaginent une conversion subite à l’expansionnisme belliqueux, mais cette lecture serait trop simple. Nul ne saurait sérieusement penser que l’Amérique, sous l’impulsion de Donald Trump, cherche à en découdre militairement avec le Canada, le Mexique, le Danemark ou le Panama. Il faut voir dans ces gesticulations, non pas les prémices d’une croisade militaire, mais un art consommé du bluff, un stratagème inspiré davantage par les salles de conseil d’administration que par les salles d’état-major. Car Trump, en dépit de ses foucades, reste fidèle à lui-même : un homme d’affaires plus qu’un stratège militaire, un marchand d’effets plus qu’un conquérant de territoires.
Les défenseurs de Trump insistent sur le fait que de telles demandes surprises confèrent un avantage diplomatique aux États-Unis, précisément parce qu’elles bouleversent les attentes et les normes diplomatiques [9]. Les bruits de sabre de cet ancien homme d’affaire au Panama et les projets annoncés d’une « invasion douce » du Mexique, ne sont en réalité qu’une tactique visant à perturber le statu quo et à améliorer la position de négociation de la Maison-Blanche. Même chose concernant la proposition d’achat du Groenland et l’idée saugrenue d’absorber le Canada. Toutes ces déclarations à l’emporte-pièce s’inscrivent dans une manœuvre subtile, mélange de bluff calculé et d’intimidation stratégique, destinée à désarçonner ses alliés et à engranger des succès diplomatiques moins éclatants mais non moins significatifs. Trump rechercherait ainsi un effet de levier dans le cadre de « l’art du deal » – et que l’ancienne star de télé-réalité fait la une des journaux pour paraître forte dans son pays et à l’étranger.
Prenons le cas du canal de Panama. L’accusation selon laquelle les navires américains y seraient spoliés relève davantage de la fable que du fait avéré. Comme l’a souligné le comité de rédaction du Wall Street Journal – rien de moins que la citadelle du libéralisme économique et certainement pas un bastion de de l’antitrumpisme –, la mécanique des tarifs, calculée avec une rigueur implacable selon le tonnage et le type de navires, ne laisse aucune place à l’arbitraire [10].
Cette intervention soudaine, presque théâtrale, dans les affaires du canal surprend par son caractère inattendu. Car enfin, ce n’est point là un sujet que le président Trump avait jugé bon d’évoquer au cours de ses diatribes électorales. Un mystère donc, si l’on ne savait que cet homme, aux impulsions changeantes, accorde volontiers audience à toute plainte portée par des courtisans, amis ou nouveaux venus, pourvu qu’elle alimente ses desseins. À Mar-a-Lago, entre les fastes de Palm Beach et les conciliabules feutrés, il ne cesse d’accueillir industriels, donateurs et dignitaires étrangers [11].
Mais quelle est la vérité de cette affaire ? Trump, cet homme habitué aux négociations rugueuses des gratte-ciels new-yorkais, serait-il mal informé ? Aurait-il été flatté ou pressé par quelque puissant contributeur ? Peut-être. Mais peut-être aussi assiste-t-on ici à une mise en scène habile, une diversion digne d’un grand stratège. Ce n’est pas le canal lui-même, ni ses tarifs, qui semblent être l’enjeu. Ces griefs contre le Panama ne seraient-ils pas un levier, un simple prétexte masquant des ambitions plus vastes ?
L’on pourrait imaginer, sous cette lumière, que le président américain cherche à éloigner le Panama de l’orbite chinoise. Car cette Chine, patient tisseur de soies modernes, accroît chaque jour son emprise sur les routes du commerce, et le canal de Panama n’en est pas exempt. Une autre hypothèse, non moins plausible, serait celle d’une demande de tarifs préférentiels pour les navires battant pavillon américain, ce qui, à terme, permettrait d’atténuer l’impact des taxes douanières qu’il entend imposer aux produits étrangers, notamment chinois.
Donald Trump, dans sa posture de tribun volontariste, semble vouloir renouer avec une tradition américaine : celle d’imposer la loi par la force, quitte à mépriser les équilibres fragiles du voisinage. La question des cartels mexicains, qu’il aspire désormais à qualifier d’organisations terroristes, est au cœur d’un bras de fer qui ne date pas d’hier. Déjà lors de son premier mandat, face à une crise nationale marquée par une hécatombe d’overdoses, Trump avait envisagé cette désignation, non comme un simple geste symbolique, mais comme une étape vers une intervention plus directe.
À l’époque, l’Amérique enterrait chaque année plus de 70 000 victimes d’overdoses, les deux tiers imputables aux opioïdes synthétiques, avec le fentanyl en sinistre figure de proue [12]. En réaction, Trump, fidèle à son style, proposa une solution radicale : inscrire les cartels mexicains sur la liste noire du terrorisme mondial. Mais cette ambition fut contenue par les pressions conjuguées de son homologue mexicain, Andrés Manuel López Obrador, et des conseillers américains inquiets de l’impact sur les relations bilatérales. Obrador, dans une posture d’orgueil national tempéré par le pragmatisme, rejeta catégoriquement toute intervention militaire étrangère, préférant mettre en avant une coopération accrue entre les deux nations [13].
Cependant, cette coopération n’eut guère l’effet escompté. Sous l’administration Trump (2017-2021), les décès liés aux opioïdes synthétiques doublèrent, et la crise du fentanyl s’aggrava. Ce bilan, lourd de reproches implicites, réapparut avec acuité dans la campagne présidentielle de 2024. Le retour de Trump à la Maison-Blanche marque une rupture nette avec les tentatives, jugées timorées, de son premier mandat. Cette fois, le pragmatisme cède le pas à une approche martiale, portée par l’idée que seule la force peut briser les rouages du narcotrafic.
La tragédie du fentanyl, ce fléau qui s’insinue comme un poison dans les veines de l’Amérique, a servi de pierre angulaire à la campagne présidentielle de Donald Trump en 2024. De retour au pouvoir, le tribun populiste laisse entrevoir une rupture nette avec les approches diplomatiques hésitantes du passé. L’heure, selon lui, n’est plus aux palabres inutiles, mais à une main de fer. Une leçon amère semble avoir été retenue de 2019, lorsque Trump, dans un élan de confiance, s’en remit à la bonne volonté de son homologue mexicain, Andrés Manuel López Obrador. Le président mexicain, avec une rhétorique empreinte d’un nationalisme sourcilleux, avait alors promis que la coopération bilatérale suffirait à étouffer le commerce funeste des stupéfiants.
Mais la réalité s’est montrée autrement cruelle. Les mécanismes bien huilés de la collaboration sécuritaire entre les deux pays, forgés au fil de deux décennies d’une guerre sans fin contre les cartels, se sont grippés sous le mandat de López Obrador. Ce leader charismatique, jouant des cordes sensibles d’un Mexique jaloux de sa souveraineté, dénonça l’unilatéralisme américain, osant même avancer que son pays n’était pas responsable de la production de fentanyl [14].
Aujourd’hui, le décor a changé. Claudia Sheinbaum, succédant à López Obrador, a pris les rênes d’un Mexique qui vacille entre la nécessité de coopérer et l’impératif de défendre son honneur national. Trump, quant à lui, ne semble guère disposé à répéter les erreurs du passé. En qualifiant les cartels de narcotrafiquants d’« organisations terroristes », il s’octroie une latitude stratégique inquiétante. Le message est clair : si le Mexique faiblit, Washington n’hésitera pas à intervenir directement, faisant fi des conventions diplomatiques et des frontières sacrées.
Face à cet ultimatum voilé, la présidente Sheinbaum n’a eu d’autre choix que d’adopter une double stratégie. Comme le veulent les traditions d’usage, elle a appelé à une coopération étroite entre les deux nations pour endiguer le fléau du trafic de drogue. Ensuite, comme le veut l’étiquette diplomatique, elle a rappelé que le Mexique ne saurait devenir un vassal des États-Unis [15]. La souveraineté oscille ici entre la nécessité d’une soumission implicite et l’illusion d’un contrôle indépendant.
Cependant, les gestes valent souvent mieux que les discours. Soucieuse de montrer sa détermination, l’administration mexicaine n’a pas tardé à agir. À Sinaloa, haut lieu du narcotrafic, les autorités ont récemment saisi la plus importante cargaison de fentanyl jamais interceptée. Un coup d’éclat destiné autant à frapper les cartels qu’à répondre à l’injonction américaine.
Le cas du Groenland est plus complexe, à cause notamment de l’appartenance du Danemark à l’OTAN. Le major Steen Kjaergaard, de l’Académie danoise de défense, avance l’idée que Trump chercherait à exercer une pression subtile sur Copenhague, afin de l’inciter à renforcer la défense de ses côtes arctiques. Les États-Unis jugent les efforts danois en la matière insuffisants et risquent de prendre des mesures pour pallier ces manquements, avec des arrière-pensées bien précises. L’objectif ultime demeure la préservation de ces eaux stratégiques contre les ambitions toujours plus pressantes de la Russie et de la Chine.
À cet égard, les déclarations de Donald Trump concernant le Groenland, qu’elles aient été formulées dans l’enthousiasme d’un projet ou dans le calcul d’un pragmatisme politique, semblent aujourd’hui porter leurs fruits. En effet, le plan d’investissement récemment annoncé par le Danemark, visant à renforcer sa présence et son contrôle sur les territoires arctiques, ne peut que laisser entrevoir les répercussions de ces propos. « Nous n’avons pas investi suffisamment dans l’Arctique depuis de nombreuses années », a admis le ministre de la Défense danois, conscient de la tardiveté de son engagement. « Nous prévoyons désormais d’y renforcer notre présence », a-t-il ajouté, sans toutefois fournir de chiffres exacts. Les estimations des médias danois, cependant, suggèrent que l’investissement se chiffrera autour de 12 à 15 milliards de couronnes – soit environ 1,5 milliard d’euros. Ce réengagement, selon le ministre, n’a rien à voir avec les critiques formulées de l’autre côté de l’Atlantique ; il s’agirait, selon ses mots, d’une « ironie du sort » [16].
Pourtant, il serait bien naïf de croire que la temporalité de ce redéploiement de ressources ne soit pas en parfaite synchronie avec les remarques de Trump, tant la cohérence de l’action danoise avec les attentes implicites des États-Unis semble évidente. Il n’est nul besoin de décryptage politique pour constater que Copenhague, dans sa sagesse tactique, n’a guère échappé au message qu’on lui adressait. Loin de toute pure coïncidence, cette démarche s’inscrit dans la logique d’une pression invisible, mais bien réelle, exercée à travers les discours de ceux qui comprennent mieux que d’autres le jeu géopolitique en cours.
Le coup de semonce lancé au Danemark, en dépit de son apparente singularité, pourrait bien résonner comme un avertissement adressé à l’ensemble des nations membres de l’OTAN. Selon les révélations du Financial Times, les envoyés de Trump auraient signifié aux dirigeants européens que l’Amérique, sous son président actuel, exigerait que tous les membres de l’Alliance atlantique portent leurs dépenses de défense à 5 % de leur PIB [17]. Une telle exigence, d’apparence impérative, jette une lumière crue sur l’écart entre les aspirations de Washington et les réalités budgétaires des alliés.
En effet, aucun membre de l’OTAN, pas même les États-Unis, ne consacre aujourd’hui 5 % de son PIB à la défense. La Pologne, en figure de proue, frôle les 4 %, et les États-Unis eux-mêmes ne dépassent guère les 3,1 %. L’objectif fixé par l’Alliance, qui s’établit à 2 %, reste un horizon que vingt-trois des trente-deux membres parviennent à atteindre [18].
En soi, le chiffre de 5 % semble davantage une manœuvre de négociation qu’une exigence réalisable. Car, à moins de s’engager dans un conflit d’une ampleur cataclysmique, il paraît illusoire d’espérer que les États-Unis parviennent un jour à ce seuil, surtout si l’on considère la politique fiscale de Trump, qui, en gonflant le déficit fédéral, ne fera qu’alimenter l’hésitation du Congrès à augmenter encore les dépenses de défense de 300 milliards de dollars par an.
Enfin, la proposition d’intégrer le Canada dans l’Union des États-Unis relève à première vue du pur grotesque. Cet épisode découle d’une autre provocation de Trump, beaucoup plus sérieuse. Sur le plateau de Meet the Press, le tribun américain esquissait avec la flamboyance d’un bateleur son dessein économique : l’imposition de tarifs douaniers sur le Canada et le Mexique, une panacée qui ouvrirait la voie à une prospérité retrouvée pour l’Amérique. Et d’ajouter, dans une rhétorique brutale, presque impériale : « Nous subventionnons le Canada à hauteur de plus de cent milliards de dollars par an. Quant au Mexique, c’est près de trois cents milliards qui disparaissent comme par enchantement. Pourquoi donc continuer à entretenir ces nations ? Si nous devons les subventionner, autant les annexer comme États de l’Union. » [19]
À bien des égards, cette stratégie a produit le résultat escompté : les dirigeants des deux pays ont immédiatement cherché une audience avec Trump pour réaffirmer leur engagement à aider les États-Unis sur les questions frontalières. Et cela a fourni à Trump un premier moyen de revendiquer la victoire sur une cible étrangère [20].
Conclusion
À l’heure où Donald Trump s’apprête à reprendre les rênes de la Maison-Blanche, c’est un vent d’insolence et de provocation calculée qui souffle sur la scène politique mondiale. Ce tribun au verbe imprévisible, véritable virtuose de l’outrance, déploie une méthode qui déconcerte autant qu’elle fascine. Chaque déclaration, qu’il s’agisse d’un projet chimérique d’acquisition du Groenland, d’une ambition déclarée sur le canal de Panama, d’une croisade directe contre les cartels mexicains, ou encore de l’annexion fantasque du Canada, semble d’abord une boutade jetée à la cantonade. Mais à y regarder de plus près, ces éclats s’ordonnent en une stratégie bien plus redoutable qu’il n’y paraît.
Trump, plus que tout autre, a compris que la politique internationale est un théâtre où les acteurs les plus bruyants captent toute la lumière. Ses mouvements ne sont pas des élans désordonnés, mais les pièces d’un échiquier où il s’arroge le privilège de redéfinir les règles. Ce n’est pas une conquête au sens classique, mais une perturbation méthodique : détruire l’ancien pour asseoir un ordre nouveau, où l’Amérique règne non par ses alliances, mais par la force brute de ses coups de poker. Le déséquilibre qu’il provoque est son arme, et l’imprévisibilité, son plus grand atout.
Cependant, à trop vouloir s’affranchir des cadres établis, Trump pourrait bien miner les fondements mêmes de la puissance américaine. Car si l’Amérique a su, au fil des décennies, imposer son hégémonie, ce fut autant par ses alliances patiemment tissées que par sa force économique et militaire. Ces alliances, loin d’être de simples ornements diplomatiques, ont constitué le levier par lequel elle a multiplié son influence. Or, en brisant ces liens ou en jetant l’opprobre sur ses partenaires, Trump risque de transformer cette force collective en un empire isolé, livré aux caprices d’un monde qu’il aura lui-même contribué à fragmenter.
La méthode trumpienne, ce mélange d’audace et de ruse, où l’exagération n’est jamais qu’une arme, et l’outrance une façon d’exprimer un rapport de force, se révèle efficace lorsqu’elle s’applique à des États déjà affaiblis ou sous la férule d’un ordre américain bien établi. Pourtant, le monde d’aujourd’hui, marqué par la montée d’une Chine déterminée et résolue, impose au nouveau maître de la Maison-Blanche une posture plus souple, plus calculée. La Chine, tissant patiemment ses alliances avec Moscou, Téhéran ou Pyongyang, déploie une stratégie minutieuse pour affaiblir l’hégémonie occidentale. Et, plus inquiétant encore, elle séduit des puissances pivot comme le Brésil, l’Inde ou l’Arabie saoudite, ouvrant ainsi la voie à une recomposition de l’ordre mondial où l’Amérique pourrait bien perdre son rôle central.
Le second mandat de Trump se trouve confronté à des défis nouveaux, nécessitant de sa part plus de flexibilité et une recherche du compromis plutôt que de la confrontation. Qui mieux qu’un ancien promoteur immobilier new-yorkais pour se frotter à une tâche aussi complexe ! D’autant que l’homme qui pénètre à nouveau le Bureau ovale n’est plus celui qui en avait franchi la porte la première fois. Nous avons toutes les raisons de croire que son pragmatisme originel, déjà affûté par le temps et les épreuves, s’est métamorphosé en une maîtrise du pouvoir, où chaque geste est calculé et chaque décision mesurée avec une habileté qui n’a d’égale que son appétit d’action.
L’Histoire, implacable et silencieuse, se tiendra en juge. Quelle direction l’Amérique de Trump souhaite-t-elle réellement prendre ? Est-ce celle d’une puissance retrouvée, capable de réinventer son rôle dans un monde multipolaire, ou celle d’un empire en quête de grandeur passée, prêt à en payer le prix ? Car si l’élu républicain gouverne une Amérique toujours forte, cette dernière se trouve désormais bousculée par les tempêtes d’un monde en pleine mutation. Le président élu devra apprendre à partager les océans qu’il dominait seul autrefois avec des flottes puissantes, égales à lui en force. Il devra aussi composer avec un État profond, bien qu’affaibli, toujours en place, un ennemi intérieur toujours prêt à déclencher la mutinerie ou à entraver la marche de son capitaine dès que l’opportunité se présente.
Face à ces défis, la question essentielle demeure : l’audace trumpienne, saluée par ses partisans et redoutée par ses ennemis, conduira-t-elle l’Amérique vers de nouveaux sommets ou précipitera-t-elle sa chute dans les abîmes de son propre excès ?
À ce stade, une seule réponse s’impose : rendez-vous dans quatre ans !













 et
et  !
!






