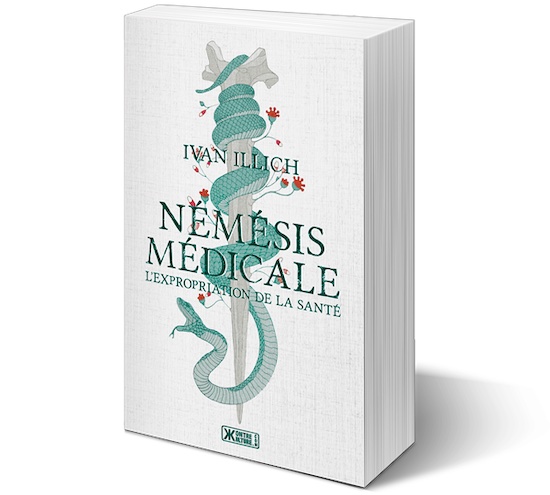Nous trimballons notre carcasse partout avec nous. Il faut bien la nourrir, la vidanger, la déplacer, la faire dormir. Notre esprit aussi a sa nécessaire intendance : comprendre, mémoriser, être écouté, se faire comprendre en retour. Négocier nos émotions, nos incapacités, affronter nos peur, camoufler notre honte. Tant de matière à mauvaise santé ! Et encore, si ce n’était que ça ! Tout est occasion à symptômes motivant la visite chez le médecin : je ne digère plus le lait, je suis constipé, ma hanche est bloquée, je ne dors plus. Mon fils est hyperactif, ma fille est exclue, mon dernier a le trac, mon père est confus. Pas si facile pour la médecine de soutenir la gageure de tant de disparité. Mais si tout impacte bien notre santé, tout n’est pas pour autant directement du ressort de la médecine.
Les circonstances de notre mort
Poser le problème à sa racine revient à poser la très pragmatique question de la liste des circonstances de la souffrance, de la maladie et de la mort. Mourir de faim ou de soif. De mauvais traitements, de solitude, de manque d’amour, comme les orphelins des établissements roumains sous Ceausescu. De blessure, brûlure, morsure ou accidents divers. Mourir à la guerre, lors d’attentats ou de catastrophes naturelles. Mourir de maladie bien sûr, épidémie ou drame personnel. À chaque circonstance, son risque potentiel. C’est bien le problème de notre incarnation : notre véhicule est consubstantiel à n’importe quel autre aspect de notre vie. Ainsi son entretien est-il nécessaire pour empêcher ou retarder les occasions de passer de vie à trépas. Le verso de cette interrogation est la non moins pragmatique question : qu’est-ce qui peut le mieux préserver notre santé ou nous guérir ?
Protéger la vie est un sujet aux ramifications tentaculaires, ramené systématiquement et un peu trop vite dans le giron médical. Peut-être pour montrer le doigt et cacher la Lune. Toujours est-il qu’il existe beaucoup de confusion dans l’idée que nous nous faisons de la médecine et des catégories qui la composent. Les attentes sur son spectre d’action sont sans doute aussi disproportionnées. Car si tout se termine bien dans le cabinet du médecin ou à l’hôpital, il faut cependant distinguer ce qui est du ressort de l’art médical strict, de ses nombreuses annexes. Bien d’autres acteurs de santé ou de maladie, certains collectifs d’autres individuels, s’invitent en effet dans la partie en ne disant pas leur nom.
Au niveau collectif, le contexte économique, politique et militaire a des conséquences immédiates visibles, qu’ils s’agissent de morts sur un champ de bataille, ou de licenciés d’une région sinistrée. Par les temps qui courent, une politique de santé publique réaliste, et non seulement idéaliste, aurait intérêt à anticiper l’intégration de facteurs comme la guerre ou la pauvreté dans son action. D’autant plus quand les répercutions en cascade se font immanquablement sentir pendant longtemps, avec au menu : déplacement de populations, dégradation ou manque d’accès aux services sanitaires et sociaux, risques accrus en tous genres et autres joyeusetés. De ce point de vue, nous quittons la médecine au sens strict au profit de la gestion d’un matériel humain déclassé, confié à des professionnels de santé – peut-être d’ailleurs eux-mêmes tout autant désorientés – qui feront comme ils pourront avec des restrictions de budget. Un certain nombre d’autres adjuvants, environnemental, socio-professionnel ou relationnel plus ou moins graves, réussissent également très bien à perturber notre corps et notre esprit, entre pollutions diverses, travail de nuit et harcèlement, stress ou addictions. Des sujets d’origine extra-médicale mais qui transiteront forcément par des prises en charge médicales.
Les conditions de notre guérison
Le champ du soin est si large, si présent dans nos vies qu’il est difficile pour le grand public de s’y retrouver. La médecine est en effet souvent confondue avec les soins médicaux et paramédicaux au sens large. Or le quotidien de la médecine est fait de gestes de routines ne requérant pas de longues formations. En son temps Ivan Illich avait dénoncé une professionnalisation inutile et coûteuse de gestes autrefois effectués au sein des familles [1]. Aujourd’hui, tout le monde sait que de nombreuses aides-soignantes font souvent le travail des infirmières, occupées elles-mêmes à faire parfois le travail du médecin. Que ce soit de mauvaise grâce par manque de personnel, ou par adhésion pour valorisation personnelle, nous pouvons faire le constat d’un savoir-faire qui s’acquiert par le compagnonnage et la pratique, en dehors des bancs de la faculté.
Autre exemple, l’histoire rocambolesque d’une analphabète éthiopienne, vendue, abandonnée exsangue à 14 ans, bébé mort dans son ventre, sauvée de justesse par une opération délicate à l’hôpital de la fistule à Addis-Abeba, et qui, à force d’aider le personnel soignant pour s’occuper, finit aide-soignante en chef de ce même hôpital [2]. Le versant technique de la médecine nécessite donc plus des techniciens bien formés que des médecins. C’est d’ailleurs la recherche d’un savoir-faire technique particulier qui a conduit Alexis Carrel, prix Nobel de médecine en 1912 à prendre des cours auprès d’une brodeuse – qui n’avait pas le certificat d’étude – afin de perfectionner sa technique de suture des vaisseaux sanguins. Tout le secteur de la réhabilitation, de la chirurgie réparatrice est très spécialisé lui aussi et demande beaucoup de compétence. Mais il s’agit également de gestes techniques d’artisan, bien plus que de compréhension fonctionnelle des interactions entre organes défaillants. Ainsi, pour une meilleure compréhension de l’essence de la médecine, il nous faut exclure les domaines purement techniques, chirurgicaux ou de rééducation, indépendamment du fait qu’ils sont hautement utiles. La médecine n’est pas la technique, et d’ailleurs plus elle est technicienne, plus elle est critiquée.
La gestion de ma santé personnelle
La santé est aussi – en partie – de notre responsabilité. Comme un peintre est limité dans son art par un pinceau durci ayant perdu la moitié de ses poils, nous ne rendons pas la tâche aisée à notre médecin si nous mangeons mal, buvons trop, le tout vautré dans notre canapé à enchaîner les séries Netflix. Laissant de côté l’idée complotiste qu’il y aurait là matière à conforter un projet de société qui nous dépasse, nous pouvons au moins tomber d’accord sur le fait qu’il est de notre responsabilité de s’extraire par un effort de volonté de ces conditions de vies délétères. Ainsi, en amont de la médecine se trouve l’hygiène vitale, soit les conditions minimales d’entretien de notre véhicule vital. Ce qu’on appelle l’éducation à la santé – au choix : activité physique, techniques respiratoires, réglage alimentaire et/ou jeûne intermittent – peuvent beaucoup pour assainir le terrain, équilibrer notre quotidien et augmenter notre vitalité. Il est possible à n’en pas douter d’améliorer sa santé par ces moyens. Mais jusqu’à un certain point seulement, et cela pour deux raisons.
Premièrement parce ce que la vie moderne rend malade. Pour employer une métaphore, si l’on peut toujours aménager son appartement, on ne peut malheureusement pas pousser les murs. Ce qui fait que nous restons plus ou moins constamment immergés dans ce bain de vie moderne. Les maladies de civilisation sont ainsi un thème incontournable et redondant de la communication sur la santé. Le sujet revient comme un serpent de mer depuis maintenant très, très longtemps. On y discute diabète, obésité, cancers, et aussi maladies auto-immunes : autisme, rhumatismes et Alzheimer. On ne compte plus les articles, les congrès et les rencontres autour de ce thème central, qui se terminent parfois avec une attention touchante par un apéritif-buffet sans gluten [3]. Comme on dit, « ça ne mange pas de pain » ! Malheureusement, cela ne règle pas le problème, qui a au contraire la fâcheuse tendance à s’aggraver. La seconde raison concerne la nature des maladies dites « chroniques ».
La nature des maladies aiguës et chroniques
Pour reprendre le thème des circonstances de notre mort abordé plus haut, une maladie aiguë est un risque pour la vie. Un épisode potentiellement mortel qui justifie le mot « urgence » et le service du même nom, dans la mesure où le corps peut « lâcher » et mourir. Mais il peut tout autant survivre par ses propres forces. C’est ici que votre entretien, vos efforts d’hygiène vitale vont payer, car un corps bien entretenu a plus de chance d’être à la hauteur d’une agression et la combattre efficacement. On peut en effet compter sur l’extraordinaire capacité de l’humain à surmonter ses problèmes de santé, même lorsqu’ils se présentent sous une forme extrême. Un organisme peut tout à fait combattre une grave infection sans autre support extérieur que sa propre vitalité. Hippocrate a appelé ce principe vis medicatrix naturae, le pouvoir guérisseur de la nature. Un principe banal que beaucoup ont pu constater chez eux lorsqu’ils étaient enfants : effectivement, il est des cas ou l’on guérit tout seul. Afin de ne pas tout mélanger, il faut bien faire la différence d’avec des urgences mécaniques capables de court-circuiter la réaction vitale du corps. En effet une artère sectionnée occasionnant une hémorragie importante ou un pneumothorax est incapable d’auto-guérison : la vitalité ne sait pas faire de points de sutures !
Mais pour en revenir aux maladies chroniques, aucune guérison « spontanée » n’est en revanche à espérer. La vitalité de son corps, augmentée par toutes les cures du monde, n’y pourra rien. Il est entendu que beaucoup de malades ont fait régresser leur maladie par des moyens naturels, amélioré considérablement leur quotidien et diminué leur douleur. C’est pourquoi il faut absolument encourager ces démarches d’autonomie, hors des sentiers battus, quand elles sont bien menées. Mais il faut rendre hommage à Samuel Hahnemann d’avoir étudié et compris la nature des maladies aiguës et chroniques et d’avoir pu établir leur différence de façon expérimentale [4].
« Les véritables maladies chroniques naturelles sont celles qui, laissées à elles-mêmes et non traitées par des moyens spécifiques, sont incessamment progressives. Celles qui malgré les meilleures précautions d’ordre moral et de soins physiques, tourmentent l’individu de souffrances toujours croissantes jusqu’au terme de son existence. »
Samuel Hahnemann
Ainsi une maladie chronique, au sens homéopathique comme au sens moderne, si elle n’est pas mortelle, ne guérit pas non plus toute seule, à la différence d’un épisode aigu. C’est sur ce fond chronique – indélébile sans moyen adéquat – que se surajoutent nos maladies de civilisation. Toute réforme personnelle, tout type de soin – gestion du stress ou exclusion du sucre – vont aider assurément. Ils limitent les poisons et donnent au corps plus d’énergie pour supporter ou cantonner la maladie chronique. Mais ces « meilleures précautions et soins physiques » n’éradiquent pas la maladie. La morale de l’histoire est que, si une maladie chronique ne peut pas guérir d’elle-même, ni par des moyens naturels, nous tenons là toute la justification d’une action médicale à mener, pour compenser ce que la seule vitalité du patient est incapable de faire. Le véritable art médical consisterait donc à être capable de guérir, non pas seulement d’un épisode aigu, mais bien d’une maladie chronique. Or c’est bien là où le bât blesse. Parce que les maladies chroniques sont justement définies par la médecine officielle contemporaine comme des maladies inguérissables, ou rarement curables. Aveu d’échec s’il en est, à l’endroit même où l’on aurait besoin que la médecine soit compétente. Les maladies chroniques inguérissables traitées par la médecine moderne ne guérissent donc pas. Elles empirent au contraire avec le temps, en demandant de plus en plus de doses de plus en plus rapprochées.
Le cœur du métier
Ainsi pour récapituler, il n’est pas juste de faire endosser à la médecine les conséquences de conditions extérieures à son art, comme une pollution chimique, un tissu professionnel dysfonctionnel, un conflit armé, ou une hygiène de vie déplorable. On pourrait également dégager la médecine de tout ce qui est extra-médical, technique et routinier. Mais l’on voudrait espérer un créneau essentiel où elle puisse exerce son art avec excellence. La noblesse du métier devrait résider dans les nombreux dysfonctionnements du corps et de l’esprit qu’il s’agirait de savoir décrypter et soigner. C’est-à-dire les maladies aiguës et les maladies chroniques. L’urgence est une médecine impressionnante, qui nécessite des interventions de haute intensité, précises, sur des maladies aiguës qui flambent, et à cause desquelles on risque de mourir. Il faut saluer ces coups d’éclat médicaux. Mais aussi héroïques et nécessaires qu’ils soient pour l’heureux malade qui en a bénéficié, cette médecine est relativement rare. Le vrai job, ingrat et redondant, c’est le tout-venant. Les douleurs, les gênes, les dysfonctions, les signes gérables mais constants qui limitent, qui empêchent ou obligent. Et qui s’aggravent avec le temps. Ces maladies non mortelles pour lesquelles la médecine contemporaine ne fait rien, faute de savoir quoi faire, sinon annoter « à surveiller » dans la marge, jusqu’au stade ou elle pourra proposer une action palliative ou une intervention. Ce manque béant d’expertise est la raison valable pour laquelle les malades s’essayent à tout type d’action et de thérapie, refusant en ce qui les concerne de baisser les bras. Certains ont le mauvais goût de le leur reprocher ou de les en empêcher au motif de les protéger des charlatans et des sectes. On dirait bien que le serpent se mord la queue !
Conclusion
Si tout fait maladie, tout n’est pas médecine. Notre drame est que la médecine la plus utile et la plus noble est en définitive le point le plus fragile de notre système de soin occidental. Ce n’est pourtant pas une découverte. Pendant longtemps, la critique essentielle de la médecine contemporaine reposait justement sur ses piètres résultats dans les maladies chroniques. Rien n’a changé en réalité, sinon un tour de passe-passe. L’establishment médical a simplement contourné la difficulté : les maladies chroniques sont maintenant présentées et enseignées comme des maladies non guérissables. Ainsi la critique est devenue obsolète par un trait de plume déclaratif, laissant en rade les malades. Face à ce constat, il est légitime de la part des patients de continuer à rechercher une médecine qui les guérisse de leurs maladies chroniques. Et peut-être – puisqu’il vaut mieux allumer une bougie que maudire l’obscurité – un devoir pour ceux qui la pratiquent de faire entendre leur voix.













 et
et  !
!