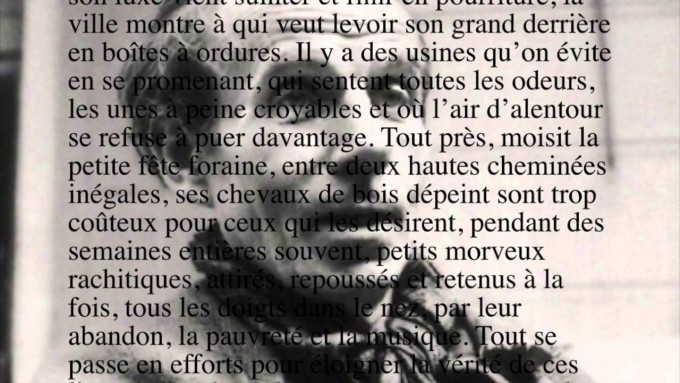Quand on a vu le titre de l’article sur Twitter, on a cru défaillir. France Culture, la radio du grand Finkielkraut, de la culture captive, de la propagande gauchiste, du groupe Radio France qui porte si mal son nom car il devrait s’appeler Radio Israël, voilà que France Cul nous sert un énorme sujet sur Céline, l’écrivain du début du XXe siècle qui a fait couler encore plus d’encre qu’il n’en a répandu lui-même. Et Dieu sait s’il a écrit, écrit, écrit...
Un jour peut-être France Culture chroniquera-t-elle Mort à Crédit, D’un Château l’autre, ou même Bagatelles pour un massacre. Cela prendra du temps, il faudra une espèce de grand remplacement dans les médias, qui en ont déjà subi un, en quelque sorte, car on en entend le résultat tous les jours.
En ce moment, c’est la pré-rentrée littéraire, les éditeurs fourbissent leurs auteurs, les taillent et les coiffent pour les télés, les radios, les interviewes presse, la grande exhibition d’automne. En général, on se coltine le 47e roman d’Amélie Nothomb, le chef d’œuvre de Jean d’Ormesson, le livre complexe de Modiano, toutes ces fanfreluches qui ne tiennent pas dans le temps. Du consommable, pas vraiment mal écrit, mals tellement lénifiant...
La littérature française, on le sait tous, a été impactée [1] par toutes les avancées du progressisme, si l’on ose dire : le gauchisme, le féminisme, le socialisme (rosacé), l’antiracisme, et maintenant le genrisme, et le résultat, ce sont des livres sans saveur, qui respectent la ligne éditoriale oligarchique, pas mieux ni pire que celle du Parti quand Staline terrorisait les masses et les intellectuels. Au moins leur donnait-il du boulot, à Moscou ou à Novossibirsk.
Pour vous dire la vérité, on a fait le tour des livres de la rentrée, et l’ensemble est très mignon, très bourgeois (même dans l’antisme), très convenu. La palme de la critique est attribuée à Frédéric Pagès du Canard enchaîné qui s’extasie sur un roman écrit en langage racaille. Dans le temps, il y avait encore des plumes au Canard, mais là, il est en train de les perdre...
Voici maintenant, en excluvisité mondiale, quelques morceaux sanguinolents du Voyage par France Cul. Chaque extrait du livre est assorti d’un « sonore » et d’un tableau qui replongent dans l’époque. Allez hop, tous dans le train de 1914...
Redécouvrez l’immense œuvre de Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit, à travers une sélection d’archives sonores et d’extraits tirés du livre pour revisiter l’horreur des tranchées et les colonies en Afrique de l’Ouest, les cadences chez Ford ou encore le curieux mausolée de Pasteur.
Louis-Ferdinand Céline, impressionniste ? Voyez plutôt ce qu’il confiait à Paris-Match, en 1960 :
« Le truc, c’est que moi je fais le boulot pour les lecteurs, vous comprenez... En somme, le bonhomme, quand il lit un livre, il est forcé de faire un effort de représentation. Moi, je le fais pour lui, l’effort. Je lui raconte. Je fais passer le langage écrit à travers le langage parlé. Il se produit alors un peu ce qui s’est produit pour les impressionnistes. Avant on ne voyait jamais, par exemple, la fleur, l’écrevisse ou la jolie femme sur l’herbe. On montrait un magnifique bouquet de fleurs, des scènes de chasse, de naufrage, mais tout ça en jour d’atelier. Alors il fallait faire un effort, pas un effort gros, mais tout de même un petit effort pour sentir la bataille ou sentir le naufrage. Tandis qu’avec les impressionnistes, là, avec Manet, Monet et la suite, là on les a vues sur l’herbe les écrevisses et les jolies femmes avec Le Déjeuner sur l’herbe et le Bonheur à Bougival. »
Toutes les velléités de transposer à l’écran Voyage au bout de la nuit sont mort-nées, abandonnant le monument littéraire en rase campagne devant l’ampleur de la tâche et l’exigence périlleuse de l’exercice. Ici, nous vous proposons de plonger une oreille sensible et impressionniste dans l’œuvre de Céline à travers une douzaine d’extraits et autant d’échappées sonores, puisées dans les archives de France Culture.
[...]

Poilu dans les tranchées, « puceau de l’Horreur »
« Perdu parmi deux millions de fous héroïques et déchaînés et armés jusqu’aux cheveux ? Avec casques, sans casques, sans chevaux, sur motos, hurlants, en autos, sifflants, tirailleurs, comploteurs, volants, à genoux, creusant, se défilant, caracolant dans les sentiers, pétaradant, enfermés sur la terre, comme dans un cabanon, pour y tout détruire, Allemagne, France et Continents, tout ce qui respire, détruire, plus enragés que les chiens, adorant leur rage (ce que les chiens ne font pas), cent, mille fois plus enragés que mille chiens et tellement plus vicieux ! Nous étions jolis ! Décidément, je le concevais, je m’étais embarqué dans une croisière apocalyptique.
On est puceau de l’Horreur comme on l’est de la volupté. Comment aurais-je pu me douter moi de cette horreur en quittant la place Clichy ? Qui aurait pu prévoir avant d’entrer vraiment dans la guerre, tout ce que contenait la sale âme héroïque et fainéante des hommes ? A présent, j’étais pris dans cette fuite en masse, vers le meurtre en commun, vers le feu… Ça venait des profondeurs et c’était arrivé. »
[...]

- Cavalerie française traversant un lac, Verdun (1916)
Les cadavres de chevaux, l’autre hécatombe
« Je l’aurais bien donné aux requins à bouffer moi, le commandant Pinçon, et puis son gendarme avec, pour leur apprendre à vivre ; et puis mon cheval aussi en même temps pour qu’il ne souffre plus, parce qu’il n’en avait plus de dos ce grand malheureux, tellement qu’il avait mal, rien que deux plaques de chair qui lui restaient à la place, sous la selle, larges comme mes deux mains et suintantes, à vif, avec des grandes traînées de pus qui lui coulaient par les bords de la couverture jusqu’aux jarrets. Il fallait pourtant trotter là-dessus, un, deux… Il s’en tortillait de trotter. Mais les chevaux c’est encore bien plus patient que des hommes. Il ondulait en trottant. On ne pouvait plus le laisser qu’au grand air. Dans les granges, à cause de l’odeur qui lui sortait des blessures, ça sentait si fort, qu’on en restait suffoqué. En montant sur son dos, ça lui faisait si mal qu’il se courbait, comme gentiment, et le ventre lui en arrivait alors aux genoux. Ainsi on aurait dit qu’on grimpait sur un âne. C’était plus commode ainsi, faut l’avouer. »
[...]

- L’ Industrie de Détroit ou L’ Homme et la Machine (1932-1933) - Détail de la fresque murale de Diego Rivera à l’Institut des Arts de Détroit (Michigan)
Le Fordisme ou l’ère des chimpanzés
« “Ça ne vous servira à rien ici vos études, mon garçon ! Vous n’êtes pas venu ici pour penser, mais pour faire les gestes qu’on vous commandera d’exécuter… Nous n’avons pas besoin d’imaginatifs dans notre usine. C’est de chimpanzés dont nous avons besoin… Un conseil encore. Ne nous parlez plus jamais de votre intelligence ! On pensera pour vous mon ami ! Tenez-vous-le pour dit.”
Il avait raison de me prévenir. Valait mieux que je sache à quoi m’en tenir sur les habitudes de la maison. Des bêtises, j’en avais assez à mon actif tel quel pour dix ans au moins. Je tenais désormais à passer pour un petit peinard. Une fois rhabillés, nous fûmes répartis en files traînardes, par groupes hésitants en renfort vers ces endroits d’où nous arrivaient les fracas énormes de la mécanique. Tout tremblait dans l’immense édifice et soi-même des pieds aux oreilles possédé par le tremblement, il en venait des vitres et du plancher et de la ferraille, des secousses, vibré de haut en bas. On en devenait machine aussi soi-même à force et de toute sa viande encore tremblotante dans ce bruit de rage énorme qui vous prenait le dedans et le tour de la tête et plus bas vous agitant les tripes et remontait aux yeux par petits coups précipités, infinis, inlassables. »
[...]

« Une fille pareille »
« “Qu’ai-je pu faire au ciel, Docteur, pour avoir une fille pareille ! Ah, vous n’en direz du moins rien à personne dans notre quartier, Docteur !... Je compte sur vous !” Elle n’en finissait pas d’agiter ses frayeurs et de se gargariser avec de ce que pourraient en penser les voisins et les voisines. En transe de bêtise inquiète qu’elle était. Ça dure longtemps ces états-là.
Elle me laissait m’habituer à la pénombre, à l’odeur des poireaux pour la soupe, aux papiers des murs, à leurs ramages sots, à sa voix d’étranglée. Enfin, de bafouillages en exclamations, nous parvînmes auprès du lit de la fille, prostrée, la malade, à la dérive. Je voulus l’examiner, mais elle perdait tellement de sang, c’était une telle bouillie qu’on ne pouvait rien voir de son vagin. Des caillots. Ça faisait « glouglou » entre ses jambes comme dans le cou coupé du colonel à la guerre. Je remis le gros coton et remontai sa couverture simplement. »
Lire l’article entier sur franceculture.fr
Alain Finkielkraut consacre son émission Répliques du 28 février 2009 à Céline, sous le titre Pourquoi Céline ?. Il y invite un pro et une anti-Céline (pour cause de « féminisme », pas d’antisémitisme) :













 et
et  !
!