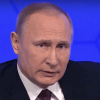capitale du Kazakhstan
Depuis la libération d’Alep, les événements se précipitent. Des négociations inter-syriennes ont été menées sous l’égide de la Russie, de l’Iran et de la Turquie. Elles ont abouti le 29 décembre à un triple accord entre le gouvernement syrien et sept groupes de l’opposition armée.
« Trois documents ont été signés », a déclaré le président russe. Le premier instaure « un cessez-le-feu sur l’ensemble du territoire syrien ». Le deuxième définit « les mesures visant à contrôler le respect de la trêve ». Le troisième est une « déclaration sur la volonté des parties en conflit de lancer des négociations de paix ».
Certes, on objectera à juste titre que cet accord n’instaure dans l’immédiat qu’un fragile cessez-le-feu. Il peut être remis en cause à tout moment, les terroristes d’Al-Qaida et de Daech en sont exclus, et il ne règle pas, au fond, la crise syrienne ouverte au printemps 2011. Il n’empêche que cette signature, fruit de tractations entre des parties qui ne se parlaient plus, marque une nouvelle avancée en vue d’un règlement politique du conflit, une semaine à peine après la victoire de l’armée arabe syrienne dans la deuxième ville du pays.
L’avenir dira si cette étape était décisive, mais on peut déjà en tirer trois enseignements.
Le premier, c’est que rien ne vaut une victoire militaire pour remettre les pendules à l’heure. La débandade des « rebelles » d’Alep-Est après un mois de combats valide la stratégie syrienne de reconquête territoriale. Les cinq premières villes du pays sont désormais sous le contrôle du gouvernement : Damas, Alep, Homs, Lattaquié et Hama. Toutes les combinaisons échafaudées en Occident et dans les pays du Golfe pour imposer le départ de Bachar Al-Assad, que ce soit comme « préalable » ou comme « résultat » d’une transition politique, se brisent sur cette réalité comme une coque vermoulue sur des récifs côtiers.
La victoire militaire de l’armée syrienne et de ses alliés, en réalité, conforte l’initiative russe en faveur d’une solution politique. En position de faiblesse, les groupes armés non affiliés à Daech ou Al-Qaïda vont devoir choisir entre une fuite en avant qui liera leur sort à ces jusqu’au-boutistes ou une négociation avec un État syrien qui les chasse, peu à peu, des principales agglomérations du pays. L’attitude de ces groupes est l’une des inconnues qui pèseront sur la suite des événements, mais il est significatif qu’ils aient choisi, sans doute à contre-cœur, la solution négociée.
Le deuxième enseignement, c’est l’éviction spectaculaire des États-Unis, éjectés comme des malpropres d’une scène syrienne où ils ont additionné les mensonges, les coups bas et les échecs à répétition. Pour la première fois dans l’histoire contemporaine, la négociation sur un conflit majeur est engagée sans Washington, qui doit se résoudre à faire tapisserie pendant que Moscou mène la danse. Discrédités par une politique erratique, les USA sont condamnés à approuver un processus qu’ils n’ont jamais cherché à promouvoir tout en prétendant le contraire. En attendant, ils se voient contraints de mettre une sourdine à leurs jérémiades sur les « crimes de guerre » et la « barbarie russe ».
Cette mise en orbite de la Maison-Blanche est d’autant plus cruelle que son principal allié dans la région, la Turquie, y a participé activement. Pour Ankara, mieux vaut un adversaire avec qui on peut négocier (Moscou) qu’un allié félon qui vous fait des enfants dans le dos (Washington). Les USA paient leur ambiguïté lors de la tentative de coup d’Etat en Turquie, mais aussi le soutien opportuniste accordé aux Kurdes de Syrie. M. Poutine, dont la retenue lors de l’affaire du Soukhoï abattu a porté ses fruits, n’eut qu’à tendre la main à son homologue turc pour que la géographie et l’économie, facteurs objectifs de convergence turco-russe, prennent le dessus. L’admission de la Turquie dans le club des parrains de la paix en Syrie est un coup de maître. Mais Moscou a aussi contracté une police d’assurance du côté de Doha. En lui concédant une participation au capital de la compagnie pétrolière nationale Rosneft, Moscou achète la neutralité du Qatar. Ce pacte de circonstance devrait contribuer à la tiédeur de l’Arabie saoudite, à son tour, pour une rébellion en déroute. Revirement turc, défection qatarie, isolement saoudien, le dispositif clintonien du « regime change » en Syrie s’effondre comme un château de cartes. Donald Trump a proclamé son intention d’en finir avec ces lubies néo-conservatrices. A croire qu’il avait anticipé la suite des événements !
Le dernier enseignement, enfin, est lié au lieu même des futures négociations de paix. Capitale futuriste du Kazakhstan construite en 1997, Astana [1] est au cœur de cet arc de puissance géopolitique dont Moscou est l’artisan inlassable face aux prétentions occidentales à régenter la planète. C’est à travers le territoire kazakh que passent les oléoducs qui acheminent, vers la Chine, le gaz en provenance des gisements de la Caspienne. Premier producteur mondial d’uranium, le Kazakhstan est un allié stratégique de la Russie et son partenaire essentiel dans les domaines-clé de la modernité économique (nucléaire, spatial, hydrocarbures).
Ce pays asiatique majoritairement musulman est membre de l’Union eurasienne et de l’Organisation de coopération de Shanghaï. En plein développement, proche de la Russie, il est le symbole des nouveaux équilibres du monde. C’est à Astana que les négociations de paix commenceront en janvier, précédant celles de Genève en février. Les deux processus ne sont pas contradictoires, affirme la diplomatie russe. Staffan de Mistura, délégué spécial de l’ONU pour la Syrie, sourit pour la forme. Mais quel symbole ! Détrônée par la capitale kazakhe, la cité helvétique n’est plus le centre de l’activité diplomatique. Les Russes l’ont déplacé à l’Est, au cœur d’une Eurasie qui est le siège des puissances de demain.













 et
et  !
!