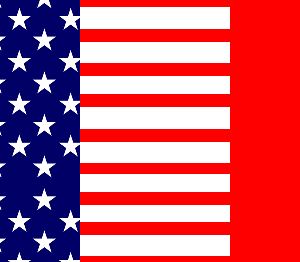Un domaine dans lequel les Français excellent, c’est la littérature. Des dizaines de milliers de nos concitoyens écrivent, quelques milliers se font éditer, dans des maisons plus ou moins sérieuses, à compte d’auteur ou pas, quelques centaines apparaissent dans les librairies, chaque année, quelques dizaines sortent du lot, et une poignée seulement en vit. La dureté de la vie de littérateur n’est pas une nouveauté. Et ceux qui, dans les médias, se moquent de ces petits Français de province – souvent des profs – qui écrivent leur livre, croyant écrire le livre de leur vie, et parfois du siècle, ont tort. Car c’est la largeur de la pyramide qui détermine sa hauteur.
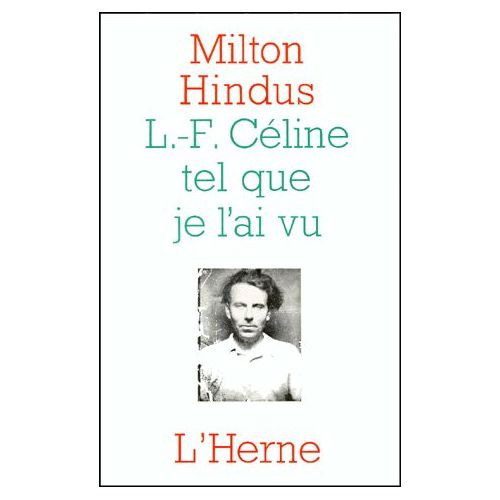
- En 1950, les Américains admirent la littérature française, et c’est dans l’ordre des choses
Le patrimoine littéraire français est une richesse insoupçonnée. On parle des défauts de la France en permanence, mais cette réserve d’intelligence, peu en prennent conscience. Car c’en est une : Hollywood, dans ses premières décennies, a pioché sans vergogne dans le roman historique français, pour muscler ses scénarios. Puis l’Amérique a trouvé sa propre voie, et produit des films sur sa jeune histoire. L’abandon, voire l’interdiction de toute fierté nationale, depuis le règne des médias de masse en France, n’a pas suffi à complètement détruire notre littérature. Si on se retrouve avec des Angot, c’est pour des raisons objectives : féminisme, pornocratie, déconceptualisation des contenus. On sait désormais que l’oligarchie anglo-saxonne a tout fait pour neutraliser le particularisme français, ce mélange de christianisme, de gaullisme, et de communisme. Un esprit résistant aux virus sioniste, capitaliste et protestant. Résultat obtenu en assénant la production culturelle anglo-saxonne aux jeunes Français, en survendant le produit d’importation au détriment de la production locale. Méthode américaine éprouvée : envoyer des tonnes de riz dans un pays dit du tiers-monde, détruire les circuits vivriers locaux, créer le besoin de multinationale, et rendre dépendant le pays ainsi « restructuré ». Ce processus s’appelle démocratisation.
Si l’Amérique a réussi à enfoncer nos défenses depuis un demi-siècle avec ses excellents films – il faut le reconnaître – ce qui n’enlève rien à la richesse du cinéma français, c’est surtout grâce au marketing, ou plutôt, à leur machinerie commerciale. Des moyens publicitaires puissants au service d’un produit moyen, c’est la formule gagnante. L’humilité française en la matière, qui consiste à croire qu’un bon produit se défend tout seul – avec le temps, c’est vrai, mais le commerce n’attend pas – a été écrabouillée sous le carpet bombing anglo-saxon. Par l’assurance d’être les meilleurs, qui se transmet aux peuples ébahis, prélude à la soumission (celle dont on ne parle pas, ou plus, tellement elle fait corps avec nous). La confiance a changé de camp. Signe d’une campagne de persuasion mondiale, à la limite de l’hypnose, bien rendue dans le clip du groupe allemand Rammstein, qui montre avec simplicité que l’influence culturelle américaine se traduit par une mondialisation de la médiocrité. Des produits de merde mais à la symbolique de victoire qui liquéfient toutes les frontières, toutes les cultures. Une espèce invasive, à l’image des crapauds, écrevisses et autres écureuils nord-américains : plus agressifs, et aucunement respectueux de la biodiversité locale. Un seul mot d’ordre : search and destroy.
La France a été bien naïve, et ceux qui se moquent des pays comme l’Algérie dont une clique de potentats s’enrichit grâce à l’importation des produits de première nécessité (Monsieur Sucre, Monsieur Blé), feraient bien de considérer nos traîtres à nous. Une partie du pays, qu’on appelle plus communément l’élite, a ouvert nos frontières à ces produits invasifs pour profiter d’un business extrêmement juteux, dont la production nationale a payé le prix. Ce n’est pas pour rien qu’en pleine apogée de la chanson française (Brassens, Brel, Ferré et compagnie), dans les années 1960, les yéyés sont arrivés pour tout bousiller, et tout ramener au niveau des pâquerettes. En 1979, les Iraniens se sont révoltés contre ça. La France, non. Au contraire, sa révolution de 1968 aura marqué le basculement dans l’américanisation de la société. Après, tout s’est dégradé.
Cet assaut a impacté tous les secteurs : du plus bas – les yéyés avec la copie merdique de la musique anglo-saxonne des années 60 – au plus haut, on pense aux systèmes informatiques de sécurité militaire nationale. Si la France ne peut pas tout produire, et que la mondialisation ne présente pas que des aspects négatifs (sinon on paierait nos PC 3 000 euros), il reste que l’élite française s’est vautrée avec délices dans l’américanisation. Il n’y a qu’à voir la prosternation des créateurs de la chaîne privée Canal+ devant la culture américaine.

Pierre Lescure, son président emblématique, a longtemps possédé une collection de « pop art » à la fois très cotée et laide à pleurer : des personnages de BD en couleurs, en très grand format… La nullité artistique à l’état pur. Il y a donc une autopersuasion de nos élites, qui subissent le charme de la fabuleuse machine culturo-industrielle. Ils n’y résistent pas, c’est le moins qu’on puisse dire, et transmettent leur virus à chaque génération fascinée par cet étalage de bruits et de couleurs, en un mot : cette violence. L’Amérique vend sa propre victoire. En vérité, un grand vide conceptuel et existentiel. Mais seul compte le moment de la vente, de la signature ; après, les produits vite consommés en appellent d’autres. De cette eau vous aurez toujours soif…
On en revient au point de départ : la littérature. Dans ce domaine, exactement comme en art, la qualité de la production française a été niée par nos élites médiatiques au profit de la qualité étrangère. Ce 11 septembre 2016 se tient le festival America à Vincennes, près de Paris, au bois désormais infesté de pauvres, on parle de plusieurs centaines de SDF. Cet énième festival à la gloire de l’Empire consiste à exposer les photographies des grands écrivains américains. Cinq ans de travail pour ramener des images exceptionnelles, qui font rêver, et parfois basculer dans une sorte de transe…

À défaut de pâmoison artistique, de simples clichés de types qui essayent d’incarner l’écrivain, the écrivain. Solitude, espaces, grandeur, profondeur… on n’oublie aucun cliché. Et on commence par le très survendu Jim Harrison. Harrison, c’est l’école country : je chasse, je pêche, et j’écris. Une resucée d’Hemingway, en moins bougeotte et en plus localisée. Des phrases dans le genre haïku qui n’ont de sens caché que pour les membres de sa secte, dont les journalistes français de L’Obs, qui vient de larguer une grosse caisse de condamnés. Peut-être y a-t-il un rapport de cause à effet…
Carver est cité en exemple. Carver, qui voulait écrire minimaliste, jusqu’à se perdre dans ses phrases creuses, où il n’y avait plus rien, rien d’autre que l’ennui profond. Richard Ford en serait l’héritier, et on apprend qu’il « stocke ses idées de livres dans son congélateur ». Si ça signe pas le génie, ça. De manière plus générale, l’école d’écriture américaine est plate, besogneuse, interminable (des romans qui n’ont de fleuve que le nom, rarement la puissance), bref, indigeste. Ça écrit rationnel, on sent le travail, la sueur, le manque de légèreté, de finesse, on est loin des envolées de Céline. Ce sont des bulldozers déguisés en papillons, qui avancent, mécaniquement, et qui dessinent des trajectoires géométriques archi-prévisibles. Dans l’écrasante majorité des cas, c’est chiant. Que ça écrive ampoulé ou nature, élaboré ou simple. Il leur faudra encore deux ou trois siècles pour savoir écrire, en bloc. En attendant, ils sont (juste) bons à produire du scénario cinéma. Quant aux abominables écoles d’écriture, on préfère ne pas en parler, tant ça heurte le principe de base de toute littérature digne de ce nom. On les retrouve avec leurs nouvelles pleines de trucs, de gimmicks, il ne manque plus que les panels de lecteurs pour en garantir le succès commercial. John Irving en est l’exemple absolu, avec sa littérature du creux gonflé à la phrase, et dont les mauvais romans, encensés par la critique, finirent en mauvais films.
Soyons honnêtes, il y a évidemment quelques perles qui brillent, ici et là. Mais ce sont justement ces perles qui sont rejetées par la société américaine, à l’image de Charles Bukowski. Les seuls qui présentent un certain intérêt, sont ceux qui ont été éjectés du système de bonheur américain obligatoire. Les laissés-pour-compte de la croissance spectaculaire de ce modèle de société, destiné au totalitarisme. Généralement, ces pépites sont d’essence étrangère, ou d’inspiration étrangère. Bukowski n’a-t-il pas été littéralement estomaqué par le style de Céline ? Des étrangers dans leur propre pays, des Blancs pauvres ou des Noirs (pas la peine de rajouter « pauvres »). Il y en a même qui font des petits boulots pour faire vrai... L’école des acteurs qui s’immergent quatre mois dans un milieu social ou professionnel différent, afin que leur jeu résonne d’authenticité.
Chez nous, de la même façon, la production non conforme est mise à l’écart – or c’est elle qui détient le futur entre ses pages, car le futur est un présent non conforme – et la production correcte mise en avant. Façon de neutraliser l’aspect dérangeant de la littérature politique. À la place, car le public demande de la subversion, cette chose qui donne l’impression d’être libre, les décideurs lui préparent de la fausse résistance (le rock). C’est vieux comme le monde, mais ça marche toujours, et le temps que l’escroquerie de la fausse subversion soit découverte, la nouvelle est déjà en place. Course poursuite entre le Système et ses contradicteurs…
Houellebecq, notre meilleur produit d’exportation, fait le 20 Heures du service public. Autant dire qu’au-delà de son petit théâtre personnel, où se réfugient différence et résistance (je m’habille mal donc je ne respecte pas le système du coup je conserve mon intégrité), l’écrivain idolisé va dans le sens du poil oligarchique :
Mais ne réduisons pas la littérature à la politique (les gens ont besoin de consommer du non-anxiogène), même si toute bonne littérature est de fait politique : en éclairant, en déclenchant des explosions de conscience, elle change l’individu, ouvre son esprit, et lui donne des armes mentales contre toute prise de pouvoir ou manipulation oligarchique. Bateau, mais toujours aussi efficace. Un livre peut sauver une vie ! Donc lisez, écrivez, achetez français !
Qu’Éric Naulleau avec ses traductions du bulgare, ou les éditions Actes Sud, premier employeur privé d’Arles, eux qui ont fait leur succès de l’importation de la littérature mondiale, nous pardonnent. L’amour de la France a ces excès que la raison pardonne.













 et
et  !
!