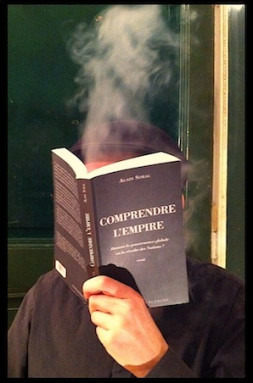Avant même d’ouvrir le volume et d’entamer la lecture de la première page, une considération s’impose au sujet de Comprendre l’Empire, le nouvel opus de notre ami Alain Soral : sa parution marque une étape nouvelle et particulièrement intéressante dans l’histoire du marché du livre. En effet, malgré un silence assourdissant de la part des grands médias et avec – à ma connaissance – une seule apparition à la télévision pour faire la promotion de l’ouvrage (cela se passait, sans surprise, chez Frédéric Taddei), les ventes n’en ont pas moins atteint des sommets impressionnants, surtout lorsqu’on sait qu’un nombre pléthorique d’exemplaires s’est vendu avant même la mise à disposition du livre en librairie. Ceux qui, à la tête de la presse littéraire et des émissions culturelles, connaissent l’existence de l’ouvrage, l’ont peut-être même lu et se sont bien gardés d’inviter Alain Soral ou de dire le moindre mot de son essai, se demandent bien quelle explication donner à ce phénomène. N’était-il pas évident, jusqu’ici, que le succès de n’importe quel produit était proportionné aux moyens engagés dans sa publicité et à sa visibilité dans les canaux officiels de transmission de l’information ? Pourquoi le public se mettrait-il, sur un coup de tête, à acheter l’œuvre d’un écrivain qui passe si rarement à la télé ?
Ce que ces messieurs n’ont pas vu venir, c’est la conjonction de différents facteurs relatifs à la personne et au travail de Soral et dont les plus significatifs me semblent être les suivants :
1) Soral n’est pas un obscur plumitif inconnu du public : il est publié depuis plus de vingt ans, a signé un grand nombre d’ouvrages et a débordé la sphère du livre pour s’essayer à d’autres expériences, sur un spectre allant du cinéma au militantisme politique.
2) Si Soral a le mérite d’amener dans son dernier livre des idées nouvelles, ces dernières sont toutefois partagées par un nombre croissant de personnes : l’ouvrage paraît au seuil d’une période charnière et synthétise, avec un léger coup d’avance, les diverses idées et réflexions qui constituent la prise de conscience de milliers d’individus parmi ses lecteurs.
3) Ceux qui font une confiance aveugle aux chroniqueurs littéraires du système et se contentent des bibliographies autorisées délivrées par les animateurs et tâcherons habituels sont de plus en plus rares ; la méfiance généralisée du public à l’égard des médias traditionnels le mène tout naturellement à se tourner vers internet et à découvrir, par le biais de cet “alter-marketing” cher à Dieudonné, d’autres auteurs et d’autres œuvres.
4) L’aventure associative d’Egalité & Réconciliation, jumelée aux talents de rassembleur de Soral et à sa popularité parmi la jeunesse, lui a assuré une place de choix dans la blogosphère, sur la base d’un mouvement de soutien et de sympathie fondé non pas sur l’argent ou le trafic d’influences (conditions de la promotion médiatique classique) mais sur la simple adhésion aux thèses du livre.
Le succès de Comprendre l’Empire, du point de vue strictement commercial, c’est donc d’abord la victoire de la popularité réelle sur la flatterie, la victoire d’une communication basée sur l’imagination et l’enthousiasme sur une communication basée sur les enjeux financiers et le copinage. En tant qu’amoureux des livres connaissant de l’intérieur les politiques de librairie, je ne peux que m’en réjouir. Alain Soral, comme Marc-Edouard Nabe, Paul-Eric Blanrue et quelques autres – Alain n’appréciera peut-être pas le parallèle mais j’assume mes amitiés contrastées – inaugure une nouvelle manière de promouvoir et de diffuser l’écrit, dans une optique où la liberté d’une écriture sans concession l’emporte sur les limites imposées au livre en milieu capitaliste.
Mais je ne me limiterai pas ici à chanter les vertus de l’objet-livre, ce serait faire offense à un ouvrage qui, justement, fustige un certain type de matérialisme. Venons-en donc au contenu. Dès l’introduction, Soral nous rappelle qu’il ne nous présente pas ici l’essai qui le raccommodera avec tous les ennemis qu’il a eu le loisir de se faire durant ces dernières années, ce serait même plutôt le contraire. Il porte en lui « une envie d’entrer dans la légende plus forte que celle d’entrer dans la carrière » (p.14) et c’est tout à son honneur. Je ne reprendrai pas le développement de l’auteur point par point, je préfère renvoyer au texte que faire des paraphrases ; je dirai seulement pour rassurer ceux qui craignent de se retrouver avec une énième compilation d’élucubrations conspirationnistes entre les mains qu’il ne s’agit pas du tout de cela. Pas de petits hommes verts, d’hyperboréens ou de reptiliens satanistes dans cet ouvrage : le petit livre noir de Soral n’est pas le petit livre jaune des Illuminati. On nous parle de certains complots, certes, mais ces derniers sont attestés par l’histoire et leur mode d’agir est toujours explicité par la dialectique la plus rigoureuse. Par le sérieux avec lequel il traite son sujet, Soral montre à ceux qui en douteraient encore qu’on peut parler de lobbys sans être paranoïaque, rappeler l’histoire de la franc-maçonnerie sans tomber dans l’anti-maçonnisme primaire, évoquer la question juive (notamment à travers la généalogie de la banque en Occident) sans faire preuve d’antisémitisme, et rendre justice à l’Ancien Régime sans l’idéaliser et sans diaboliser à outrance la République.
La République, parlons-en : l’adage « qui aime bien châtie bien » me semble particulièrement adapté pour définir le rapport qu’entretient Soral avec elle. Soral, rappelons-le, est tout de même l’homme qui a co-écrit le discours de Valmy prononcé par Jean-Marie Le Pen en 2007, un des principaux artisans de cette réconciliation qui devait – qui aurait dû ? – amener le Front national à renouer avec le projet républicain. Mais il y a République et République. Soral rend hommage, tout en fustigeant leur naïveté, aux pionniers de la Première République, ceux qu’il appelle les progressistes de gauche, soit Robespierre et Saint-Just, des hommes admirables par leur courage et leurs mobiles désintéressés mais victimes de plus malins qu’eux. En effet, les problèmes commencent lorsque ces progressistes de gauche (révolutionnaires sincères) se font instrumentaliser par les progressistes de droite (bourgeoisie capitaliste) pour liquider les réactionnaires de droite (tenants de l’Ancien Régime) avant de se faire liquider eux-mêmes, comme kamikazes utiles et cocus involontaires, les affairistes peu scrupuleux qui vont leur succéder dans le lit de Marianne tenant ici le rôle de l’amant dans le placard. De façon pour les nouveaux “républicains”-ploutocrates de pouvoir « enfin niquer tout le monde, spolier la noblesse et mettre les anciens serfs, futurs prolétaires, au boulot ! » (p.38)
L’Empire dont il est ensuite question, et dans lequel, à travers les siècles, certains éléments de la République auront leur rôle à jouer (avec Dominique Strauss-Kahn comme agent parmi d’autres) n’a rien à voir avec celui de Napoléon : celui qui nous intéresse ici est mondial, prétendument apolitique mais résolument sioniste et géopolitiquement américanocentré. C’est « l’Amérique du messianisme conquérant anglo-saxon puritain, appuyé cette fois sur le message sanguinaire et méprisant de l’Ancien Testament du Deutéronome. » (p.48) Ce message résulte d’une « vision incroyablement inégalitaire et violente, qui peut paraître délirante aux esprits humanistes helléno-chrétiens, mais pourtant conforme au messianisme judéo-protestant porté par les élites anglo-saxonnes et qui ont accouché historiquement de l’Amérique impériale comme du projet sioniste. » (p.212) De l’helléno-christianisme au judéo-protestantisme, n’y aurait-il pas là une piste pour distinguer ces deux entités qu’on confond souvent mais qu’il convient de différencier et même d’opposer – l’Europe et l’Occident ?
Dans ce livre comme dans les précédents, Soral donne parfois l’impression – impression assez jubilatoire – de philosopher avec un gant de boxe comme un certain Friedrich philosophait avec un marteau, mais au-delà de la rhétorique soralienne très franche et directe que nous connaissons bien, le raisonnement n’en est pas moins très subtil et se targue de la cohérence la plus solide. Cet amour des “idées claires et distinctes” se manifeste notamment dès qu’il est question du marxisme : l’auteur, qui sait ce qu’il doit à la méthode d’analyse matérialiste dialectique, en fait, à chaque fois que c’est possible, le meilleur usage, non sans une certaine prudence qui s’impose effectivement. Cette méthode est idéale lorsqu’il s’agit de retomber sur terre (pour ne plus marcher sur la tête, comme le disait Marx dans sa critique des Jeunes Hégéliens), de rappeler que le réel ne découle pas d’un quelconque providentialisme ou d’une improbable morale transcendante mais n’est que la résultante d’un rapport de forces. La méthode marxiste permet d’aller voir ce qui se cache derrière les idéaux affichés, de saisir le point où se jouent réellement les affrontements. Mais si Soral entend rappeler l’importance fondamentale dans l’histoire des facteurs purement matériels – la finance, la démographie, les rapports de production, etc. – il ne fait pas pourtant du matérialisme une fin en soi. De Marx il remonte à Hegel, c’est-à-dire à une Histoire mue également par l’Idée, une Histoire qui favorise, lorsque le temps est venu, l’éclosion des héros, des grands hommes, ceux-là même que le philosophe d’Iena magnifiait dans son chef-d’œuvre, La Raison dans l’Histoire. Par ailleurs, Soral ne s’interdit pas, sur un autre plan, une critique assez sévère de Marx et d’Engels, à qui il préfère désormais l’anarchiste Bakounine, le fédéraliste Proudhon ou le syndicaliste Sorel – trois personnages qu’il qualifie de « populistes » et de penseurs « plus réalistes que matérialistes, plus intuitifs que conceptuels. » (p.130) Il cite d’ailleurs à plusieurs reprises Les Illusions du Progrès de Sorel, et cette référence assumée me confirme dans une impression qui m’était venue peu à peu au cours de ma lecture : Comprendre l’Empire, dans un contexte historique tout à fait différent, n’est pas sans faire penser à certains textes de l’excellent Edouard Berth – je pense notamment aux Méfaits des Intellectuels et à certains chapitres de Guerre des Etats ou Guerre des Classes.
Soral profite de cet ouvrage pour rappeler quelques concepts de base, à travers des définitions qui sont familières à ses lecteurs de longue date mais sur lesquelles il n’est jamais inutile de revenir. Ainsi du peuple, dont tout le monde parle – « Si tous les pouvoirs se réclament du peuple, jamais de mémoire d’homme, aucun pouvoir ne lui échut. » (p.101) – et qu’on peut définir comme « le monde du travail et de la production, soit cette classe des laboratores assumant et assurant – selon la terminologie freudienne – le “principe de réalité” : paysans, commerçants, artisans, ouvriers, petits entrepreneurs, auxquels il faut agréger encore les petits fonctionnaires utiles et les artistes exprimant cette sensibilité. » (p.124) Ou du multiculturalisme, qu’il faudrait plutôt appeler « idéologie raciale du mondialisme » (p.230), qui « n’est pas l’apport réciproque du meilleur de deux civilisations pour donner le jazz musette de Django Reinhardt, mais la destruction de toutes les cultures enracinées par leur mixage forcé, débouchant sur le melting pot, Babel et l’ilotisme », soit « un métissage qui n’est rien d’autre que le colonialisme du mondialisme que nous subissons tous, souchiens comme indigènes. » (p.230) Ou encore de l’anticléricalisme « devenant, après la définitive trahison du Tiers-Etat prolétaire par le Tiers-Etat bourgeois (le Versaillais Thiers matant dans le sang la Commune de Paris), le nouveau combat d’une bourgeoisie de gauche qui, ayant trahi le peuple du travail, a besoin d’un combat progressiste de substitution, mais ne portant pas atteinte au pouvoir de l’argent. » (p.69)
Si j’avais un regret à formuler, ce serait au sujet des contraintes de brièveté que Soral s’est lui-même imposé, en accord avec son éditeur, pour obtenir un livre suffisamment bref pour rester accessible à un prix abordable. Il a fait là un choix raisonnable, c’est vrai, il a compris que les nouvelles idées n’avaient de sens comme pistes pour l’avenir que si elles se répandaient le plus largement possible, et il est conscient qu’une grande partie de son lectorat actuel est constitué de jeunes et de gens à faible pouvoir d’achat. Mon regret ne porte donc pas sur ce choix mais plutôt sur l’impression que j’ai que, sur les dizaines de milliers de lecteurs de Comprendre l’Empire, il en existe sans doute quelques centaines qui auraient été intéressés, quitte à débourser une somme plus importante, d’acquérir une version “collector” de l’ouvrage, celle qui, telle que prévue par l’auteur à l’origine, aurait compté non pas 240 pages mais près de 700. La matière traitée est d’une telle densité qu’un développement plus long aurait sans doute amené encore plus d’éclairage sur la question. Mais qui sait ? Peut-être cette suggestion va-t-elle faire apparaître un Comprendre l’Empire extended cut sur les rayons de Kontre-Kulture, la nouvelle boutique en ligne de référence pour tout lecteur d’Alain Soral, de Michel Drac et autres auteurs contemporains réellement subversifs.
En attendant, la version final cut trône dans toutes nos bibliothèques et a ouvert un grand débat sur la question de l’Empire et des moyens d’y résister. Je gage qu’on n’a pas fini d’entendre parler de ce livre et qu’il fera des petits, posant la première pierre d’un mouvement de pensée stimulant qui rencontre aujourd’hui un vaste écho et qui ne va pas s’arrêter en si bon chemin !
David L’Epée, avril 2011













 et
et  !
!