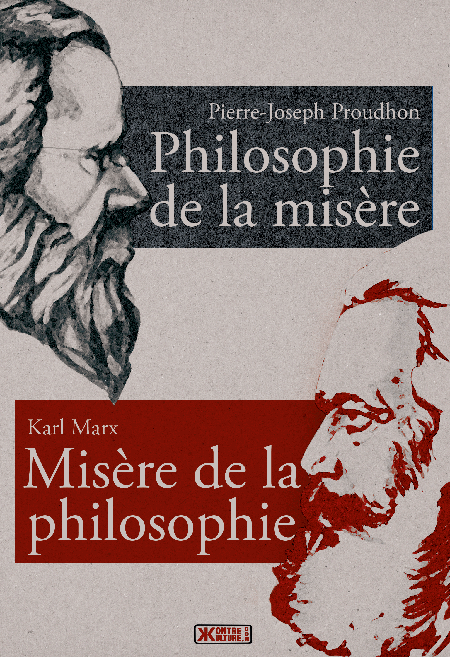La pensée de Proudhon s’explique par une défiance générale à l’égard de la modernité. Comme la plupart des auteurs pré-marxistes issus de la nébuleuse socialistes, il envisageait la marche en avant occidentale comme une course folle, conduisant à l’exacerbation des vices bourgeois. C’est pourquoi, tout en appelant de ses vœux davantage de progrès social, il revendiquait la nécessité de préserver les acquis bénéfiques du passé.
Cela lui faisait écrire par exemple :
« Nous serons tout à la fois hommes de conservation et hommes de progrès, car ce n’est qu’à ce double titre que nous serons des hommes de révolution. »
Cette position principielle explique en partie qu’on puisse ranger Proudhon parmi les précurseurs de la décroissance. Le progrès social n’impliquait pas pour lui qu’on progresse dans tous les domaines, et il insistait au contraire sur le fait que les prétendus progrès de la société n’étaient souvent que des régressions masquées, tandis que la conservation des bons aspects du passé était la condition de possibilité du progrès véritable.
Il est à noter toutefois que l’opposition proudhonienne au progrès ne reposait pas essentiellement sur une critique de la technique. Contrairement aux luddites, par exemple, il se préoccupait très peu de la question des machines. Son discours critique était centré sur les méfaits politiques et économiques de la modernité, jugée aliénante pour l’homme.

Le localisme économique : le mutuellisme
Là où Proudhon peut le plus visiblement se rapprocher des objecteurs de croissance, c’est dans son insistance pionnière sur les mérites du localisme, dans tous les domaines de la vie. Et notamment en économie. La modernité a en effet favorisé l’essor des grandes capitales au détriment des provinces, et des villes au détriment des campagnes. Proudhon a anticipé des notions devenues centrales dans la pensée dissidente. Pour lui, une authentique révolte populaire transite par l’action directe du peuple et la participation à des initiatives solidaires : il fut le grand promoteur des mutuelles autogérées et des associations de quartier, qui recréent du lien entre les citoyens. Ces formes d’activité économique sont fondées sur l’autonomie et le contrôle direct de l’outil de production par chaque travailleur. Un tel mutuellisme représente « un système d’équilibration entre forces libres, dans lequel chacune est assurée de jouir des mêmes droits à condition de remplir les mêmes devoirs, d’obtenir les mêmes avantages en échange des mêmes services, système par conséquent essentiellement égalitaire et libéral […]. »
Il faut « soustraire les citoyens des États contractants à l’exploitation capitaliste et bancocratique, tant de l’intérieur que du dehors » ; ces réformes établissent « par leur ensemble, en opposition à la féodalité financière […] dominante, ce que j’appellerai fédération agricole-industrielle ». Il faut faire en sorte que « le petit bourgeois, le petit propriétaire, le petit industriel, de même que le paysan, le commis et l’ouvrier », trouvent « qu’ils ont plus à gagner par le travail que par la rente et l’agio » ; c’est alors que le peuple brisera « la suzeraineté de l’argent », « ramènera à sa juste limite la propriété, changera le rapport du travail et du capital, et constituera comme le couronnement de l’édifice le droit économique ».
Le proudhonisme visait à affranchir les hommes du grand capital industriel et financier. En se liguant les uns avec les autres, par exemple sous forme de coopératives, les travailleurs indépendants pourraient préserver leur statut en se donnant les moyens de résister à la concurrence.

Retour aux marchés locaux
C’est toute la vie économique qui, à terme, se réorganiserait comme une série de mutuelles. Les populations établiraient des marchés locaux, avec éventuellement des monnaies locales. Les règles enracinées de l’économie imposeraient le principe d’une vente au prix de revient : chaque contractant serait payé au juste prix pour son travail, mais nul ne profiterait de ce que Marx appelait une « plus-value », et que Proudhon qualifiait de « droit d’aubaine ».
Tout bien de consommation serait vendu en fonction des coûts qu’il a engendrés, de la quantité de travail qu’il a demandée et du bienfait réel qu’il apporte à son propriétaire. Celui qui romprait le contrat mutuelliste et toucherait une plus-value serait immédiatement exclu de la communauté, c’est-à-dire de l’échange. L’enracinement communautaire deviendrait le garant de la justice économique.
De cette façon, on établirait un contrepoids au marché capitaliste, sans tomber dans les travers de l’administration étatique centralisée. Proudhon avait raison de dire que seul le système fédératif peut assurer un tel équilibrage. La pure anarchie politique ne le pourrait pas, car elle conduirait par inaction au laissez-faire économique, qui serait la négation de la liberté, en raison de l’esclavage économique des salariés ; et le pur étatisme ne le pourrait pas davantage, car il n’endiguerait l’esclavage économique qu’en lui substituant une tyrannie des pouvoirs publics.
Pour Proudhon, l’économie en circuit court contribue à accroître le nombre de petits propriétaires. Le grand Capital se nourrit de vente en gros : il est incapable de prospérer dans un marché local, a fortiori lorsque toute plus-value substantielle est interdite par la pression des consommateurs (tandis qu’une telle pression est beaucoup plus difficile à organiser dans une économie élargie). Le salariat disparaîtrait, et il n’y aurait pour ainsi dire plus que des travailleurs indépendants.
Lire la suite de l’article sur linactuelle.fr













 et
et  !
!