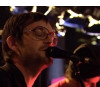Pierre Barouh, c’est une époque, l’après-guerre, les années 60, mais une mentalité, toujours présente. Petit juif planqué chez les ploucs, dans le « terroir » comme il disait, il sort de la guerre avec l’envie de ne rien faire « jusqu’à 30 ans », et tombe amoureux, lui qui n’a même pas le certificat d’études, d’un poème de Prévert.
Dès lors, il poursuivra les mots, les textes, les chansons, les pièces, et créera ce qu’on n’appelait pas encore son propre label. Un foutoir de rencontres qui débouchera sur des choix anti-marketing au possible, mais durables. De Saravah (bénédiction, en africain) sortiront Brigitte Fontaine, Jacques Higelin, Areski Belkacem et un tas d’artistes du monde. Car Pierre Barouh, c’est le Paul Simon français. Celui qui sent le mélange des musiques, qui colle du free jazz sur du gavroche parisien, qui tombe amoureux du Japon, qui part au Chili faire un documentaire pour l’émission Résistances, avec la dernière chanson de Montand à la fin, qui va chercher un tube mondial au Brésil (en fricotant avec Baden Powell), tout seul, juste par inspiration, pour transfigurer avec trois notes célèbres un film de Claude Lelouch.

« La vie, c’est l’art des rencontres »
Barouh, c’est la possibilité de faire ce qu’on aime, sans demander l’autorisation à personne, et en n’agressant personne. C’est l’émerveillement enfantin jamais tari, le plaisir artistique à l’état pur. Pour la petite histoire, personne n’a voulu des chansons d’Un Homme et une femme, il montera alors sa maison de disques tout seul. Il inspirera les plus grands auteurs compositeurs nationaux, de Francis Lai à Michel Legrand en passant par Georges Moustaki, devenu une légende de la chanson française dans le monde. On est loin, très loin des chanteurs fabriqués d’aujourd’hui, mais tout n’est pas fichu. La preuve, au milieu des produits du show-biz, parfois, sort un Allain Leprest, que Barouh n’a évidemment pas loupé.
Barouh, c’est le mariage réussi de l’exigence artistique et du grand public, ce qu’on appelle communément la culture populaire. Loin, très loin des délires spéculatifs de l’industrie du disque ou de l’art contemporain. C’est la victoire de l’instinct sur le calcul, de la vision imaginaire sur la financiarisation du secteur culturel.













 et
et  !
!