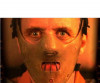Voici le résumé de l’affaire Djandoubi par Wikipédia :
Un soir de 1973, Djandoubi contraint Élisabeth à avoir des relations sexuelles tarifées avec huit autres hommes. La jeune femme porte plainte pour proxénétisme en mai 1973. Après avoir été convoqué au commissariat de police, Djandoubi jure de se venger. La plainte est classée sans suite. Il rencontre la même année deux adolescentes, Annie et Amaria, auxquelles il promet, à l’une et à l’autre, le mariage. Commence alors une relation à trois, dans laquelle progressivement la violence vient s’immiscer.
Djandoubi retrouve Élisabeth presque par hasard. Il l’invite à son domicile, où elle se rend le 3 juillet 1974. Élisabeth y subit une longue séance de torture en présence d’Anna et Amaria ; elle est frappée à coups de bâton et de ceinture et brûlée sur certaines parties du corps. Elle est ensuite transportée, nue et sans connaissance, dans la campagne, près de Salon-de-Provence, à une quarantaine de kilomètres de Marseille. Djandoubi l’entraîne dans un cabanon de pierres, où il l’achève en l’étranglant. Le corps non identifiable est retrouvé par des enfants quelques jours plus tard. Le 28 juillet 1974, il recueille une adolescente en fugue âgée de quinze ans, Houria, la séquestre et la viole.
Le 9 août 1974, Amaria et Houria, qui ont pu fuir, portent plainte au commissariat du VIe arrondissement de Marseille pour viol aggravé sur une adolescente de quinze ans, séquestration, coups et blessures et menaces de mort. Deux jours plus tard, Djandoubi est arrêté. Il reconnaît les faits et accepte de collaborer avec les autorités, notamment lors d’une reconstitution le 8 novembre 1974, espérant ainsi obtenir la clémence. Lors de son discours de 1981, Robert Badinter voit en Hamida Djandoubi un « unijambiste […] qui, quelle que soit l’horreur – et le terme n’est pas trop fort – de ses crimes, présentait tous les signes d’un déséquilibré ». Le procureur général Chauvy parle à l’époque d’« une âme démoniaque », les experts psychiatres considérant qu’il avait « une intelligence supérieure à la normale mais constituait un colossal danger social ».
Le Monde a diffusé le dossier remis à Me Badinter par la juge Monique Mabelly, commise d’office pour assister à l’exécution à l’époque, sur les derniers moments du condamné.
« On ouvre la porte de la cellule. J’entends dire que le condamné sommeillait, mais ne dormait pas. On le "prépare". C’est assez long, car il a une jambe artificielle et il faut la lui placer. Nous attendons. Personne ne parle. Ce silence, et la docilité apparente du condamné, soulagent, je crois, les assistants. On n’aurait pas aimé entendre des cris ou des protestations. Le cortège se reforme, et nous refaisons le chemin en sens inverse. Les couvertures, à terre, sont un peu déplacées, et l’attention est moins grande à éviter le bruit des pas.
Le cortège s’arrête auprès d’une des tables. On assied le condamné sur une chaise. Il a les mains entravées derrière le dos par des menottes. Un gardien lui donne une cigarette à bout filtrant. Il commence à fumer sans dire un mot. Il est jeune. Les cheveux très noirs, bien coiffés. Le visage est assez beau, des traits réguliers, mais le teint livide, et des cernes sous les yeux. Il n’a rien d’un débile, ni d’une brute. C’est plutôt un beau garçon. Il fume, et se plaint tout de suite que ses menottes sont trop serrées. Un gardien s’approche et tente de les desserrer. Il se plaint encore. À ce moment, je vois entre les mains du bourreau, qui se tient derrière lui flanqué de ses deux aides, une cordelette.
Pendant un instant, il est question de remplacer les menottes par la cordelette, mais on se contente de lui enlever les menottes, et le bourreau a ce mot horrible et tragique : "Vous voyez, vous êtes libre !…" Ça donne un frisson… Il fume sa cigarette, qui est presque terminée, et on lui en donne une autre. Il a les mains libres et fume lentement. C’est à ce moment que je vois qu’il commence vraiment à réaliser que c’est fini – qu’il ne peut plus échapper –, que c’est là que sa vie, que les instants qui lui restent à vivre dureront tant que durera cette cigarette. »
Djandoubi demandera une deuxième, puis une troisième cigarette, qui lui sera refusée. Il sera alors conduit sur le lieu de son exécution.
« La demande de cette dernière cigarette redonne sa réalité, son "identité" au temps qui vient de s’écouler. On a été patients, on a attendu vingt minutes debout, alors que le condamné, assis, exprime des désirs qu’on a aussitôt satisfaits. On l’avait laissé maître du contenu de ce temps. C’était sa chose. Maintenant, une autre réalité se substitue à ce temps qui lui était donné. On le lui reprend. La dernière cigarette est refusée, et, pour en finir, on le presse de terminer son verre. Il boit la dernière gorgée. Tend le verre au gardien. Aussitôt, l’un des aides du bourreau sort prestement une paire de ciseaux de la poche de sa veste et commence à découper le col de la chemise bleue du condamné. Le bourreau fait signe que l’échancrure n’est pas assez large. Alors, l’aide donne deux grands coups de ciseaux dans le dos de la chemise et, pour simplifier, dénude tout le haut du dos.
Rapidement (avant de découper le col) on lui a lié les mains derrière le dos avec la cordelette. On met le condamné debout. Les gardiens ouvrent une porte dans le couloir. La guillotine apparaît, face à la porte. Presque sans hésiter, je suis les gardiens qui poussent le condamné et j’entre dans la pièce (ou, peut-être, une cour intérieure ?) où se trouve la "machine". À côté, ouvert, un panier en osier brun. Tout va très vite. Le corps est presque jeté à plat ventre mais, à ce moment-là, je me tourne, non par crainte de "flancher", mais par une sorte de pudeur (je ne trouve pas d’autre mot) instinctive, viscérale. »
Robert Badinter, devenu garde des Sceaux en 1981 sous François Mitterrand, témoignera dans Le Monde en 2016 de cette exécution.
« Entre l’exécution d’Hamida Djandoubi et l’abolition de la peine de mort, le 9 octobre 1981, il y a eu de nouvelles condamnations à mort, mais plus aucune exécution. En effet, ces verdicts de mort ont tous été cassés par la chambre criminelle de la Cour de cassation. A l’époque, il n’y avait pas d’appel des arrêts de Cour d’assises. C’était donc le seul moyen de susciter un nouveau procès. J’ai été appelé à défendre ainsi, pendant cette période, cinq accusés qui avaient été condamnés à mort et dont la condamnation avait été cassée. Les cinq fois, la Cour d’assises de renvoi a refusé de prononcer à nouveau la peine de mort. »
Badinter revient sur le débat qui a agité la France en 1980-1981 :
« Ainsi la peine de mort était devenue l’un des grands sujets de la bataille électorale de 1981. François Mitterrand a eu le courage de dire qu’il était abolitionniste. Le président Giscard d’Estaing déclarait qu’il fallait attendre que le sentiment d’insécurité s’apaise. Autant dire qu’on aurait encore la peine de mort aujourd’hui… »
Un point important de cette interview, c’est l’affirmation de l’inutilité – selon Badinter – de la guillotine dans la lutte contre la criminalité.
« À cette époque, l’opinion publique n’était pas du tout favorable à l’abolition…
Le jour du débat sur l’abolition à l’Assemblée nationale, Le Figaro avait fait un sondage : 62 % des personnes interrogées se déclaraient en faveur de la peine de mort, 33 % contre. Pour les crimes "atroces", les opinions favorables atteignaient 73 %. Je savais qu’il fallait attendre une nouvelle génération pour que les esprits changent et que les Français mesurent qu’ils pouvaient vivre sans la guillotine, qui s’est révélée comme dans tous les Etats abolitionnistes inutile dans la lutte contre la criminalité. Il a fallu attendre vingt ans pour que soit commémorée l’abolition, et qu’elle soit considérée comme un honneur pour la gauche. Pour moi, c’est un grand privilège d’avoir servi cette cause en France et de l’avoir vue triompher de mon vivant. »
Aujourd’hui, il n’y a plus de peine de mort, quasiment plus de peine de prison à perpétuité, quant aux peines de sûreté, elles se font rares. Les peines de prison longues sont souvent divisées par deux, et les petites peines, inférieures à deux ans, carrément annulées. L’insécurité a littéralement explosé, qu’elle soit de basse ou de haute intensité.
Sur ce terreau, le nombre d’homicides a lui aussi augmenté (970 en 2020, le nombre le plus élevé depuis 1972). La dissuasion ne fonctionne plus et la peine de mort, qui n’est peut-être pas utile du point de vue de la dissuasion des grands crimes ou des crimes horribles, souvent le fait de psychopathes, était en fait la dernière pierre sur la pyramide des peines. En l’enlevant, c’est tout le système dissuasif qui s’est écroulé. Deux exemples parmi tant d’autres :
Des motards @prefpolice violemment agressés cette nuit Porte de Clignancourt Les attaques contre #FDO en service ou non se multiplient. Partout la #violence explose, inédite depuis des décennies. Et pendant qu’on s’enfonce, les polémiques sémantiques continuent #ensauvagement https://t.co/ra0VAsHhc9
— Thibault deMontbrial (@MontbrialAvocat) August 2, 2020
Insultes et provocations contre les #policiers, l'impunité de la #racaille en #France une réalité quotidienne.#Racailles #Police #Darmanin pic.twitter.com/bpJM4buJ8E
— Stop®️acailles (@stop_racailles) August 3, 2020
Rarement je n'ai senti autant de tensions, de rancoeurs, de haine au sein de la société française. Jamais un pouvoir n'a été aussi faible et lâche alors que nous sommes au bord du précipice. La nation ne fait plus corps, l'explosion est imminente, plus rien ne l'empêchera.
— PetitParis (@pascalfagnoux) August 2, 2020
La décapitation, pour horrible soit-elle, avait une puissance symbolique que la Justice a volontairement abandonnée. Elle a perdu sa force. En face, la violence n’a plus de retenue dans notre société et Badinter, en tranchant la tête de la dissuasion, a laissé se déchaîner les forces asociales, criminelles et délictuelles.
On le sait, en coupant la tête d’un Roi, la France s’est coupée de ses traditions, de son passé profond, de sa colonne vertébrale catholique et monarchique. De sa force.













 et
et  !
!