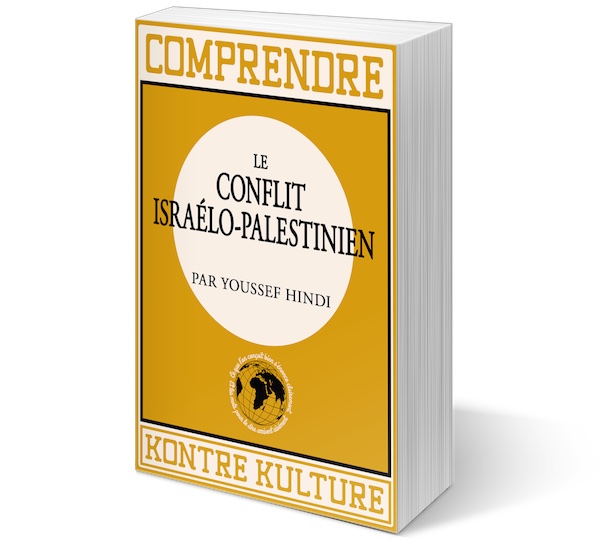1939, Joseph Kennedy, père de John Fitzgerald Kennedy (JFK), qui a été à 25 ans le plus jeune président de banque de l’histoire des États-Unis et qui depuis 1938 est ambassadeur des États-Unis au Royaume-Uni, utilise sa fortune pour préparer ses fils non pas à la guerre, dont il ne veut pas, mais à l’élection présidentielle, la course à la Maison-Blanche.
En 1939, John Fitzgerald Kennedy, dans le cadre de cette préparation, compte déjà deux voyages en Europe et particulièrement dans le Reich, il exprime son admiration, voire sa fascination, pour le Führer :
« Adolf Hitler fait partie des plus grands hommes, il a la confiance des vieux, les jeunes l’idolâtrent. C’est la vénération pour un héros national au service de son pays ».
En 1945, JFK, héros de guerre, fera un troisième voyage dans l’Allemagne vaincue, l’occasion de noter dans son journal :
« Celui qui a visité ces deux lieux [l’Obersalzberg et le Kehlsteinhaus] peut facilement s’imaginer comment Hitler parviendra à émerger de la vague de haine dont il est aujourd’hui l’objet pour apparaître comme la personnalité la plus importante qui ait jamais existé. » Il ajoute : « Une aura de mystère flotte autour de Hitler, de sa vie et de sa mort, qui ira s’épaississant, il est de l’étoffe des héros de légende. »
Sa déclaration du 26 juin 1963, « Ich bin ein Berliner » ne sortira donc pas de nulle part et peut être diversement interprétée.
En 1946, sa fulgurante carrière politique est bien lancée, il devient représentant à la Chambre des représentants. Il faut croire que sa préparation conduite par son père a été remarquablement efficace. Or, ce qu’on ignore généralement, c’est que cette préparation comptait aussi un voyage en Palestine, en 1939. JFK a alors 22 ans. L’année de ce voyage interpelle, ainsi, en 1939, un voyage en Palestine est déjà considéré comme aussi important que ce qui se passe en Europe et en Allemagne. Alors que la Seconde Guerre mondiale va éclater en septembre 1939, c’est déjà le conflit entre les Juifs et les Arabes en vue de la création de l’État d’Israël qui est au cœur des préoccupations des Kennedy.
Sans doute soucieux de montrer les progrès de sa maturité sur la voie de la présidence, suite à ce séjour en Palestine qui lui paraît une épreuve phare pour tout futur locataire de la Maison-Blanche, JFK écrit une lettre à son père. Le plus stupéfiant, c’est qu’il y fait lui-même le rapprochement entre la Palestine et le Corridor de Dantzig :
« Je pensais que Dantzig était un problème inextricable, mais je n’ai jamais vu deux parties antagonistes aussi peu disposées à essayer de trouver une solution qui ait une certaine chance de succès. »
Dès les premières lignes, on comprend que lui et son père ont déjà discuté du sujet [aussi bien de la Palestine que des Juifs] :
Son père était connu pour être critique du financement et de la création d’un État d’Israël aux temps modernes. Il est impossible d’imaginer toutes ces légendaires conversations autour de la table familiale sans que les opinions tranchées du père soient restées sans influence sur les enfants. Mais attention, le point de vue de JFK semble à la fois plus équitable et plus colonialiste : il rejette la création de deux États, non pas parce que la solution serait injuste, mais parce que les deux entités seraient à la fois trop petites et trop antagonistes pour subsister après le départ de la puissance coloniale, l’Angleterre. Il préconise une vision qui reflète et maintienne la domination blanche, qui lui paraît aller de soi : créer deux districts, un juif et un arabe, avec l’Angleterre qui maintient sa présence et sa mainmise sur Jérusalem et Haïfa pour garantir la paix entre deux tribus moyen-orientales. JFK pense en outre qu’il faut défendre la partie la plus faible, les Arabes : « Du côté juif, on observe un désir de domination totale, ils veulent Jérusalem comme capitale de leur nouveau pays où coulent le lait et le miel, et le droit de coloniser la Transjordanie. Ils estiment que si on leur en laisse l’opportunité, ils pourront cultiver la terre et la développer comme ils l’ont fait dans la partie occidentale. Les Arabes répondent d’ailleurs à cela en disant que les Juifs ont bénéficié de capitaux qui, s’ils les avaient possédés, auraient pu accomplir des miracles comparables. » Sous couvert de se faire l’écho des derniers événements, Kennedy laisse percer un antisémitisme qui paraît toutefois moins virulent que celui de son père : « Treize bombes ont été déclenchées lors de ma dernière soirée, toutes dans le quartier juif et toutes par des Juifs. Le comble, c’est que les terroristes juifs, après avoir fait sauter leurs propres lignes téléphoniques et leurs propres stations électriques, le lendemain, n’ont rien de plus pressé que d’appeler les Britanniques pour qu’ils viennent réparer… La sympathie des gens sur place semble aller aux Arabes. Non seulement parce que les Juifs ont eu, du moins chez certains de leurs dirigeants, une attitude arrogante et intransigeante particulièrement déplacée, mais aussi parce qu’ils estiment qu’après tout, le pays est arabe depuis plusieurs siècles… » Mais en dehors de cette lettre, nous savons que JFK parlait aussi aux Juifs, voire les défendait ou s’alliait avec eux. JFK est quand même le seul président à notre connaissance à avoir eu un livre édité par l’ADL, A Nation of Immigrants, ce livre a d’ailleurs en fait été rédigé par Myer Feldman, un Juif qui deviendra son conseiller à l’agriculture. JFK, à l’instigation de l’élite intellectuelle juive, agira en faveur des droits civiques et de l’abrogation des quotas d’immigration par race. Le 4 avril 1948, JFK condamne le virage de la politique américaine en Palestine et demande par écrit au président Truman la levée de l’embargo sur les armes pour que les Juifs puissent se défendre contre les Arabes. On peut également rappeler ce discours du 29 avril 1956 au Yankee Stadium à l’intention des Juifs, dans lequel il déclare dès le début : « Nous sommes ici pour célébrer la création d’Israël. » Mais, endossant peut-être le rôle qu’il voyait jadis pour la puissance coloniale déchue, la Grande-Bretagne, plus tellement grande, nous savons aussi que le président Kennedy était, au moment de son assassinat, engagé dans une bataille en coulisses avec le président israélien David Ben Gourion. JFK était furieux après le programme nucléaire israélien. En outre, JFK et son frère, le procureur général Bobby Kennedy, avaient rendu enragé les dirigeants sionistes en soutenant une enquête menée par le sénateur William Fulbright (que Kennedy avait essayé sans succès de nommer secrétaire d’État) visant à inscrire l’American Zionist Council sur la liste des « agents étrangers », prévue par la Loi FARA sur l’enregistrement des agents étrangers (Foreign Agents Registration Act), qui aurait pratiquement réduit à l’impuissance sa division du lobbying, l’AIPAC. Et en tant que sénateur, John F. Kennedy avait soutenu sans équivoque le nationalisme arabe en 1957, inversant la politique étrangère d’Eisenhower dans un sens pro-Nasser, et engageant les États-Unis à soutenir la résolution 194 de l’ONU concernant le droit au retour des réfugiés palestiniens. Cela représentait une menace majeure pour les intérêts des sionistes qui s’étaient au contraire attachés à faire de Nasser un ennemi des États-Unis. Quoi qu’il en soit, nous retiendrons de ce séjour et de cette lettre que déjà en 1939, la Palestine était un point de passage obligé dans le cursus d’un futur président Américain, avec la préoccupation sous-jacente que non seulement le « problème juif » ne serait pas résolu en Europe et aux États-Unis par l’auto-proclamation d’indépendance et la création de l’État d’Israël, mais qu’il serait poussé à son paroxysme au Moyen-Orient et en Occident, comme en témoigne quotidiennement l’actualité depuis bientôt 80 ans. Lire la lettre de JFK à son père sur jeune-nation.com













 et
et  !
!