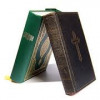Introduction : état de la question
Qu’est-ce que l’argent ? Qu’est-ce que le commerce ? Qu’est-ce que la création monétaire ? Les réponses que nous donnons à ces questions révèlent le type de religion dans lequel nous vivons. Le système monétaire actuel repose, en dépit du bon sens, sur l’usure. Comme le dénoncent de nombreux observateurs, le défaut fondamental du système financier actuel est que tout l’argent qui existe est créé par les banques sous forme de dette : les banques créent de l’argent nouveau, de l’argent qui n’existait pas auparavant, chaque fois qu’elles accordent un prêt. Ce prêt doit être remboursé à la banque, mais grossi d’un intérêt. Ce mécanisme existe en France depuis 1973 (Loi Pompidou-Giscard) (1) et depuis 1913 aux États-Unis.
Alors qu’avant 1970, l’argent consistait en métal précieux tel que l’or, il a été remplacé par un système de simple comptabilité : des chiffres sur du papier. L’argent actuel, communément appelé crédit bancaire, est entièrement artificiel, créé par certains hommes, qui ont le monopole de sa création et sa distribution. Étant purement symbolique, il n’est sujet à aucune limitation : il est aussi facile d’écrire un million que dix euros. L’argent ou crédit bancaire naît toujours sous forme de dette, c’est-à-dire, sous forme de prêt remboursable à ceux qui créent l’argent... L’argent est ainsi le moyen d’obtenir la dictature la plus globale qui ait jamais existé sur les êtres humains. Pensons au pouvoir que cette dictature exerce sur tous les aspects de nos propres vies, et tous les médias, influences et institutions qui pèsent sur nous. Cet intérêt, à la base de la création de l’argent, cause le problème économique mondial actuel : les États sont devant une impossibilité mathématique de rembourser. La banque crée certes le capital qu’elle prête, mais elle ne crée pas l’intérêt qu’elle exige en retour.
Exemple : supposons que la banque vous prête 100 euros, à 10 % d’intérêt. La banque crée 100 euros, mais vous demande de rembourser 110 euros. Vous pouvez rembourser 100 euros, mais pas 110 euros : les 10 euros pour l’intérêt n’existent pas, puisque seule la banque a le droit de créer l’argent à partir de rien, et elle n’a créé que 100 euros, pas 110 euros. Le seul moyen de rembourser 110 euros quand il n’existe que 100 euros, c’est d’emprunter aussi ces 10 euros à la banque… et votre problème n’est pas réglé pour autant, il n’a fait qu’empirer : vous devez maintenant 110 euros à la banque, plus 10 % d’intérêt, soit 121 euros… et plus les années passent, plus les dettes s’accumulent : il n’y a aucun moyen de s’en sortir.
Remarquons bien qu’à un taux d’intérêt de seulement 1 %, la dette serait encore impayable : si on emprunte 100 euros à 1%, on devra rembourser 101 euros à la fin de l’année, alors qu’il n’existe que 100 euros. Cela signifie que tout intérêt demandé sur de l’argent créé, même à un taux de 1%, est ce qu’on nomme de l’usure : un vol légal. Certains pourront dire que si on ne veut pas s’endetter, il ne faut pas emprunter. C’est tout à fait juste. Mais si personne n’empruntait d’argent de la banque, il n’y aurait tout simplement pas un euro en circulation : pour qu’il y ait de l’argent dans le pays, ne serait-ce que quelques euros, il faut absolument que quelqu’un — individu, compagnie ou gouvernement — les emprunte de la banque, à intérêt. Et cet argent emprunté de la banque ne peut pas rester en circulation indéfiniment : il doit retourner à la banque lorsque le prêt vient à échéance... accompagné de l’intérêt, évidemment.
L’usure ou prêt à intérêt consiste à prêter une somme d’argent à quelqu’un pour un temps donné, qu’il devra ensuite rembourser intégralement mais en payant en plus une somme que l’on nomme « intérêt » et qui représente une sorte de loyer versé pour la « location » de l’argent prêté.
Il s’agit donc de faire des profits sur les besoins de l’emprunteur. Très récemment, les clercs occidentaux ont imposé une distinction entre « usure » et « prêt à intérêt », l’usure étant un prêt à un intérêt très fort. Comme on le verra prochainement, chez les Pères et Docteurs, il n’existe à l’origine aucune distinction entre ces deux termes.
(1) En 1953, Georges Pompidou entra à la banque Rothschild où il occupa les fonctions de directeur général et d’administrateur de nombreuses sociétés. Il s’installa à l’Élysée le 15 juin 1969. Son mandat fut écourté par son décès le 2 avril 1974 à Paris. Le 3 janvier 1973, réforme de la Banque de France : dans la loi portant sur la réforme des statuts de la Banque de France, nous trouvons en particulier cet article 25, très court : « Le Trésor public ne peut être présentateur de ses propres effets à l’escompte de la banque de France. » Ce qui signifie en termes obscurs que l’article 25 interdit à la Banque de France de faire crédit à l’État, condamnant la France à se tourner vers des banques privées et à payer des intérêts. Avant cette loi, quand l’État empruntait de l’argent, il le faisait auprès de la Banque de France qui, lui appartenant, lui prêtait sans intérêt. Auparavant, l’État français avait le droit de battre monnaie. Avec cette nouvelle loi, il perd ce droit qui est du même coup légué aux banques privées, qui en profitent pour s’enrichir aux dépens de l’État en lui prêtant avec intérêt l’argent dont il a besoin. L’accroissement sans fond de la dette publique trouve son origine précisément dans cette loi. Le traité de Lisbonne entérine cette loi à l’article 123. Le prix Nobel d’économie Maurice Allais contestait cette création de l’argent ex nihilo : « Il est aujourd’hui, pour le moins paradoxal de constater que, lorsque pendant des siècles l’Ancien Régime avait préservé jalousement le droit de l’État de battre monnaie et le privilège exclusif d’en garder le bénéfice, la République démocratique a abandonné pour une grande part ce droit et ce privilège à des intérêts privés. »
| Pour aller plus loin, avec Kontre Kulture : | |
|---|---|













 et
et  !
!