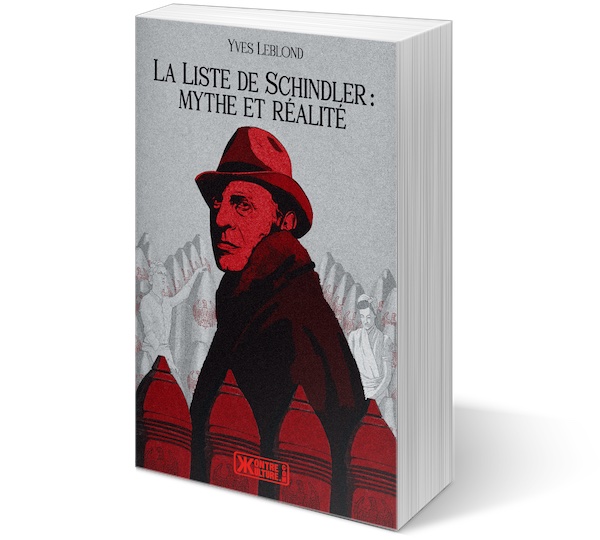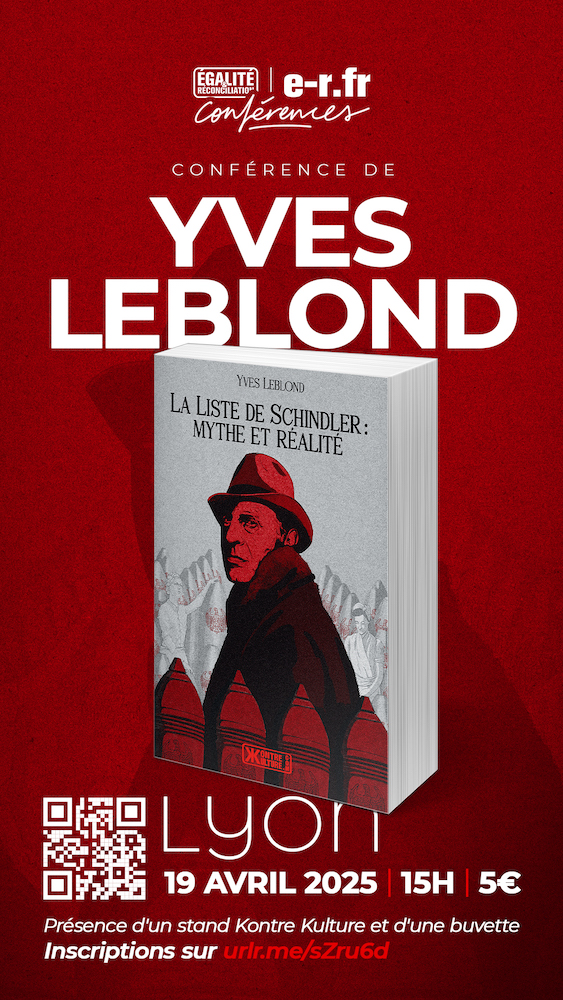Passionné d’histoire, Yves Leblond s’intéresse en particulier à l’historiographie et à la manière dont s’impose l’histoire officielle. Il vient de livrer un livre qui détruit le « mythe Schindler » chez Kontre Kulture.
Rivarol : Oskar Schindler est un Allemand des Sudètes. Il rejoint les rangs des formations qui veulent le rattachement au Reich de cette région tchécoslovaque dans sa jeunesse. Cet engagement va l’amener à être membre du NSDAP. Quelles sont les explications de ce passage dans le parti national-socialiste de ce futur héros démocratique ?
Yves Leblond : La légende imprimée dans le roman, La liste de Schindler, veut que l’adhésion à des partis pro-allemands ait facilité les affaires d’Oskar Schindler. Or, non seulement rien n’indique un tel état de fait, mais, au contraire, cela pouvait lui aliéner une majorité de la population tchécoslovaque, celle qui n’était pas d’ascendance germanique. Ce qui est plus probable – sans exclure une part d’adhésion sincère –, c’est que Schindler sentait le vent tourner et qu’il voulait être dans le camp des gagnants. C’est une clef de compréhension de sa personnalité à garder en tête.
Que pouvez-vous nous dire de sa personnalité réelle après vos recherches sur sa vie ?
Le trait le plus saillant de sa personnalité est sans aucun doute cet opportunisme que je viens d’évoquer. Le couple Schindler avait une forme particulière de cynisme qui passe pour de la bonhomie, puisque ses amitiés, reprochées si vertement à tant d’autres, sont systématiquement justifiées par la nécessité d’être aux meilleures places pour donner la pleine mesure de son prétendu altruisme. C’est ce mélange d’intelligence, d’aisance relationnelle et de sens des affaires qui caractérise avant tout Oskar Schindler. Je me dois de préciser que ce que vous appelez sa « personnalité réelle » n’est pas passé sous silence dans les œuvres de fiction qui lui sont consacrées. Pour qu’une mystification perdure, elle doit contenir la plus grande part possible d’exactitude. Le mythe Schindler repose moins sur une personnalité fantasmée que sur une prétendue soudaine inclinaison altruiste de cette personnalité.
Il est recruté par les services secrets militaires allemands. Quelle fut sa participation aux préparatifs du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale ?
Schindler prend fait et cause contre la Tchécoslovaquie en renseignant les services secrets allemands sur les capacités de l’armée tchécoslovaque, en leur fournissant des informations qu’il détient personnellement, mais aussi en organisant un petit réseau d’indicateurs qui lui sont subordonnés. Schindler sera recherché après la guerre par les autorités pour ces activités.
En Pologne, sa responsabilité s’accroît encore puisqu’il participe à l’incident dit « de Gleiwitz », durant lequel des troupes allemandes, vêtues d’uniformes polonais, s’emparent d’un émetteur radio afin de justifier l’invasion de la Pologne. Il sert également d’informateur à la Wehrmacht, lui permettant ainsi de s’emparer intact d’un tunnel essentiel à l’invasion.
Schindler est, dans une très modeste mesure, un acteur du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Cette affirmation peut sembler extravagante, mais elle l’est bien moins que celle consistant à affirmer qu’un autre « Oskar », nommé Gröning, ait pu se rendre coupable de complicité dans le meurtre de 300 000 personnes à Auschwitz en y exerçant la fonction hautement criminelle de… comptable.
Pourquoi Schindler débute-t-il son engagement en faveur des juifs polonais ?
Vous faites bien de préciser « juifs polonais », car plusieurs centaines de Polonais non-juifs sont restés esclaves de Schindler jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale et ont été totalement oubliés. Schindler aurait pris conscience de la brutalité dont étaient victimes les juifs lors de la liquidation du ghetto de Cracovie. Il aura fallu cela. Le moins que l’on puisse dire, c’est que Schindler, pourtant si vif d’esprit, n’a pas fait preuve de beaucoup de sagacité sur ce point précis.
Quoi qu’il en soit, le récit de sa prise de conscience tardive est ponctué d’erreurs grossières, comme cette note préparatoire à un projet de film qui situe en 1941 Schindler assistant à la liquidation d’un ghetto détruit en 1943. Tout indique que Schindler connaissait le projet de liquidation puisqu’il a pu avertir certaines personnes avant sa réalisation et qu’il n’y a pas assisté.
Comment se retrouve-t-il en contact avec les réseaux de soutien juifs américains aux communautés d’Europe de l’Est ?
D’après un rapport de Schindler rédigé en 1945, c’est en 1942 qu’une émanation de l’American Jewish Joint Distribution Committee, le Va-adat Ezra Vehatzala (« comité d’aide et d’assistance »), envoie à sa rencontre le docteur Rudi Sedlacek. Schindler l’oriente alors vers un autre bon samaritain, le major Franz von Korab. Il se contredit cependant dans un rapport à Yad Vashem en 1955, où il prétend que c’est au contraire von Korab qui lui a présenté Sedlacek.
Ces contacts se poursuivront tout au long de la guerre. Schindler fera au moins un voyage à Budapest pour témoigner de ce qu’il sait ou croit savoir. Ce qui semble certain, c’est qu’un canal de communication, mais aussi de transfert de fonds en faveur de Schindler, s’est alors ouvert. Il n’a donc pas assumé seul les frais de sa prétendue opération de sauvetage.
La lecture de votre livre est une suite de surprises sur l’étendue des diverses versions et légendes qui forment le « mythe Schindler ». Comment expliquer cette multiplication des épisodes totalement fantaisistes sur lui ?
Cette question mériterait à elle seule un ouvrage. Dans les périodes de grands troubles naissent aussi bien les légendes noires que les légendes blanches, sans que l’on sache laquelle précède l’autre. La transmission orale du témoignage, l’univers carcéral, la peur, l’espoir : tout cela favorise la construction de récits effrayants, et donc nécessairement de récits rassurants.
Une partie de la réponse se trouve probablement dans l’imaginaire collectif des personnes ayant relaté l’histoire de Schindler. Imprégnés de messianisme et de religiosité, ceux qui ont bâti le mythe l’ont fait à partir de leurs propres références. L’épisode des femmes juives asservies par Schindler dont le train est détourné vers Auschwitz donne lieu chez Stern à une lecture imprégnée de culture juive puisque la résolution miraculeuse de cet événement repose sur l’intervention d’une jeune femme, Hidle Albrecht, envoyée sur place avec des objets de valeur pour « négocier » leur retour avec le commandant du camp. Rien de tout cela ne s’est produit, attendu que le passage des femmes par Auschwitz était prévu, mais il est probable que l’imagination de Stern dans sa narration a posteriori ait été influencée par l’histoire d’Esther, négociant le sort des juifs auprès de Xerxès Ier.
Comment les usines de Schindler fonctionnent-elles en marge du monde concentrationnaire ? Quels étaient ses rapports avec la SS ?
Les usines de Schindler sont, dès le départ, intégrées dans la politique plus large de répression de la judéité polonaise menée par les SS. C’est d’ailleurs auprès d’eux qu’il loue sa main-d’œuvre, car il s’agit bien de location et non d’achat. Sachant que la main-d’œuvre juive est la moins chère à la location, on y voit davantage le choix d’un gestionnaire avisé que celui d’un grand altruiste.
Ses rapports avec la SS sont excellents et le resteront jusqu’à la fin de la guerre. Impardonnables pour le commun des mortels mais considérées comme des dommages collatéraux dans le cas de Schindler, ses amitiés seront justifiées par son esprit d’entreprise au début de sa carrière et par la nécessité de sauver des
juifs à la fin de celle-ci.
Quelle est la vraie histoire de la fameuse « liste de Schindler » ?
L’histoire de cette liste, si centrale dans l’histoire de Schindler qu’elle donne son nom au livre et au film qui lui sont consacrés, est parfaitement représentative du gouffre qui sépare l’objet historique de l’objet de fiction. Nous devrions tout d’abord parler des listes, mais si nous ne devions retenir que la plus célèbre, celle qui a permis aux juifs de quitter le camp de Plaszow pour être transférés à Brünnlitz, la première chose à savoir, c’est que Schindler n’était en rien impliqué dans sa rédaction. Loin de la scène de dictée enfiévrée à un Itzhak Stern, qui ne réalise qu’à la toute fin que Schindler est en train de sauver des gens au prix de sa fortune, c’est en réalité un personnage sombre, Marcel Goldberg, qui a assuré l’essentiel de cette rédaction. Goldberg est qualifié de « pourri » par ses compagnons de souffrance, et il était tellement impopulaire qu’une fois réfugié en Argentine après la guerre, il fut la cible d’une pétition lancée par d’ancien déportés pour le faire expulser. C’est cet homme, auquel Schindler semblait trouver des qualités, qui a été chargé d’établir la liste du « personnel ». Chacun s’accorde à dire qu’il était préférable de garder de quoi payer Goldberg pour s’assurer une place sur la liste… Étrange opération de sauvetage, s’il en est.
À la fin de la guerre, sa fuite est rocambolesque. Comment échappe-t-il à la dénazification ?
La guerre s’achève pour Oskar Schindler dans un vaudeville tragi-comique, où il quitte son usine dans un petit convoi comprenant sept juifs, sa femme et… sa maîtresse. Celle-ci conduit un camion qui suit Schindler, au volant de sa voiture, avec sa femme à ses côtés. Ils parviennent à franchir les lignes soviétiques, non sans que les bolcheviks violent une prisonnière juive, épargnant miraculeusement les Allemandes, dont cette racaille était pourtant très friande, et en délestant les fuyards de leurs objets de valeur. Libération oblige.
Par chance pour Schindler, après un séjour en prison consécutif à l’échec d’une tentative de passage en Suisse, un aumônier juif de l’armée française rédigera un rapport favorable après étude de son cas, ce qui lui permettra de ne pas être inquiété.
Il convient de signaler que les industriels, de manière générale, ne sont pas ceux qui ont rencontré les plus grandes difficultés lors de la dénazification, la situation de Schindler n’est donc pas si surprenante.
Sa femme, Émilie, est une personnalité complexe. Participe-t-elle à sa légende ?
Émilie Schindler, née Pelzl, est une femme modeste qui a souffert toute sa vie de sa relation avec Oskar Schindler. Constamment méprisée, elle raconte des anecdotes à propos de son mari qui, il faut bien le dire, ne vont pas dans le sens de la légende dorée. Prenons par exemple cet épisode où, prise de violentes douleurs au ventre, elle est conduite à l’hôpital avant d’apprendre qu’elle avait fait une fausse couche et qu’elle ne pourrait plus avoir d’enfant. Son mari est alors venu lui rendre visite avec sa maîtresse du moment. Ils étaient de retour de vacances à la montagne où ils avaient dépensé les 15 000 dollars qu’une organisation avait collectés pour lui. Dans ces conditions, on comprend pourquoi elle n’a pas, ou très peu, été associée au travail hagiographique.
Les « juifs de Schindler » semblent lui porter une véritable adoration. Comment expliquez-vous cela ?
Même en excluant les mécanismes psychologiques bien connus, tels que le syndrome de Stockholm, qui expliquent l’attachement des victimes à leurs bourreaux, il reste de nombreuses explications à cette adoration. Si l’on fait un effort d’empathie pour comprendre le raisonnement des « juifs de Schindler », il n’est pas surprenant que des personnes entourées d’un monde d’ennemis, convaincues que leurs coreligionnaires étaient massacrés dans des abattoirs pour humains, aient pu considérer qu’être mis aux travaux forcés, tout en étant nourris, logés et blanchis, exploités mais vivants constituait une chance extraordinaire. Donc que celui qui était à l’origine de leur asservissement leur avait évité un sort bien pire, et qu’il était digne d’admiration pour cela.
À l’inverse, son statut de « Juste » fut compliqué à établir...
C’est probablement la découverte qui m’a semblé la plus incroyable. L’examen de la candidature de Schindler au titre de Juste n’a entraîné que des refus. Les personnes chargées d’établir la réalité de son action ne partageaient pas les dispositions d’esprit favorables que je viens de décrire et préféraient s’en tenir aux faits. L’autre révélation de mon ouvrage est que c’est le succès du film qui a finalement permis à Oskar Schindler d’obtenir le statut de Juste, et ce, à titre posthume. Mordecai Paldiel, directeur du département des Justes à Yad Vashem, résume les choses très clairement : « Si Émilie Schindler n’avait pas fait le voyage jusqu’en Israël pour le tournage d’un film de Spielberg, Schindler n’aurait jamais été reconnu en tant que Juste. »
La naissance du mythe est liée à un roman australien et à un film américain. Comment Schindler va-t-il devenir un personnage de fiction et de réalité ?
C’est probablement le moment où il convient, dans certains univers mentaux, de s’interroger sur ceux à qui le crime aurait profité. De pointer un doigt accusateur sur ceux qui, dans l’ombre, auraient commandité cette fiction. Mais je préfère la rigueur. L’histoire d’Oskar Schindler, sa légende, est celle d’une rumeur qui est née dans le terreau le plus fertile à la prolifération de la rumeur : l’univers carcéral, dans un monde en guerre. La rumeur de l’action d’un héros oublié s’est propagée et a été entretenue dans un magasin de Beverly Hills par Poldek Pfefferberg, sautant sur toutes les occasions pour la faire connaître au monde. Il a finit par rencontrer Thomas Keneally, un écrivain australien, puis Steven Spielberg.
Tout cela semble bien décorrélé des décisions du département des Justes de Yad Vashem, et pourtant, c’est la fiction qui a eu le dernier mot sur les instances de « la mémoire ».
Ainsi est née la légende d’Oskar Schindler.
Je vous remercie chaleureusement pour vos questions et je salue la rédaction de Rivarol ainsi que vos lecteurs !
Disponible chez Kontre Kulture !
Pour la présentation de mon livre du 19 avril à Lyon, la moindre des choses était d'inviter le principal concerné. Mais il est pas super chaud... pic.twitter.com/y37tnk5zlW
— Yves Leblond (@YvesLeblond0) March 31, 2025













 et
et  !
!