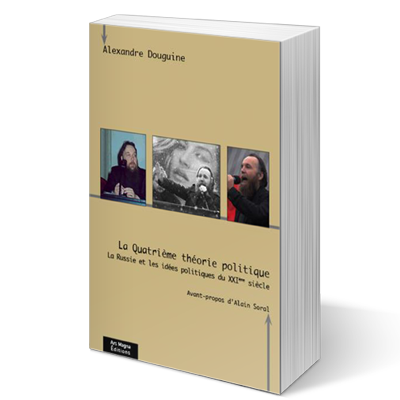Par bien des aspects, l’épisode de la menace de frappe dans l’actuelle crise syrienne rappelle celui de la crise des missiles de Cuba où le dirigeant soviétique de l’époque, Krouchtchev, au moyen de ce qui fut bien au final une savante manœuvre ponctuée d’une effrayante montée aux extrêmes, finit par concéder au président américain Kennedy la victoire morale de la confrontation (car il s’agissait, déjà, de lui sauver la face), alors que celui-ci céda en fait sur toute la ligne en retirant promptement ses propres missiles nucléaires pointés sur l’URSS à partir de la frontière nord de la Turquie. Jamais pourtant les médias de l’époque n’évoquèrent cet enjeu capital. Toujours, ils s’en tinrent à ce leurre que furent les missiles soviétiques déployés sur Cuba. Les relations internationales sont donc un véritable métier, tout comme la stratégie est un art.
Un des principes fondamentaux de cet art est qu’il ne faut jamais être « décelable » par la partie adverse. Par conséquent c’est bien ce qui ne se voit pas, et dont on ne parle pas, qui est vraiment déterminant. Atteindre cette connaissance est l’un des buts du renseignement, et pour cela, il lui faut s’abstraire des miasmes médiatiques et autres scories propagandistes.
Le spectre des frappes s’éloigne en Syrie mais il reviendra, sous une forme ou une autre. Pourquoi n’ont-elles pas eu lieu ? Jusqu’à présent, en effet, rien ne semblait pouvoir endiguer « facilement » dès lors qu’elle était enclenchée, cette dynamique, ou frénésie pour certains, de guerres menées au nom du droit d’ingérence, principalement par les pays occidentaux, et ceci depuis la disparition de l’Union soviétique.
Très clairement, la guerre en Syrie a marqué pour la première fois un véritable tournant, ou point d’inflexion, dans cette dynamique de conflit. Clausewitz en apporte l’explication, le qualifiant de « point culminant », autrement dit ce moment précis et observable dans tous conflits où les efforts déployés par l’un des belligérants finissent par produire des effets inverses à ceux recherchés.
Or, pour tout « professionnel » qui se respecte, le point culminant n’est pas autre chose que le signal précurseur d’une défaite qui s’annonce dès lors que les capacités ne maîtrisent plus leurs effets ! Il devient alors évident que la question n’était plus de savoir quand, comment et où frapper mais bien plutôt comment en sortir « sans perdre la face ». Ce que Russes et Américains comprirent manifestement très vite et s’attachèrent à réaliser tout aussi promptement au prétexte de destruction de stocks d’armes chimiques, et par une de ces pirouettes diplomatiques dignes des vieilles grandes puissances à la fois opposées et complices, au nom de cet autre principe simple de la stratégie qu’énonce Talleyrand : « Il n’y a pas d’amis ou d’ennemis permanents, il n’y a que des intérêt permanents. » On notera au passage qu’ils suscitèrent en même temps surprise et la colère parmi les alliés les plus engagés des Américains, et donc les plus exposés aux contre-coups qui s’annoncent.
Le tournant stratégique syrien
Pour surprenant qu’il puisse apparaître, ce tournant stratégique n’a rien d’une surprise car la guerre précédente, celle de Libye, était prémonitoire pour les observateurs avertis : le déni particulièrement flagrant du droit international s’autorisant, jusqu’à l’exécution dans des conditions parfaitement ignominieuses d’un chef d’État, sans parler du massacre indistinct des populations, ne pouvait désormais apparaître que comme une menace insupportable à ceux qui pourraient être désignés ou s’opposeraient à cette ingérence armée. Il fallait donc naturellement s’attendre à un coup d’arrêt sur le coup d’après, simple raisonnement de tactique élémentaire, le choix de la cible venant dans le cas présent faire le reste.
On notera au passage que ne l’avoir pas compris signe qu’une certaine forme d’incompétence préside bien à l’engagement de ces guerres : vouloir la guerre est en effet une chose, savoir la faire en est une toute autre.
D’emblée, un certains nombre d’éléments structurants se dégagent du conflit syrien qui le différencient nettement des précédents conflits d’ingérence.
Pour la première fois et contrairement aux régimes de Saddam, de Milosevic, des talibans, du « chamelier fou » ou d’autres, le régime syrien qu’on se promettait d’abattre facilement résiste si efficacement, après plus de deux années et demie de guerre, que les États-Unis se retrouvent acculés à devoir agir pour éviter la défaite des « rebelles » qu’ils soutiennent.
Pour la première fois depuis l’initialisation des guerres d’ingérence, la machine d’influence et de propagande mainstream (les médias occidentaux, dits mainstream, du fait de leur parfaite unité de ton et parce qu’ils ne relèvent d’abord que de la logique économique plutôt que de la logique informationnelle, sont devenus l’un des trois moyens clés des guerres d’ingérence, les deux autres étant l’armée US et le mercenariat djihadiste terroriste international), pourtant extrêmement puissante, échoue à rallier l’opinion publique occidentale à la perspective des frappes américaines : par une espèce de sursaut démocratique, le parlement britannique désavoue Cameron et, beaucoup plus grave, le congrès US se promet de faire de même face à Obama. Le pouvoir français se retrouve alors totalement isolé en Europe.
Pour la première fois, l’alliance occidentale (réduite en fait à trois pays) doit faire face à l’opposition déterminée de deux membres du Conseil de sécurité, la Chine et la Russie, lesquelles se partagent les tâches pour organiser le blocage des frappes.
Pour la première fois, une puissance régionale (l’Iran), sinon deux (l’Irak), se montrent également déterminées à soutenir le régime syrien (notamment par la présence du Hezbollah, une acteur majeur dans l’encadrement des milices d’autodéfense syrienne).
Pour la première fois, la puissance militaire américaine va se trouver confrontée à une menace enfin « à sa pointure » du fait de la combativité syrienne et de son aguerrissement, mais surtout grâce au rattrapage militaire technologique et tactique lié à l’appui russe, qui expose toute frappe américaine à une contre-frappe extrêmement dangereuse, annulant au passage l’impératif politique de ne pas engager directement les forces américaines.
Pour la première fois enfin, l’opposition déterminée du commandement américain contre le principe de ces frappes apparaît au grand jour. Ce commandement, plus raisonnable que l’État profond américain, anticipe amplement les risques inconsidérés, sécuritaires d’abord pour les forces américaines et politiques ensuite au plan international ; mais c’est surtout le doute lié à l’absence de toute perspective de contrôle de la situation post-frappe qui prédomine ainsi que l’extension prévisible d’un conflit qui ne manquera pas de tourner « à l’irakienne ».
Par conséquent, les conditions d’un engagement à la fois utile et sans conséquences politiques internes n’étant plus réunies, s’impose la nécessité de sortir d’une logique fermée de « go, no go ».
Poursuite du conflit
La seule question qui vaille ne porte cependant que sur ce qu’il peut advenir. Sans les frappes, la guerre va se poursuivre mais en changeant de signification. Par ailleurs, malgré ou à cause d’une propagande tapageuse, l’absence de preuve sur la responsabilité effective des attaques chimiques sensées légitimer les frappes, constitue une défaite psychologique et le début d’une suspicion cette fois légitime et généralisée concernant le va-t-en-guerrisme. Au plan international, la situation actuelle marque donc un recul effectif de l’Occident ainsi que la limite des capacités américaines à s’ingérer par les armes.
Il n’est cependant pas suffisant pour modifier les intentions d’éliminer le pouvoir syrien, mais il en modifie significativement le contour des capacités réelles à transformer ces intentions.
Ce recul occidental ne sera cependant que tactique et durera le temps de trouver d’autres voies pour relancer l’action.
Ces intentions belliqueuses – et la menace qu’elles représentent – restant inchangées. Ce temps sera cependant mis à profit aussi par la partie qui s’y oppose (Russie, Chine, Syrie, Iran) afin de se préparer à la prochaine phase cruciale du conflit, mais cette fois-ci en position de force.
Dans l’intervalle, le conflit sera entretenu par les deux alliés des États-Unis, aussi « turbulents » que déterminés, à savoir l’Arabie Saoudite et Israël. Ces deux pays, pour des raisons qui leur appartiennent, considèrent en effet comme vital d’éliminer le régime syrien et la Syrie en tant que puissance régionale. Chacun dispose des moyens pour entretenir le conflit, l’un par son savoir-faire et ses instruments de puissance, l’autre par des moyens financiers illimités et son emprise sur les organisations terroristes wahhabites (lesquelles représentent de 50 à 70 % des forces « rebelles » estimées à plusieurs dizaines de milliers de combattants, la plupart internationaux).
C’est bien de cette ambiguïté dans la manipulation du terrorisme que dépendra l’avenir du conflit. La confrontation reste explosive et promet d’évoluer selon deux logiques parfaitement antagonistes.
Le conflit sera entretenu dans le but d’achever le régime par l’usure et selon la croyance qu’il s’agit d’une guerre d’abord économique, dont l’issue ne dépendra que du différentiel de financement entre les camps qui s’affrontent. Il s’agira d’alimenter cette guerre avec plus de moyens que ne peut en aligner l’adversaire syrien. Le conflit s’étendra aussi sur la base des migrations qu’imposeront les groupes terroristes. Les migrations s’opéreront probablement dans trois directions : les pays limitrophes de la Syrie (déstabiliser le Liban et la Jordanie), le Caucase (menacer directement les intérêts de la Russie, les jeux de Sotchi par exemple) et l’Afrique (où le djihadisme est à la fois déjà bien implanté).
À cela s’ajoutera, évidemment, le retour des « combattants » aguerris d’origine européenne qui, revenant de Syrie, ne manqueront pas de donner quelques fils à retordre à ceux qui, aujourd’hui, les forment et les arment. Nos politiques devront peut-être alors s’interroger sur le sang français et européen qu’ils auront sur les mains.
Selon de degré de perception de la menace liée à ces migration, émergera alors peut-être, chez ceux qui ont en charge de la combattre, le besoin de remonter aux « origines du mal », autrement dit aux commanditaires du Golfe.
Dans cette perspective, il est aussi un facteur qu’il serait particulièrement dangereux de négliger. C’est celui de la crise économique qui affecte tout particulièrement les pays occidentaux mais qui touche également les pays émergents.
À titre d’exemple, l’armée américaine, qui subit une réduction drastique de son budget, voit déjà ses moyens se réduire. Outre qu’elle influe directement sur les aspects capacitaires, la crise économique joue aussi psychologiquement sur les velléités guerrières, ce qui explique partiellement le comportements du parlement britannique, du congrès américain ainsi que l’hostilité aux frappes, majoritaires dans les populations européennes.
Toujours, sous l’effet de la crise économique, des voix s’élèvent aux États-Unis pour réclamer une révision stratégique. Estimant l’hégémonie américaine désormais assurée par le renouveau énergétique (espéré) des gaz de schiste et par l’espoir que la crise stoppera la croissance des économies émergentes, ces voix demandent, en particulier, le désengagement militaire du Proche-Orient et ceci de manière prioritaire.
En fait, le monde unipolaire qui naît de la disparition de l’URSS ne fut pas un début mais plutôt une fin. En même temps, la Chine, qu’on traitait alors avec de la verroterie condescendante, se hisse, en moins d’une génération, au rang de menace principale, avec la Russie, de l’hégémonie des États-Unis. Elle symbolise parfaitement ce retour d’un monde dit (ré)émergent que la longue domination occidentale avait fini par faire oublier. Ce qui se joue vraiment aujourd’hui n’est donc plus l’hégémonie américaine mais la mutation entre deux mondes devant aboutir à une organisation internationale « multipolaire ». Il s’agit de la juxtaposition de systèmes économiques, de plaques. Une phase de transition conflictuelle s’annonce dure et obligera à des alliances d’intérêts qui peuvent provoquer, temporairement une nouvelle bipolarité. En multipliant les guerres d’ingérence, le monde occidental ne fait que précipiter cette phase de mutation.
Hector (pseudonyme d’un ancien haut responsable du renseignement militaire français)













 et
et  !
!