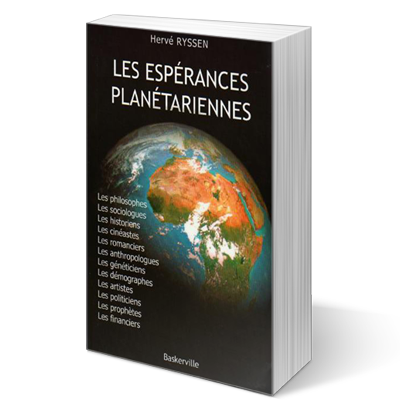Les assassins financiers sont des professionnels grassement payés qui escroquent des milliards de dollars à divers pays du globe. Ils dirigent l’argent de la Banque mondiale, de l’Agence américaine du développement international (U.S. Agency for International Development – USAID) et d’autres organisations « humanitaires », vers les coffres de grandes compagnies et vers les poches de quelques familles richissimes qui contrôlent les ressources naturelles de la planète. Leurs armes principales : les rapports financiers frauduleux, les élections truquées, les pot-de-vin, l’extorsion, le sexe et le meurtre. Ils jouent un jeux vieux comme le monde, mais qui atteint des proportions terrifiantes en cette époque de mondialisation. Je sais très bien de quoi je parle… car j’ai été moi-même un assassin financier. » – John Perkins
Après plus de vingt années d’hésitation, entre menaces et dessous-de-tables influençant son silence, John Perkins s’est enfin repenti en 2004, dans son livre Les confession d’un assassin financier, pour son rôle criminel dans la manipulation des économies du monde pour le compte des États-Unis.
Naissance d’un assassin financier
À tout juste vingt-trois ans, et une modeste licence d’administration commerciale en poche, John Perkins fut profilé par la NSA (National Security Agency), grâce à son influent « oncle Frank » alors cadre supérieur dans l’agence de renseignement.
Il passa notamment une journée d’épuisants interrogatoires sous détecteur de mensonge durant laquelle ses recruteurs explorèrent sa personnalité profonde. Ils s’intéressèrent particulièrement à sa rébellion envers son éducation puritaine, et ses frustrations causées par le manque de femmes et d’argent.
Mais surtout, ils s’attardèrent sur sa farouche capacité à mentir aux autorités, comme ce jour où, encore étudiant, il couvrit un camarade s’étant rendu coupable d’une altercation à l’arme blanche.
Facile à séduire, bon communiquant, et capable de mentir avec aplomb, voilà que Perkins avait brillamment passé les examens d’entrée de l’agence de renseignements la plus importante du pays.
Aussitôt une formation d’espion lui fut proposée, mais cependant, Perkins préféra s’engager au sein des Peace Corps : une agence fédérale américaine qui envoyait des volontaires aux quatre coins du monde lors de longues missions afin de « fraterniser » avec les populations indigènes.
À sa grande surprise, l’oncle Frank l’encouragea dans sa démarche, lui confiant prophétiquement : « Il se peut très bien que tu finisses par travailler pour une compagnie privée plutôt que pour le gouvernement. »
Ainsi pendant plus de deux ans Perkins vécut avec les tribus Shuars, et travailla dans les Andes avec les descendants des Incas. Puis un jour, un homme d’affaire atterrit sur la piste de leur communauté, le vice président de Chas. T. Main Inc (MAIN) : Einar Greve.
Cette firme de consultation internationale très discrète effectuait des études pour déterminer si la Banque mondiale devait prêter des milliards de dollars à l’Équateur, ou d’autres pays voisins, pour y construire des barrages hydroélectriques et d’autres infrastructures.
Perkins n’hésita pas à s’engager auprès d’Einar, et ce même après avoir lutté au quotidien avec les indigènes contre les pratiques destructrices des compagnies pétrolières et autres agences gouvernementales. Sa connaissance familière du terrain lui permit ainsi de fournir des rapports sur l’économie et la politique du pays.
Sans vraiment le savoir, John Perkins balbutiait sa future carrière d’assassin financier. Dès son retour d’Amérique du Sud, en janvier 1971, il se vit offrir un poste d’économiste à MAIN…
La corporatocratie
À la fin des années soixante, en pleine Guerre Froide et alors que le conflit vietnamien s’enlisait sous des nuées de napalm, les États-Unis imaginèrent de nouvelles stratégies, plus implicites mais tout aussi offensives, afin de réaliser leur rêve impérial.
Ils soumirent divers pays clés, en encourageant leurs dirigeants à s’intégrer à un vaste réseau promouvant leurs propres intérêts commerciaux. Ce fut la seule façon de devancer le rival communiste sans impliquer Washington directement, condition sine qua none pour ne pas déclencher un holocauste nucléaire…
Ainsi la corporatocratie émergea, et offrit des perspectives jusque là inégalées.
Ce terme cher à John Perkins synthétise la relation symbiotique que développèrent alors gouvernements, compagnies multinationales et banques internationales. Cette association favorisa ainsi la promotion d’entrepreneurs influents à des postes gouvernementaux.
À l’image d’un Robert McNamara, dont la carrière le mena du poste de président de Ford Motor Company à celui de secrétaire à la Défense sous les présidences de Kennedy et de Johnson… pour enfin diriger la plus puissante institution financière de la planète : la Banque mondiale.
Mode d’emploi :
Tout d’abord, les agences de renseignements américaines, comme la NSA, dénichaient de potentiels assassins financiers, qu’engageaient par la suite des compagnies internationales. De la sorte, ces hommes n’étaient pas payés par le gouvernement, qui n’encourrait alors aucune responsabilité si le sale boulot de ses assassins était dévoilé au grand jour. La cupidité entrepreneuriale endosserait le délit.
Ensuite, ces « économistes » spéculaient sur les effets qu’auraient l’investissement de milliards de dollars dans des pays au fort potentiel énergétique et géopolitique comme la Colombie, l’Indonésie, le Panama, ou l’Équateur.
Ces études gonflées tendaient à démontrer que la construction d’un complexe hydroélectrique, d’un réseau ferroviaire nationale, ou d’un aéroport, aurait pour conséquence une croissance économique bénéfique pour les décennies à venir.
L’objectif étant le suivant : inciter par l’appât du gain et la promesse d’un soutien politique, les dirigeants des pays ciblés à accepter les prêts extravagants que leur avaient soigneusement préparé la Banque mondiale et le FMI.
Mais ce n’était pas sans condition : seules des compagnies d’ingénieries et de construction américaines, comme MAIN, Halliburton ou Bechtel, pouvaient être engagés pour réaliser les projets. Ainsi, l‘argent prêté retournait quasi immédiatement nourrir l’économie américaine… ne restait plus aux pays récipiendaires qu’à rembourser la note : capital et intérêts !
Si un assassin financier avait bien fait son travail, le débiteur faillait immanquablement à ses engagements. Menés à la banqueroute, les États surendettés étaient maintenant redevables à jamais à leurs créanciers, assurant ainsi l’obtention de faveurs comme : l’implantation de bases militaires, des votes favorables aux Nations-unies, ou un accès privilégié au pétrole et autres ressources naturelles…
Dans le cas contraire, si l’alléchante « aide » internationale suggérée ne suffisait pas à corrompre certains gouvernants, une autre espèce encore plus sinistre entrait en scène : les chacals ! Quand ils sortent de leur tanière, des chefs d’État sont renversés ou meurent dans des « accidents » violents.
Ce fut le cas des insoumis présidents socialistes du Panama et de l’Équateur, Omar Torrijos et Jaime Roldos, qui en 1981, disparaîtront à deux mois d’intervalle dans de mystérieux crashs d’avion et d’hélicoptère…
Et si par hasard les chacals échouaient à leur tour, comme en Afghanistan ou en Irak, les vieux réflexes hégémoniques ressurgissaient : de jeunes Américains étaient envoyés au combat, pour tuer et envahir.
Rachat ?
John Perkins exerça ses talents d’assassin financier pendant dix ans. Suite à son éclatante participation dans une sale affaire de « blanchiment d’argent Saoudien », il fut promut directeur de la planification économique régionale. Après quoi il dirigea d’importants projets en Afrique, Asie, Amérique Latine, Amérique du Nord et au Moyen-Orient.
À la grâce d’une rencontre avec une Colombienne, il prit conscience de son immense responsabilité dans l’exploitation des déshérités et du pillage de la planète. En proie à une vive culpabilité et à une profonde dépression, il finit par démissionner en 1980…













 et
et  !
!