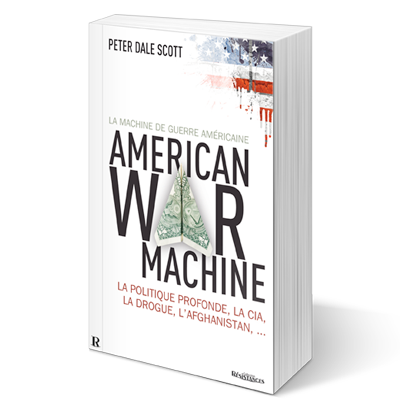Peter Dale Scott est docteur en sciences politiques, professeur émérite de littérature anglaise à l’université de Californie (Berkeley), poète et ancien diplomate canadien. Son dernier livre, La Machine de guerre américaine, a été publié par les Éditions Demi-Lune en octobre 2012. Il a été vivement recommandé par le général d’armée aérienne Bernard Norlain dans le numéro 757 de la Revue Défense Nationale (février 2013). En voici un extrait exclusif.
L’addiction des États-Unis à une guerre alimentée par la drogue : l’Afghanistan dans les années 1980
Il est difficile de démontrer que la CIA, lorsqu’elle amorça unilatéralement un conflit armé au Laos en 1959, avait prévu la considérable augmentation de la production laotienne d’opium engendrée par cette guerre. Cependant, deux décennies plus tard, cette expérience ne dissuada point Zbigniew Brzezinski, le conseiller à la Sécurité nationale de Carter, d’établir un contact avec des trafiquants de drogue afghans en 1978 et en 1979.
Il est clair qu’à cette époque, l’administration Carter avait anticipé les conséquences de ses actes. En 1980, David Musto, le conseiller en matière de stupéfiants du président Carter, déclara au Conseil stratégique de la Maison Blanche sur l’abus de drogue que « nous [allons] en Afghanistan pour soutenir les cultivateurs d’opium. [...] Ne devrions-nous pas tenter d’éviter ce que nous avons fait au Laos ? [1] » La CIA lui ayant refusé l’accès à des données qu’il pouvait légalement consulter, Musto rendit publiques ses inquiétudes en mai 1980, relevant dans une tribune libre du New York Times que l’héroïne du Croissant d’Or était déjà en train de provoquer, pour la première fois, une crise de santé publique à New York. Par ailleurs, il fit preuve de clairvoyance en alertant l’opinion sur le fait que « cette crise était sur le point de s’aggraver [2] ».
En coordination avec la SAVAK – l’agence de renseignement iranienne qu’elle avait créée –, la CIA tenta initialement d’amplifier la pression exercée par les forces de droite sur le président afghan Mohammed Daoud Khan. Sa politique, jugée inacceptable comme celle de Souvanna Phouma avant lui, consistait à maintenir de bonnes relations tant avec l’Union soviétique qu’avec l’Occident. En 1978, la SAVAK, accompagnée d’agents islamistes soutenus par la CIA, arriva d’Iran « avec une abondance de fonds ». Ils tentèrent ainsi de provoquer une purge des officiers communistes au sein de l’armée, ainsi qu’une vague de répression contre la famille politique de ces derniers, le Parti démocratique populaire d’Afghanistan (PDPA) [3].
Le résultat de cette polarisation déstabilisante fut le même qu’au Laos : une confrontation durant laquelle l’extrême gauche, et non la droite, triompha très rapidement [4]. Lors d’un coup d’État, qui était au moins partiellement défensif, des officiers d’extrême gauche tuèrent Daoud ; ils installèrent à sa place un régime communiste si extrême et impopulaire qu’en 1980, l’Union soviétique choisit d’intervenir pour installer une faction plus modérée dans ce pays, comme Zbigniew Brzezinski l’avait prévu [5].
Dès mai 1979, la CIA était en contact avec Gulbuddin Hekmatyar, le seigneur de guerre moudjahidine qui avait probablement le moins de partisans en Afghanistan, et qui était aussi le principal trafiquant de drogue parmi les jihadistes [6]. Connu pour jeter de l’acide au visage des femmes ne portant pas la burqa, Hekmatyar avait été choisi non par la résistance afghane mais par l’ISI. Ce choix pourrait s’expliquer par le fait qu’il était alors le seul leader afghan disposé à accepter la ligne Durand – la frontière entre l’Afghanistan et le Pakistan tracée par les Britanniques. Comme un chef afghan l’a déclaré en 1994 à Tim Weiner, un reporter du New York Times : « Nous n’avons pas choisi ces leaders. Les États-Unis ont créé Hekmatyar en lui donnant les armes dont il dispose. À présent, pour nous sauver de ces gens, nous voulons que les États-Unis les bousculent et les contraignent à s’arrêter de tuer [7]. » Robert D. Kaplan rapporta de son expérience personnelle qu’Hekmatyar était « craint par tous les autres chefs de partis, aussi bien fondamentalistes que modérés [8] ».
L’ISI transmit les fonds américains qu’elle partageait entre deux groupes fondamentalistes marginaux – la faction de Gulbuddin Hekmatyar et celle d’Abdul Rasul Sayyaf [9]. L’ISI savait qu’elle pouvait les contrôler, précisément du fait de leur manque de base populaire. Cette décision dément l’habituelle rhétorique américaine voulant que les États-Unis aidaient alors un mouvement afghan de libération [10]. Les groupes de résistance ayant une assise populaire, organisés sur les lignées tribales, étaient hostiles à cette influence salafiste et jihadiste : ils étaient « rebutés par les demandes des fondamentalistes visant à abolir la structure tribale, incompatible avec la conception [salafiste] d’un État islamique centralisé [11] ».
Pendant ce temps, Hekmatyar, avec la protection de l’ISI et de la CIA, commença immédiatement à compenser son absence de soutien populaire en développant un réseau de trafic international d’opium et d’héroïne. Il n’était pas isolé dans cette initiative, bénéficiant d’une aide de l’ISI et de l’étranger. Suite à l’interdiction par le Pakistan de la culture du pavot en février 1979, puis par l’Iran au mois d’avril suivant, les régions pachtounes du Pakistan et de l’Afghanistan « attirèrent des cartels narcotiques occidentaux et des “scientifiques”, [incluant des “aventuriers” européens et américains voulant s’enrichir,] pour qu’ils établissent des laboratoires d’héroïne dans la ceinture tribale [12] ».
En 1979, ces labos avaient été mis en place dans la province de la Frontière du Nord-Ouest (un fait dûment relevé par le magazine canadien Maclean’s du 30 avril 1979). Selon Alfred McCoy : « Dès 1980, l’opium pakistano-afghan dominait le marché européen et fournissait également 60 % des besoins illicites des États-Unis [13]. » McCoy rappelle également que Gulbuddin Hekmatyar contrôlait un complexe de six laboratoires d’héroïne dans une région du Baloutchistan « où l’ISI exerçait un contrôle total [14] ».
Les conséquences de tout cela se firent très vite ressentir aux États-Unis, où l’héroïne du Croissant d’Or, dont la proportion était négligeable avant 1979, représentait 60 % du marché américain en 1980 [15]. En 1986, pour la première fois, cette région fournissait à l’échelle mondiale 70 % de l’héroïne de haute qualité, et elle approvisionnait une nouvelle armée de 650 000 toxicomanes rien qu’au Pakistan. Des témoins confirmèrent que la drogue était acheminée hors de cette zone par les mêmes camions de l’armée pakistanaise qui livraient de l’aide militaire américaine « clandestine » [16].
Pourtant, avant 1986, la seule saisie importante d’héroïne au Pakistan avait été réalisée grâce à l’insistance d’un procureur norvégien ; pas une seule ne fut initiée par les 17 officiers des services des stupéfiants de l’ambassade US. À New York, 8 tonnes de morphine-base pakistano-afghane, d’une source pakistanaise unique, approvisionnèrent la « Pizza Connection ». Selon un superviseur du FBI qui était proche de l’affaire, cette branche new-yorkaise de la mafia sicilienne aurait été responsable de 80 % de l’héroïne atteignant les États-Unis entre 1978 et 1984 [17].
Durant cette période, William Casey, alors directeur de la CIA, semble avoir mis en œuvre un plan suggéré en 1980 par l’ancien chef des renseignements extérieurs français, Alexandre de Marenches. D’après ce projet, l’Agence devait discrètement fournir des drogues aux troupes soviétiques [18]. Bien que de Marenches ait démenti ensuite l’exécution de ce plan, baptisé opération Mosquito, des rapports indiquent que de l’héroïne, du hachisch et même de la cocaïne d’Amérique latine parvinrent rapidement aux soldats soviétiques. Par ailleurs, ces rapports affirment également qu’avant la fin de la guerre, « une poignée d’agents des renseignements américains étaient profondément impliques dans le trafic de drogue » ; ils agissaient de concert avec la BCCI [19] liée à l’ISI et à la CIA [20]. Mathea Falco, chef du Contrôle international des drogues (International Narcotics Control) au Département d’État de l’administration Carter, confirma à Maureen Orth que la CIA et l’ISI encourageaient conjointement les moudjahidines à rendre accros les soldats soviétiques [21].
Selon le Département d’État américain, en 2007, l’Afghanistan fournissait 93 % de l’opium mondial. Dans le même temps, d’après l’Office des Nations unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC), la production illicite de pavot rapportait 4 milliards de dollars à l’Afghanistan [22], soit plus de la moitié de l’économie totale du pays, qui s’élevait à 7,5 milliards de dollars [23]. Elle représentait également environ un tiers de l’économie du Pakistan, et une manne considérable pour l’ISI en particulier, dont certains éléments étaient devenus essentiels dans le trafic de drogue en Asie centrale. En 1999, le Programme des Nations unies pour le contrôle international des drogues estima que l’ISI empochait annuellement 2,5 milliards de dollars grâce au narcotrafic illégal [24].
2001 : le retour des États-Unis en Afghanistan, de nouveau avec le soutien des trafiquants de drogue
Les coûts sociaux de cette guerre alimentée par la drogue continuent de nous affecter. Par exemple, il y aurait aujourd’hui 5 millions d’héroïnomanes au seul Pakistan. Et pourtant, en 2001, les États-Unis, avec l’aide des trafiquants, relancèrent leurs tentatives d’imposer un processus d’édification nationale à un quasi-État, comptant au moins une douzaine de groupes ethniques majeurs parlant des langues différentes. D’une manière qui rappelle l’utilisation des Hmongs au Laos, les États-Unis lancèrent leur campagne afghane en coordination avec une minorité distincte, l’Alliance du Nord dominée par les Tadjiks. Pour faire une analogie encore plus proche, la CIA – dans les dernières semaines de la présidence Clinton en 2000 –, choisit comme principal allié Ahmed Shah Massoud de l’Alliance du Nord. Cette décision fut prise malgré les objections de certains conseillers à la Sécurité nationale, sachant que « Massoud était un trafiquant de drogue ; si la CIA établissait une base permanente [avec lui] au Panshir, elle risquait d’être happée dans le trafic d’héroïne [25] ».
L’intention qu’avaient les États-Unis d’utiliser des trafiquants de drogue pour se positionner sur le terrain en Afghanistan n’avait pas la moindre ambiguïté. En 2001, la CIA créa sa propre coalition pour lutter contre les Talibans en recrutant – et même en important – des trafiquants de drogue, qui étaient en principe d’anciens alliés des années 1980. Parmi eux, nous pourrions citer Haji Zaman, alors retiré en France (à Dijon), que « des responsables britanniques et américains […] rencontrèrent et persuadèrent […] de retourner en Afghanistan [26] ».
Comme au Laos en 1959 et en Afghanistan en 1980, l’intervention américaine a été une aubaine pour les cartels internationaux de la drogue. Avec l’amplification du chaos dans les zones rurales afghanes et celle du trafic aérien, la production d’opium fit plus que doubler, passant de 3 276 tonnes en 2000 (mais surtout de 185 tonnes en 2001, l’année où les Talibans l’interdirent) à 8 200 tonnes en 2007.
Pourquoi les États-Unis interviennent-ils souvent du même côté que les plus puissants trafiquants de drogue locaux ? Voilà quelques années, j’ai résumé l’opinion communément admise sur cette question :
« Ceci est en partie dû à des raisons de realpolitik – du fait de la reconnaissance des réalités du pouvoir local incarné par le trafic de drogue. On peut également l’expliquer par la nécessité d’échapper aux contraintes politiques intérieures : jusqu’à présent, les trafiquants ont apporté des ressources financières additionnelles, rendues nécessaires par les restrictions budgétaires des États-Unis. Ils ont également fourni des alliés non contraints par les règles de la guerre (contrairement aux forces américaines). […] Ces faits […] ont conduit à la pérennisation de réseaux de renseignement impliquant aussi bien le pétrole que les drogues, ou plus spécifiquement les pétrodollars et les narcodollars. Ces réseaux, en particulier au Moyen-Orient, sont devenus si importants qu’ils influencent non seulement la conduite de la politique étrangère américaine, mais également la nature et le comportement du gouvernement des États-Unis, des banques et des entreprises de ce pays. En réalité, ils influencent la société américaine dans son ensemble [27] »
Convaincu en partie par les analyses d’auteurs tels que Michel Chossudovsky et James Petras, j’insisterais encore plus lourdement maintenant sur le fait que les banques américaines tirent d’énormes profits du trafic de drogue, à l’instar des majors pétrolières. Un rapport d’une commission d’enquête du Sénat a estimé « qu’entre 500 et 1 000 milliards de dollars de recettes criminelles sont blanchis par les banques chaque année, la moitié de ces fonds circulant à travers les banques des États-Unis [28] ». En 2004, l’Independent de Londres rapporta que le trafic de drogue constituait « le troisième marché global, en termes de liquidités, après le pétrole et le commerce des armes [29] ».
Petras en conclut que l’économie américaine est devenue une économie narco-capitaliste, impliquant d’énormes sommes d’argent sale ou de capitaux clandestins, provenant principalement du trafic de drogue :
« Washington et les médias de masse ont décrit les États-Unis comme étant aux avant-postes de la lutte contre le narcotrafic, la corruption politique et le blanchiment de l’argent généré par la drogue : l’image habituellement véhiculée est celle de mains blanches et propres combattant l’argent sale du Tiers-Monde (ou des ex-pays communistes).
La vérité est exactement inverse.
Les banques américaines ont développé un ensemble très complexe de règles afin d’organiser le transfert de fonds illicites vers les États-Unis, ce qui permet d’investir ces sommes dans des affaires légales ou dans des bons du gouvernement US – contribuant ainsi à leur valeur. Le Congrès des États-Unis a tenu d’innombrables auditions ; il a fourni de nombreux exposés précis des agissements illégaux de ces banques ; il a voté un grand nombre de lois et a appelé l’ensemble des régulateurs publics et autres banquiers privés à respecter une règlementation plus rigide. Pourtant, les banques les plus importantes ne modifient pas leurs comportements, et les sommes d’argent sale ne cessent de croître de manière exponentielle. En effet, aussi bien l’État que les banques n’ont ni la volonté ni l’intérêt de mettre fin aux pratiques qui génèrent des bénéfices élevés et qui soutiennent un empire autrement fragile [30]. »
Certaines particularités de ce système ont été résumées par l’observateur canadien Asad Ismi :
« 91 % des 197 milliards [de dollars] dépensés en cocaïne aux États-Unis restent dans ce pays, et les banques américaines blanchissent 100 milliards de dollars provenant de la drogue chaque année. Parmi les établissements connus pour ce genre de pratiques, on trouve la Bank of Boston, la Republic National Bank of New York, la Landmark First National Bank, la Great American Bank, la People’s Liberty Bank & Trust Co. du Kentucky et la Riggs National Bank de Washington.
Citibank aida Raul Salinas (le frère de l’ancien président mexicain Carlos Salinas) à déplacer des millions de dollars hors du Mexique, à destination de comptes secrets détenus en Suisse sous de fausses identités. […] De plus, Manufacturers Hanover, la Chase Manhattan Bank, la Chemical Bank et Irving Trust ont reconnu qu’ils n’informaient pas le gouvernement des États-Unis des transferts d’argent. Or, en vertu du Bank Secrecy Act de 1970, toutes les transactions dépassant 10 000 dollars doivent être déclarées. Bank of America a été condamnée à une amende de 4,75 millions de dollars pour avoir dissimulé des transactions de plus de 12 milliards de dollars [31]. »
Dans le sillage de la crise financière de 2008, l’analyse de Petras fut accréditée par ce qu’affirma Antonio Maria Costa, le directeur de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC). Selon lui, « les milliards de narcodollars ont empêché le système de sombrer au paroxysme de la crise [financière] globale ». Selon l’Observer de Londres, Costa
« avait vu des preuves que les bénéfices du crime organisé étaient “les seules liquidités” disponibles chez certaines banques au bord de l’effondrement l’année dernière. Il a affirmé que la majorité des 352 milliards de dollars […] générés par la drogue avait été ainsi absorbée par le système économique. […]
Selon Costa, les preuves que de l’argent illégal était assimilé par le système financier furent pour la première fois portées à sa connaissance par des agences de renseignement et des procureurs il y a environ 18 mois. “Dans de nombreux exemples, l’argent de la drogue était la seule liquidité en capital engagé. Dans la seconde moitié de l’année 2008, [le manque de] liquidité[s] était le principal problème du système bancaire. Par conséquent, le capital liquide est devenu un facteur important”, expliqua-t-il [32]. »
La machine de guerre et la narco-guerre en Afghanistan
Ainsi, la machine de guerre ayant soutenu Barack Obama dans son intensification du narco-conflit afghan n’est pas une simple faction bureaucratique à Washington, qui serait uniquement centrée sur le Pentagone et la CIA. En effet, cet appareil est fermement enraciné dans notre société, et il est soutenu par une large coalition de forces dont les réseaux s’étendent à l’échelle globale. Pour cette raison, la machine de guerre ne saurait être dissuadée dans son bellicisme par des conseils raisonnables venant de l’establishment, comme le recommandait la RAND Corporation à propos du contre-terrorisme en Afghanistan :
« Minimiser l’emploi de la force militaire américaine. Dans la plupart des opérations contre al-Qaïda, les troupes locales ont souvent plus de légitimité pour opérer. Elles ont également une meilleure compréhension du théâtre d’opération que les forces américaines. Cela signifie une présence militaire US allégée, voire aucune [33]. »
À l’époque où Obama envoya plus de troupes en Afghanistan, la machine de guerre ne prit pas plus en compte une étude du cercle de réflexion Carnegie Endowment, selon laquelle « la présence de troupes étrangères est l’élément le plus important derrière la résurgence des Talibans », un enseignement qui aurait pu être tiré de l’intervention soviétique antérieure [34]. Afin de justifier sa posture stratégique globale visant à parachever ce qu’il appelle la « suprématie totale » (« full-spectrum dominance »), le Pentagone a cruellement besoin de la « guerre contre le terrorisme » en Afghanistan, tout comme il avait besoin une décennie plus tôt de la contre-productive « guerre contre la drogue » en Colombie.
Bien entendu, la suprématie totale n’est pas simplement une fin en soi ; elle est également le but du lobbying exercé par des entreprises américaines implantées dans des régions lointaines à l’étranger. Il s’agit en particulier de compagnies pétrolières comme Exxon Mobil, qui a des investissements colossaux au Kazakhstan et à travers l’Asie centrale. Comme Michael Klare l’a relevé́ dans son livre, intitulé Resource Wars (« Guerres de ressources »), les États-Unis avaient comme objectif secondaire, dans leur campagne en Afghanistan, « de consolider la puissance américaine dans le golfe Persique et dans la zone de la mer Caspienne, et d’assurer un flux continu de pétrole [35] ».
L’Afghanistan intéressait les compagnies pétrolières US moins pour ses ressources propres que pour sa position géographique, qui induisait l’opportunité d’y construire un réseau de pipelines afin d’accéder aux hydrocarbures de l’ex-Union soviétiques. En 1998, John Maresca, un cadre dirigeant d’Unocal, témoigna des potentiels bénéfices d’un gazoduc en projet (Centgas) devant la Commission sur les relations internationales de la Chambre des Représentants. Ce gazoduc devait partir du Turkménistan et traverser l’Afghanistan pour rejoindre la côte du Pakistan [36]. Un oléoduc à travers le territoire afghan était aussi envisagé par Unocal, qui avait fait venir une délégation de Talibans aux États-Unis pour des questions d’entraînement et de lobbying.
Le fait pour Unocal d’avoir avancé des fonds aux Talibans pour la conquête de Kaboul (comme Olivier Roy l’a affirmé) aurait violé les lois des États-Unis. Néanmoins, le vice-président d’Unocal chargé du projet de pipeline déclara que son entreprise avait accordé « des paiements en nature » aux membres du régime, en échange de leur coopération [37].
Juste après le 11-Septembre, Niaz Naik, un ancien diplomate pakistanais, déclara à la BBC que l’administration de George W. Bush avait menacé les Talibans avant le 11-Septembre. Le but de cette hostilité était de soutenir la volonté d’Unocal de construire un oléoduc et un gazoduc entre le Turkménistan, l’Afghanistan et le Pakistan [38]. Chalmers Johnson commenta :
« Il semble que le soutien pour ce projet [de gazoduc et d’oléoduc] ait été une considération majeure dans la décision prise par l’administration Bush d’attaquer l’Afghanistan le 7 octobre 2001 [39]. »













 et
et  !
!