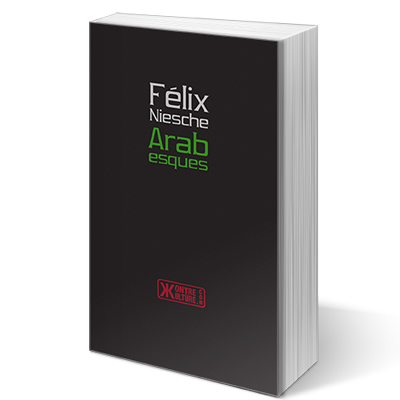Le journaliste italien Domenico Quirico vient d’être libéré de Syrie, où il était retenu en otage par les « rebelles ». Voici, traduit par E&R, l’entretien intégral qu’il a donné à son retour au journal qui l’emploie, La Stampa.
Nous sommes entrés en Syrie le 6 avril avec l’accord et sous la protection de l’Armée syrienne libre et comme toutes les fois précédentes. J’ai essayé de rejoindre Damas et de vérifier en personne les nouvelles qui circulaient à propos de la bataille décisive de cette guerre civile, comme je le fais toujours. Mais on nous a dit qu’on devait attendre quelques jours avant de pouvoir rejoindre la capitale syrienne, ainsi nous avons accepté la proposition de nous rendre dans une ville nommée Qousseir, proche de la frontière libanaise, qui était alors assiégée par le Hezbollah, allié fidèle du régime de Bachar al-Assad.
Nous sommes arrivés à Qousseir avec un convoi de ravitaillement de l’ASL, un long voyage de nuit feux éteints passant sur les montagnes, car le régime contrôlait les routes. Nous avons été bombardés par un Mig près d’un moulin de l’époque byzantine. Nous nous trouvions dans la vallée de l’Oronte, dans une zone où, au cours de l’histoire, les empires se sont construits et ont disparu. C’est ici que la bataille entre Ramsès II et les Hittites eut lieu. Ici, l’histoire est partout, dans chaque colline, dans chaque pierre.
La ville était déjà dévastée et détruite par les bombardements de l’aviation et c’est ainsi que, la nuit suivante, nous avons décidé de revenir à notre point de départ pour savoir s’il était possible d’entreprendre le voyage vers Damas. Mais probablement nous avons été trahis et vendus. À la sortie de la ville, notre voiture a été stoppée par deux pick-up avec à bord des hommes au visage masqué. Ils nous ont fait monter dans leurs véhicules, puis nous ont conduits dans une maison et nous avons été battus par des hommes qui se prétendaient être des policiers du régime d’Assad. Les jours suivants, cependant, nous avons découvert que ce n’était pas vrai, car ils étaient de fervents islamistes qui priaient cinq fois par jour de façon mélodieuse et savante. Puis, le vendredi, ils ont écouté le prêche d’un prédicateur qui soutenait le djihad contre Assad. Mais la preuve décisive nous l’avons eue quand nous avons été bombardés par l’aviation : ceux qui nous avaient pris en otage étaient des rebelles.
L’émir Abou Omar
Le créateur et chef du groupe de nos ravisseurs était un soi-disant émir qui se faisait appeler Abou Omar, un surnom. Il a formé sa brigade en recrutant des gens du coin, plus bandits qu’islamistes ou révolutionnaires. Cet Abou Omar couvre d’un vernis islamiste ses trafics et ses activités illicites et collabore avec le groupe qui nous a récupérés ensuite, Al-Farouq. Al-Farouq est une brigade très connue de la révolution syrienne, elle fait partie du Conseil national syrien et ses représentants rencontrent les gouvernements européens. Elle a été créée par un général rebelle qui a enrôlé ses combattants parmi les gens les plus pauvres de Homs, les oubliés du régime mafieux syrien. L’Occident leur fait confiance, mais j’ai appris à mes dépens qu’il s’agit aussi d’un groupe qui représente un phénomène nouveau et préoccupant pour la révolution : l’émergence de groupes de bandits de type somalien, qui profitent du vernis islamique et du contexte de la révolution pour contrôler des parties du territoire, pour rançonner la population, enlever des gens et se remplir les poches.
La première prison
Au début, nous avons été détenus dans une maison de campagne en périphérie de Qousseir. Nous y sommes restés une vingtaine de jours. Puis est survenu le premier événement terrible de ce que j’appelle la « matriochka » de cette histoire, un événement à l’intérieur d’un autre : le Hezbollah a attaqué les positions des rebelles et l’abri dans lequel nous nous trouvions s’est retrouvé en première ligne. Il a été bombardé et attaqué. À ce moment, nous avons alors été déplacés dans une autre maison, à l’intérieur de la ville. Mais c’était comme si le destin s’acharnait sans cesse contre nous et imaginant sans cesse de nouveaux scénarios terribles, nous renvoyant toujours en arrière, toujours plus loin de la perspective d’une libération.
Finalement cette maison aussi finit par être attaquée et, durant une semaine, nous avons été confiés à une brigade de Jabhat Al-Nosra, l’Al-Qaïda syrienne. C’est le seul moment où nous avons été traités comme des êtres humains, par certains aspects avec une certaine sympathie : par exemple, ils nous ont donné ce qu’ils mangeaient eux-mêmes. Ces rebelles mènent une vie ascétique et sont des guerriers radicaux, des islamistes fanatiques qui ont pour projet de faire de la Syrie un état islamique puis tout le Moyen-Orient, mais face à leurs ennemis – parce que nous, chrétiens, Occidentaux, nous sommes leurs ennemis –, ils ont le sens de l’honneur et du respect. Al-Nosra a beau être inscrite sur la liste des organisations terroristes des Américains, c’est le seul groupe qui nous ait respectés. Puis nous sommes revenus aux mains d’Abou Omar.
La fuite de Qousseir
La ville était assiégée et devenait chaque jour plus petite, détruite pierre après pierre. Au début du mois de juin, cela allait se terminer par la victoire du Hezbollah. Autour du 9 du mois, l’ensemble des différentes factions rebelles (dont la « katiba » d’Abou Omar) a décidé d’enfoncer les lignes ennemies avec la population pour tenter de fuir dans une autre zone de la Syrie.
Étonnamment, ils ont, nous avons, réussi. Cela a été une épopée extraordinaire et terrible, avec des hommes, des femmes, des enfants, des handicapés et des personnes âgées marchant à pied pendant douze heures, deux nuits consécutives, à travers la campagne. Nous étions cinq à six mille personnes. Durant la marche sur les cailloux, une rumeur sourde s’élevait de la foule, comme s’il ne s’agissait que d’un seul et même corps. Lorsque les fusées étaient lancées par les soldats du régime pour permettre d’illuminer la scène pour l’artillerie et les mitrailleuses, la campagne devenait éblouissante et ces milliers de gens se jetaient aussitôt à terre dans un silence incroyable. Puis, quand les fusées éclairantes, qui descendent tout doucement, finissaient par s’éteindre au sol, la foule se relevait en reprenant sa route en laissant derrière elle son lot de morts.
Pêches vertes
Au bout de la première nuit, l’armée est parvenue à bloquer notre avancée et tout le monde s’est dispersé dans les vergers et les champs, sans eau ni nourriture, pour attendre une autre nuit et tenter de repartir. Il n’y avait rien à manger. Juste les pêches sur les arbres, qui, en juin, étaient encore loin d’être mûres. Nous les avons écrasées pour manger la partie interne et le noyau, qui étaient assez mous. Aussi quelques vieilles personnes homériques s’avançaient seules vers les lignes de l’armée de Bachar, et elles étaient fauchées par les mitrailleuses. Mais la chose la plus extraordinaire qui s’est passée, quand le soleil tombait, toute cette foule s’est arrêtée pour prier. Les hommes d’Abou Omar ont croisé deux kalachnikovs devant la file des combattants pour entonner une prière guerrière. Le chant modulé s’est élevé au-dessus des champs et des bois pour demander à Dieu de gagner la guerre et de tuer leurs ennemis. Puis la foule s’est dirigée droit vers l’ennemi, a enfoncé les lignes et, de façon incroyable, est passée outre les soldats.
Vers Homs
Nous sommes descendus vers Homs depuis le haut-plateau. Je crois avoir pensé que je rêvais, que la scène était irréelle. Nous avancions dans la nuit vers cette grande ville, celle où la révolution a débuté. Une partie de la cité était déjà détruite par les bombardements et était déserte, l’autre partie était encore habitée et les combats continuaient. Par un incroyable effet d’optique, l’immense étendue de maisons blanches se reflétait dans le ciel : une partie, celle détruite, de la ville avait l’immobilité et le silence d’un cimetière, d’une tombe, quand l’autre était lumières, rafales, fusées et bruits. Nous avons continué vers la plaine de Homs. Nous marchions entre deux colonnes de feu, entourés d’ombres : les gens couraient en baissant la tête car les mitraillettes tiraient à hauteur d’homme, nous marchions sur les cadavres, jusqu’à ce que nous arrivions finalement dans une petite ville de ciment, l’une de ces affreuses petites villes syriennes, mal construites et approximatives.
Comme Ulysse
Après cette nuit-là, nous avons été ramenés dans la ville, où notre voyage avait débuté, un peu comme dans L’Odyssée. Ulysse se dirige vers Ithaque, aperçoit sa maison, son île au loin, mais le dieu féroce, implacable, le destin, s’acharne contre lui, une tempête le repousse au loin et c’est son châtiment. Il nous est arrivé la même chose. De retour à Reabruc, la ville d’où nous étions partis, nous avons été vendus à Al-Farouq. Le voyage a recommencé parce qu’après deux jours, ils nous ont dit que nous irions vers le Nord, aux confins de la Turquie, et que là, nous serions libérés. Nous avons voyagé deux nuits sur ces pick-up à travers les montagnes, avec les chauffeurs qui regardaient de temps en temps à travers des jumelles à infrarouges si les militaires ne préparaient pas de guet-apens sur la route. Après une seconde nuit de voyage et de froid assis à l’arrière du pick-up, recouverts de poussière, nous sommes arrivés dans la zone d’Idleb, où nous avons été retenus trois ou quatre semaines dans une base militaire. Nous étions sur le fleuve Oronte, dans une zone dans laquelle l’histoire des empires se sont construits mais se sont également effondrés, comme celui des Hittites... Le chef des ravisseurs se faisait appeler Abou Omar. Recouvrant d’un vernis islamiste son trafic et ses activités illégales.
L’appel
Après le premier jour de marche cet Abou Omar, assis comme un pacha sous un arbre, était entouré de sa petite cour de guerriers. Il m’a appelé parce qu’il voulait que je m’assoie à ses côtés, dans l’intention de faire croire qu’il était notre ami, pour tromper un peu les gens qui l’entouraient et qui se demandaient qui pouvaient bien être ces deux Occidentaux mal vêtus et en piteux état après deux mois de captivité. Je lui ai demandé son téléphone pour appeler la maison, lui disant que ma famille me croyait sans doute mort et qu’il était en train de détruire ma vie et ma famille. Il riait. Et il me montrait son téléphone en me disant qu’il n’y avait pas de réseau, qu’on ne pouvait pas appeler. C’était faux. À ce moment-là, un soldat de l’Armée syrienne libre, blessé aux jambes, a sorti un téléphone de la poche de son pantalon et me l’a tendu. C’est le seul geste d’humanité que j’aie reçu en 152 jours. Personne n’a manifesté envers moi une once de ce que nous appelons la pitié, la miséricorde, la compassion. Même les vieux et les enfants ont essayé de nous faire du mal. Je le dis peut-être en termes un peu trop éthiques mais vraiment, en Syrie, j’ai rencontré le pays du Mal. J’ai réussi à appeler la maison seulement vingt secondes, après avoir entendu le cri désespéré de l’autre côté, et la ligne a été coupée.
La captivité
Nous étions traités comme des animaux, enfermés dans de petites pièces avec des fenêtres fermées malgré la terrible chaleur, jetés sur des paillasses, nous devions manger les restes de leurs repas. De toute ma vie, dans le monde occidental, jamais je n’avais ressenti une telle humiliation quotidienne dans les choses les plus courantes comme aller aux toilettes, à devoir demander et entendre toujours répondre non. Je crois qu’ils éprouvaient un satisfaction évidente à voir l’Occidental riche réduit à l’état de mendiant, comme un pauvre.
Les tentatives d’évasion
La première fois, notre gardien s’étant probablement assoupi, nous sommes sortis de la maison et nous sommes dirigés vers des lumières, pensant qu’il s’agissait de Qousseir.
Après deux cents mètres ils nous ont repris. La seconde fois, en revanche, nous étions dans une autre ville, c’était vers la fin de notre détention. Nous avons profité de la distraction de ces quatre hommes, qui souvent ne prenaient pas garde à leurs affaires le soir, à leurs blousons remplis de chargeurs, à leurs kalachnikovs, qu’ils abandonnaient près de notre pièce. Nous avons pris deux grenades, pensant les utiliser pour dégager la voie. Je les ai cachées sous un canapé usagé. Nous pensions les surprendre, prendre leur téléphone, appeler chez nous, en Italie, pour être guidés pendant notre évasion. Malheureusement, ou heureusement, parce que je pense qu’une telle tentative m’aurait causé d’énormes problèmes moraux, nous n’avons pu exécuter notre plan. Mais un soir, ils oublièrent de fermer la porte de la maison et nous sommes sortis, armés de deux kalachnikovs, et nous sommes partis vers Bab Al-Hawa. Je connaissais déjà cette zone pour y avoir été en janvier.
Réduits à de la marchandise
Nous nous sommes cachés dans une sorte de ruine dans la campagne. Nous avons essayé de traverser la frontière dans la nuit mais nous avons découvert que le terrain était miné. Nous avons atteint finalement le fil barbelé et avons dû rebrousser chemin. A l’aide de la kalachnikov, nous avons arrêté un véhicule et demandé au conducteur de nous conduire à un village des environs. Mais il y avait un poste de contrôle. Ils nous ont tiré dessus, arrêtés, ramenés dans la maison où nous étions enfermés et rendus à nos geôliers pour nous punir. Lesquels nous ont enfermés dans une espèce de cagibi avec les mains attachées dans le dos et nous ont maintenu ainsi pendant trois jours. Notre valeur n’était que celle de la marchandise. On ne peut pas détruire la marchandise, on prend le risque de ne pas obtenir le prix qu’on en attend. Nous avons vraiment ressenti n’être que des sacs de blé, des objets qui n’ont qu’une valeur marchande. Ils pouvaient nous rouer de coups, mais pas nous tuer car s’ils nous abimaient trop, ou définitivement, nous aurions perdu toute valeur marchande. C’est l’horrible loi de l’otage.
Les choses simples de la vie
Une fois je parlais avec Georges Malbrunot, journaliste du Figaro qui a été sans doute l’un des otages les plus célèbres pendant la guerre en Irak (NDT : 2004). Je crois qu’il est resté otage environ quatre mois, en conditions pires que les miennes, dans une grotte. Il racontait le dépouillement de tout ce qui fait une personne, comme les chaussures, les vêtements... Moi, je suis resté cinq mois sans chaussures, pieds nus. Pendant cinq mois, mon rythme de vie est devenu le soleil qui se couche et le soleil qui se lève. Et l’impossibilité d’accomplir toutes les choses dont la vie est faite : marcher, bouger, rencontrer des gens, écrire, lire, regarder le paysage, rêver de faire des choses que parfois on ne fait pas, qui font ton mode de vie. Moi, pendant cinq mois, j’ai végété, au sens propre, cinq mois où j’ai perdu tout ce qui faisait mon mode de vie, ma vie m’a été dérobée, remplacée par quelque chose d’artificiel, qui était pour moi d’être un objet et à lutter contre le temps. J’ai découvert le caractère extraordinaire de choses simples comme un verre d’eau. Ou regarder le soleil, parce que nos fenêtres étaient minuscules et que nous étions souvent dans l’obscurité complète. Marcher, parler avec quelqu’un qui ne soit pas toujours mon compagnon de mésaventure. Et c’est un moindre mal qu’il fut là, sinon je serais devenu fou.
Les geôliers
Ils appartenaient à un groupe qui se prétend islamiste mais qui, en réalité, est composé de jeunes déséquilibrés qui sont entrés dans la révolution parce que la révolution c’est désormais ces groupes à mi-chemin entre banditisme et fanatisme. Ils suivent celui qui leur promet un avenir, qui leur donne des armes, de la force, de l’argent pour acheter des téléphones, ordinateurs, vêtements. La marque Adidas est extrêmement répandue en Syrie, tout le monde porte des T-shirts Adidas, des chaussures Adidas, on dirait une sorte de sponsor. Ces jeunes gens mènent une vie d’hommes, sans femmes, en communauté où ils ne font rien et passent leurs journées allongés sur des matelas à boire du maté. Je croyais que c’était une habitude sud-américaine, mais c’est très courant dans certaines parties de la Syrie. Ils fument aussi des Marlboro d’origine américaine importés de Turquie. Moi j’avais l’air plus islamique qu’eux car je ne fume ni ne bois. Ils regardaient la télévision mais les informations étaient la dernière chose qui les intéressaient. Seuls les captivaient les petits films vaguement osés de la télévision qatarie, les vieux films égyptiens à l’eau de rose des années 50 en noir et blanc et les spectacles de combat américain, ou bien cette terrible forme de lutte pratiquée dans les pays arabes où tous les coups sont permis...
Les simulacres d’exécution
Par deux fois, ils m’ont fait croire qu’ils allaient m’exécuter. Nous étions près de Qousseir. L’un d’eux s’est approché de moi avec son pistolet, m’a montré que l’arme était chargée puis, mettant ma tête contre le mur, il a approché le canon de ma tempe. Interminables instants pendant lesquels tu as honte... Je me souviens de l’exécution de Dostoïevski... Il te monte une colère parce que tu as peur, tu sens respirer l’homme à côté de toi, son plaisir d’avoir la vie d’un autre entre ses mains, de ressentir ta peur, et tu enrages car tu as peur. C’est un peu comme lorsque les enfants, qui sont souvent si cruels, arrachent la queue des lézards ou les pattes des fourmis. La même férocité.
Les tractations
Pour rire de nous, nos geôliers nous lançaient de temps en temps « dans deux ou trois jours, peut-être une semaine, vous serez libres, en Italie » pour voir ensuite notre désespoir... lorsqu’ils ajoutaient « Inch’Allah », leur façon à eux de mentir sans en avoir l’impression, « Inch’Allah »... Ils disaient tout le temps « bukrah », qui veut dire demain... Mais le lendemain, personne ne partait. Un jeu vraiment cruel, mais les derniers temps, lorsqu’ils jouaient à ce petit jeu avec nous, nous leur répondions : « Inch’Allah » pour faire comprendre que nous avions compris. À la fin, dimanche, j’ai senti que cette fois, c’était la bonne. Peut-être pour brouiller les pistes, nous avons traversé quasiment tout le pays, jusqu’à Deir Azor, dans le grand désert syrien. Nous avons fait halte dans une ville dont je ne peux dire pas le nom et puis nous sommes retournés d’où nous venions par la même route. Une sorte de diversion. Et nous avons été libérés. Cette fois, aucun « Inch’Allah ». Ils nous ont fait descendre des voitures de l’autre côté de la frontière, nous disant de marcher. J’avoue avoir pensé qu’ils allaient nous tirer dans le dos, il faisait sombre, c’était la nuit, dimanche avant l’aube. J’ai songé que si j’entendais le bruit du chargeur, je me jetterais au sol. J’étais sûr qu’il m’auraient tué, nous avions vu leurs visages, nous connaissions leurs noms. Mais personne n’a chargé de kalachnikov. Et j’ai entendu des voix italiennes. Inch’Allah, cette fois, c’était bien la bonne.
Les livres
Je voyage toujours avec des livres, je peux renoncer à trois t-shirts dans mes bagages. Cette fois, j’en avais emporté quatre. Deux d’un auteur aujourd’hui malheureusement oublié, Erich Maria Remarque, deux titres peut-être un peu mineurs, Un temps pour vivre, un temps pour mourir, et La Vie du retour, qui raconte le retour de quelques rescapés à la fin de la première guerre mondiale. Un peu le symbole pour moi de ce chemin du retour que je ne parvenais pas à trouver. Norman Mailer, Les Nus et les morts et Crime et châtiment de Dostoïevski. Je les ai lus et relus. Je peux vous parler de tous les personnages, les réciter en partant de la fin. Je les ai porté avec moi, malgré la fatigue, j’ai marché avec eux deux nuits et deux jours durant la retraite de Qousseir. Le dernier jour, ils me les ont confisqués. Les livres nous parlent. Mais il y a eu un certain moment où ils ne me parlaient plus, où fuyaient les mots, les histoires, les personnages... Si je fais d’autres voyages de ce genre, j’emporterai toujours la Recherche de Proust, Don Quichotte, des livres longs, très longs... ça aide.
La foi
Dans toute cette expérience il y eut beaucoup Dieu. Pierre Piccinin est un croyant. Je suis aussi un croyant. Ma foi est très simple, c’est celle de mes prières quand j’étais enfant, des prêtres que je croisais quand j’allais voir ma grand-mère en traversant la campagne à vélo, qui, la sacoche à leur vélo et chaussés comme des ouvriers, pédalaient vers leurs petites paroisses, allaient porter l’extrême onction, bénir les maisons, avec la foi de Bernanos, simple mais profonde. Ma foi, c’est de me donner, je ne crois pas que Dieu soit un supermarché, où on va demander la grâce discount, le pardon, un service. Cette foi m’a aidé à résister. Notre histoire est celle de deux chrétiens dans le monde de Mahomet et de la confrontation de deux fois différentes : la mienne, simple, faite de don de soi et d’amour, et la leur, qui est faite de rituels. J’avais aussi avec moi un de mes bloc-notes où j’écrivais chaque jour ce qui se passait. Je l’avais presque fini, il ne me restait que deux pages. Le dernier jour, ils me l’ont pris. Il m’a surtout servi à tenir le compte des mois, des jours, parce que si on perd le sens du temps, on s’enfonce dans un puits d’où on ne ressort pas.













 et
et  !
!