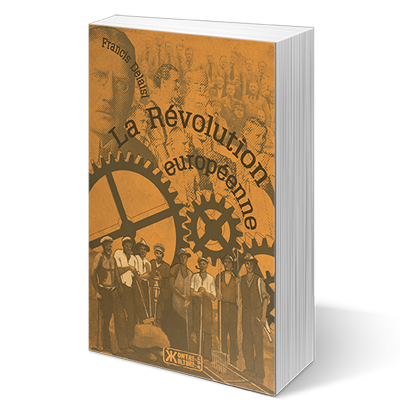C’était autrefois une tradition pour les démocrates de se rendre au Cadillac Square de Détroit, pour lancer leurs campagnes dans ce temple de la démocratie américaine, qui était le plus grand centre industriel de la planète.
La tradition a beau perdurer, Détroit n’est plus ce qu’elle était. Et l’Amérique non plus.
Il n’y a pas si longtemps, nous fabriquions tous les souliers et vêtements que nous portions, toutes les motocyclettes et voitures que nous conduisions, toutes les radios que nous écoutions, les téléviseurs que nous regardions, les ordinateurs que nous utilisions.
Plus maintenant. Une grande partie de ce que nous achetons n’est plus fabriqué par des Américains mais par des Japonais, Chinois et le reste par des Asiatiques, des Canadiens et des Européens.
« Pourquoi plus rien n’est fabriqué ici ? » est la question du jour.
Réponse : plus rien n’est fabriqué ici parce qu’il coûte moins cher de fabriquer à l’étranger et de réexpédier ensuite.
Forts d’une économie de 14 000 milliards de dollars, nous sommes probablement toujours le meilleur marché où vendre. Nous sommes toutefois un des marchés les plus chers où produire.
Pourquoi ? La réponse est simple. Les salaires américains sont plus élevés que partout ailleurs. Nos lois sanitaires, sécuritaires et environnementales sont parmi les plus strictes. Nos politiques de discrimination positive les plus exigeantes, à l’exception peut-être de la Malaisie et de l’Afrique du Sud.
Est-ce que seuls les coûts de production des États-Unis sont à blâmer pour la délocalisation et la stagnation des salaires ?
Non. Depuis la Révolution, l’Amérique a un niveau de vie envié dans le monde entier. De la guerre de Sécession jusqu’aux années ’20, alors que nous devînmes la plus grande puissance manufacturière que le monde ait connu, nos travailleurs bénéficiaient des salaires et des avantages les plus avantageux qui soient.
Pourtant, nos exportations durant ces décennies étaient deux fois plus importantes que les importations et notre balance commerciale positive augmentait notre PIB de 4 % par an. Comment était-ce possible ?
Nous taxions les produits des usines et travailleurs étrangers et nous utilisions ces recettes pour financer l’État. Nous imposions des droits de douane de 40 % sur les biens étrangers entrant sur notre marché et utilisions l’argent de ces tarifs pour maintenir des impôts bas aux États-Unis.
Nous faisions payer les étrangers pour vendre leurs produits chez nous et les faisions payer pour aider au financement de notre gouvernement. Notre pays et notre peuple passaient en premier.
Pour les entreprises américaines, et particulièrement l’industrie, c’était le paradis. Elles bénéficiaient d’un accès gratuit et exclusif à notre marché alors que leurs concurrentes étrangères se voyaient imposer de lourds tarifs pour pouvoir leur faire concurrence sur le marché américain.
Qu’est-il arrivé à cet idéal d’une république autarcique produisant presque tout ce qu’elle consomme, une nation pouvant rester en dehors des guerres mondiales mais parvenant à écraser toutes les grandes puissances d’Europe et d’Asie moins de quatre ans après son entrée en guerre ?
Une nouvelle classe, qui perçut les droits de douane comme xénophobes, le patriotisme économique comme régressif et la souveraineté nationale comme une idée ancienne et incompatible avec le Nouvel Ordre mondial qu’elle envisageait arriva au pouvoir.
Dès 1976, les éditorialistes se mirent à parler d’une nouvelle « déclaration d’interdépendance » visant à remplacer la déclaration d’Indépendance de Thomas Jefferson, alors dépassée.
Le nouvel idéal fut de reproduire l’Amérique à l’échelle globale, d’ouvrir les frontières de toutes les nations à l’instar de celles des 50 États, d’abolir les droits de douane et les barrières commerciales et de paver la voie à la libre circulation des biens et des hommes, permettant ainsi de créer l’État mondial tel qu’envisagé par des politiciens comme Woodrow Wilson et Wendell Willkie.
Mais pourquoi les entreprises américaines, avec leur accès privilégié au plus grand marché du monde, acceptèrent-elles de partager cet eldorado avec leurs concurrentes du monde entier ?
La réponse se trouve dans le compromis qu’ont leur accorda.
Déjà établies sur le marché américain, les entreprises d’ici pouvaient risquer de partager ce marché si, en échange, on leur permettait de délocaliser la production à l’extérieur des États-Unis, vers des pays où les salaires étaient bas et les règlementations inexistantes.
Les entreprises américaines ont pu dès lors produire pour une fraction de ce qu’il en coûtait ici. Ces entreprises pouvaient ensuite réexpédier aux États-Unis leurs biens fabriqués à l’étranger et empocher la différence en coût de production. Le prix des actions est monté en flèche, tout comme les salaires des dirigeants et les dividendes, afin d’obtenir le soutien nécessaire pour cette politique corporative de délocalisation.
Grâce à la mondialisation, les investisseurs américains ont pu s’enrichir en abandonnant la classe ouvrière nationale.
L’Amérique est en déclin industriel terminal car les intérêts de Wall Street sont désormais directement opposés à ceux de la classe ouvrière et, par là même, aux intérêts nationaux des États-Unis.
Malgré tout, nos deux partis sont inconscients de ce qui est en train d’arriver à leur pays – voire indifférents.
Patrick J. Buchanan est un homme politique et journaliste américain. Catholique traditionaliste, opposé au néo-conservatisme incarné dans les années 2000 par l’administration de George W. Bush (même s’il finira par soutenir Bush aux élections de 2004), il se définit comme « paléo-conservateur » et milite notamment pour une politique étrangère isolationniste et un protectionnisme économique.
Revoir l’analyse d’Alain Soral sur la nouvelle lutte des classes entre producteurs sédentaires et prédateurs nomades (extrait de l’entretien de mars 2012) :













 et
et  !
!