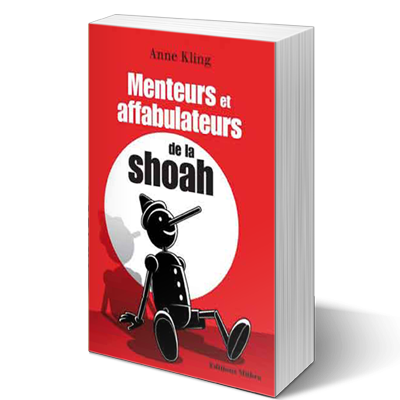SHOAH - Regards en coin, visages choqués, expressions interloquées : dans les rues de Tel Aviv, on dévisage toujours Ayal Gelles avec curiosité. En cause, le long tatouage qui court sur son avant-bras. A-15510. Le matricule attribué à Avraham Nachshon, son grand-père, raflé à 17 ans et rescapé d’Auschwitz.
Si aujourd’hui le jeune homme de 28 ans arbore fièrement ce numéro, cela n’a pas toujours été aussi simple. "Le cheminement a été long, douloureux. J’étais taraudé depuis longtemps par l’envie de le faire mais ce n’est qu’au terme d’un processus très lent, d’une maturation qui a duré des années que je me suis décidé", raconte Ayal. "À la fin de mon service militaire, en 2009, je suis parti voyager en Amérique du sud comme beaucoup d’Israéliens. Un jour, en Argentine, j’ai vu un troupeau de vaches aller à l’abattoir, un numéro tatoué sur l’oreille. Cette vision d’animaux qu’on traînait vers la mort et dont l’identité était réduite à un numéro m’a bouleversé. Cela m’a rappelé ce que mon grand-père avait subi. Ce jour-là, je suis devenu un végétarien fervent et j’ai pris la décision de me faire tatouer à la fin de mon voyage", se souvient-il.
Comme Ayal, ils seraient aujourd’hui des dizaines en Israël à avoir fait encrer sur leur peau un matricule de déporté. Témoins privilégiés de ce phénomène, les réalisateurs Dana Doron et Uriel Sinai leur ont donné la parole dans Numbered, un documentaire présenté l’été dernier au Festival du film de Jérusalem. Les survivants et leurs proches y confient leurs histoires familiales et leurs liens avec leurs tatouages respectifs. Si pour les rescapés il est la preuve concrète de leurs souffrances, pour leurs descendants il est désormais l’emblème d’un devoir de mémoire essentiel et collectif.
Et ils ne sont pas les seuls à considérer le tatouage comme le symbole du combat contre l’oubli. Le 8 avril dernier, journée dédiée à la mémoire de la Shoah en Israël, l’opération "People, Not numbers" ("Des gens, Pas des numéros") a été lancée pour la première fois. Dans les rues de Tel Aviv, les représentants d’une agence de publicité proposaient aux jeunes des tatouages éphémères de matricules de déportés. Ils étaient ensuite invités à se rendre sur le site "6 millions" pour découvrir l’histoire de la personne dont ils ont porté, de manière temporaire, le numéro.
Une première dans un pays où le sujet est longtemps resté tabou. "Pour ceux de la génération précédente qui ont été élevés par des parents rescapés, c’était la monstruosité qu’il ne fallait jamais évoquer", se souvient Dorit, elle-même fille de survivants. "Eux, par contre, en parlaient tout le temps. La nuit, ils faisaient des cauchemars. Ils se réveillaient en hurlant dans leur langue maternelle. Depuis la fin de la guerre, tous ces gens vivent entourés de fantômes", soupire-t-elle.
Malgré le succès de l’opération "People, Not numbers" et l’ampleur grandissante du phénomène du tatouage, une grande partie de l’opinion publique israélienne juge à plusieurs titres cette appropriation du matricule comme déplacée et indécente. Formellement interdit par la religion juive, le tatouage est considéré par les Israéliens religieux comme une transgression grave de la part des jeunes laïcs à l’encontre de la religion. Ajouter à ce geste interdit la provocation du symbole provoque la colère de certains. Ron, petit-fils de déporté, y voit même une confusion identitaire dangereuse. "L’émergence de cette mode des tatouages me choque évidemment ! Il ne faut pas oublier d’où ils viennent et ce qu’ils signifient !", s’exclame-t-il. "Cette manière démonstrative de se mettre en scène me paraît malsaine", ajoute Ron. Une réaction qui ne surprend pas Ayal. "Je me doutais bien que ma démarche ne ferait pas l’unanimité. Beaucoup trouvent ça gênant, ils ont l’impression que je mène un combat qui n’est pas le mien, que je chercher juste à provoquer mais ce n’est pas du tout ça", se désole-t-il. "Je voulais simplement matérialiser la connexion que j’ai avec mon grand père et lui rendre hommage. Malgré les critiques, je crois que j’ai réussi. Quand je lui ai annoncé que j’avais fait ce tatouage, il s’est mis à pleurer. À l’époque, il pensait que c’était une mauvaise idée. Aujourd’hui, il en est très fier. Pour moi, c’est la seule chose qui compte".
Si la jeune génération a fait du tatouage son nouvel étendard, c’est également pour alerter la population israélienne sur la situation économique de plus en plus précaire des rescapés. Ils seraient aujourd’hui plus de 190 000 en Israël, dont plus d’un quart à vivre sous le seuil de pauvreté. Si la "Claims Conference" - l’organisme qui négocie avec le gouvernement allemand les dédommagements pour les rescapés - tâche de faire augmenter les pensions compensatoires accordées aux survivants, les allocations ont pourtant brutalement baissé de 400 dollars par mois à 80 dollars pour certains d’entre eux. Face à cette paupérisation galopante, les rescapés ont manifesté il y a quelques semaines. Leur but ? Faire pression sur le gouvernement et obtenir une aide financière conséquente. Sans grand succès. "On fait valoir qu’il y a dans les tatouages quelque chose de méprisant pour la Shoah, mais ce mépris s’illustre plutôt dans la façon dont l’État d’Israël traite ses derniers survivants, pas dans la nouvelle vie que ces numéros ont reçue", s’insurge Dana Doron, la coréalisatrice de Numbered, dans les colonnes du quotidien Haaretz.
Selon les dernières estimations, le nombre de survivants ne devrait plus s’élever qu’à 48 000 personnes d’ici 2025. Symbole d’une prise de conscience ou initiative choquante, la peur de voir disparaître ces derniers témoins de l’Histoire continue en tout cas de motiver de plus en plus d’Israéliens à se faire tatouer. "C’est une manière de rappeler à tous ceux qui nous croiseront un jour les atrocités vécues par une génération. Ainsi, plus personne ne pourra dire qu’il ne savait pas. Ce n’est que comme ça que nous lutterons vraiment pour que cela n’arrive plus jamais", conclut Ayal.













 et
et  !
!