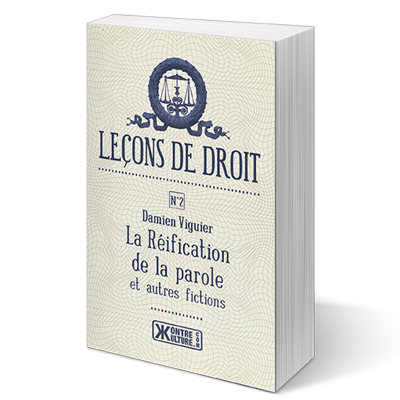Docteur en droit et avocat d’un dissident médiatique qu’il n’est point besoin de présenter, Me Damien Viguier a publié il y a peu aux éditions Kontre Kulture un court ouvrage de droit intitulé La Réification de la parole, qui n’a pas manqué de retenir notre attention.
Dans une belle langue concise, cet auteur prolixe et profond y rappelle qu’en droit romain, les jurisconsultes et magistrats avaient pris l’usage, en distinguant les choses des personnes, de classer les actions en justice selon qu’elles réclamaient la reconnaissance d’un droit direct sur une chose, dénommé droit réel (au sens de res, rem, rei : chose), tel le droit de propriété ou l’usufruit, ou la reconnaissance d’un droit personnel, dit encore droit de créance, contre une personne.
Ajoutons, pour être complet, que cette division des actions procédurales est extrêmement ancienne, puisqu’elle est antérieure à la loi des XII Tables (-450 av. NSJC), et remonte sans doute aux premiers temps de la fondation de Rome par Remus et Romulus.
Le sacramentum, qui constituait selon le jurisconsulte Gaïus l’action de droit commun – et la plus ancienne au reste – des actions de la loi (legis actiones), ces actions procédurales teintés de rite paganiste primitif et de formalisme vétilleux, se subdivisait elle-même en deux sous-actions, le sacramentum in rem (dont l’objet est la revendication ou la restitution d’une chose) et le sacramentum in personam (dont l’objet est le paiement d’une somme d’argent par une personne présentée comme débitrice du demandeur).
À y regarder de près, cette classification rigoureuse puise son origine dans une vision éminemment réaliste, conservatrice et non idéalisée du monde et de l’homme. Obtenir le paiement d’une somme de la part de son débiteur implique sa participation à cette action, et plus fondamentalement sa bonne volonté, sa solvabilité, son honnêteté, son honorabilité en dernier lieu. Être créancier de cette somme n’équivaut donc nullement à en être déjà propriétaire. Le devenir de la créance repose essentiellement sur la « capacité du débiteur à honorer sa parole ».
On comprend dès lors que les juristes médiévaux, témoins du féodalisme et des liens de vassalité au centre desquels se loge l’honneur et l’hommage, aient pu admettre sans coup férir, lorsqu’ils redécouvrirent le droit romain au XIIe siècle, cette distinction des jurisconsultes romains. Ils parvinrent même, avec l’école de la glose de Bartole, à un degré d’abstraction plus élevé et divisèrent les droits eux-mêmes entre droits réels, dont l’objet est la chose elle-même (jus in rem), et les droits personnels, dont l’objet est l’action d’une personne, telle la livraison d’un bien (jus in personam ou jus ad rem). Dans une telle optique, il serait absurde de prétendre qu’une créance est un bien et que l’on peut en être propriétaire. Une créance ne vaut que ce que vaut celui qui la doit. Ainsi est-on soit propriétaire de son bien corporel (res corporales) ou titulaire d’un droit réel sur le bien corporel d’autrui (usufruit, emphytéose), soit l’on est titulaire d’une créance contre une personne, aux fins de se faire remettre une somme d’argent, un ouvrage ou un bien corporel.
Cette classification conforme à une conception très personnelle – des qualités et des défauts – de l’homme s’est progressivement diffusée au bas Moyen Âge dans les pays de droit écrit (langue d’oc) du Royaume de France et a fini par être considérée comme une évidence sous l’Ancien Régime avant d’être entérinée par le Code Napoléon en 1804. Tout au long du XIXe siècle, la « doctrine », c’est-à-dire l’ensemble des universitaires qui publiaient des ouvrages ou des articles de presse sur l’interprétation de ce Code, n’eut de cesse de répéter que les droits étaient soit réels, soit personnels.
Et, pourtant, un mouvement doctrinal s’est esquissé au milieu du XXe siècle, après la Seconde Guerre mondiale, qui a défendu une théorie radicalement différente, dite de la propriété des créances. Selon ses promoteurs, les biens se rangeraient entre biens corporels et biens incorporels et la puissance d’emprise qui s’exerce sur eux n’est autre que la propriété. Présentée à ce stade, la théorie serait indolore si l’on considérait que les biens incorporels ne comportent que les œuvres de l’esprit (droits d’auteur) et non les créances. Mais, précisément, il s’agit pour ces auteurs d’y intégrer les droits de créance, dont l’on pourrait désormais être propriétaire. Le lecteur profane pourrait se dire qu’il n’en a cure pour son quotidien. Il commettrait ce faisant une grave erreur, car cette théorie s’est tellement propagée dans l’université française qu’elle en vient, dans l’enseignement à nos étudiants en droit, à se substituer à la traditionnelle. Pire, elle a justifié la titrisation des créances, qui aurait été impossible si l’on n’y voit pas un bien, à l’origine de la terrible crise financière de 2008.
L’illustre mérite de Me Viguier est de signaler ce lien inavoué de cause à effet :
« Nous sommes frappés de la coïncidence d’une théorie qui veut regarder les créances comme des biens et des pratiques financières du capitalisme moderne ».
Si l’on fait en effet totalement abstraction de l’honorabilité, de l’honnêteté et de la solvabilité du débiteur, ne compte plus que l’étendue de ses seuls actifs, qu’il est tentant d’évaluer à leur seule valeur vénale. Une spéculation peut alors se prêter à la circulation des créances et des produits financiers dynamiques se créer sur cette illusion. L’auteur s’exclame à juste titre avec désarroi :
« On a érigé en règle de droit une fraude qu’impuissance ou perversité, l’on ne pouvait, ou l’on ne voulait plus combattre ».
Le second mérite de Me Viguier, après en avoir découvert la filiation, est de révéler la double paternité de cette théorie de la propriété des créances dans la comptabilité en partie double inventée par les marchands italiens à la fin du Moyen Âge, d’une part, et la théorie du patrimoine émanation de la personne des professeurs Aubry et Rau au XIXe siècle.
Werner Sombart avait déjà expliqué en quoi le capitalisme n’avait pu éclore que par le jeu de la comptabilité en partie double qui, à l’opposé de l’ancienne comptabilité en partie simple, incluait les créances et les dettes (et non seulement les encaissements et décaissements) comme si elles étaient des actifs positifs ou négatifs. Cette fiction a été prise à la lettre – comme à la lettre ? – par les promoteurs de la propriété des créances pour en déduire qu’elles sont des biens. Les professeurs Aubry et Rau avaient par ailleurs ouvert la voie en écrivant, en 1850, que le patrimoine, qu’ils n’entendaient pas au sens profane (celui de l’ensemble des actifs mobiliers et immobiliers d’une personne) mais en tant que contenant virtuel de l’intégralité de l’actif et du passif d’une personne, est la projection de la personne dans le domaine des biens : réduisant le débiteur à son seul patrimoine. L’auteur achève sa démonstration par cette interrogation mystérieuse :
« Il est encore difficile de dire si la transposition d’une science dans l’autre s’est faite consciemment et par qui elle a été faite ».
Les lecteurs sensibles à certaines antiennes pourront même glaner dans cet excellent ouvrage de Me Viguier la trace – volontaire ? –, en tout cas quasi indélébile, de la piste qui permet de saisir la paternité ethnique de cette vision exclusivement patrimoniale de l’homme, indifférente à sa capacité à honorer sa parole. Dans toutes les master 2, on connaît les illustres promoteurs de la propriété des créances : les professeurs Samuel Ginossar (et depuis son décès), Frédéric Zénati et Rémi Libchaber. Les lecteurs assidus de l’Ancien Testament ou du Talmud viennent sans doute de tiquer en lisant ces noms, dont la racine hébraïque (Shemu Ginossar), séfarade (Zénatti) ou ashkénaze (Lieb Chaber), transparaît assez nettement derrière leur orthographe francisée. Mais ce n’est pas tout. Un juriste bien informé sait que les professeurs Aubry et Rau ont emprunté leur théorie du patrimoine au professeur allemand Zachariae, ce dont ils ne taisent pas au reste leur inspiration dans l’intitulé de la première édition de leurs Cours de droit civil. Il a sans doute échappé, y compris à Me Viguier lui-même, que le Professeur Zachariae s’appelle en réalité Karl Salomo Zakariä et que la version hébraïque du prénom Salomon (Schlomo) se traduit en allemand par Solomon et non Salomo. On ne sait s’il s’agit d’une simple coïncidence, mais force est de constater que les indices ethniques de cette théorie, pour reprendre un vocabulaire juridique éprouvé, sont « sérieux, précis et concordants » !
À revoir : Alain Soral présente La Réification de la parole et autres fictions













 et
et  !
!