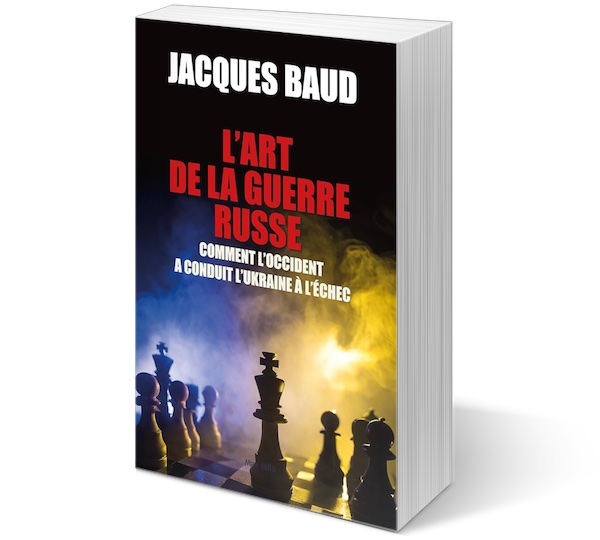Quand il ne prend pas lourdement parti, l’analyse de Stéphane Audoin-Rouzeau sur le conflit ukrainien de 2022 au prisme de 14-18 (il en est le spécialiste) est intéressante. Au départ, dans cet article du Figaro, il précise bien qu’il est pro-Kiev, ce qui est étrange pour un historien, mais cela pose les choses clairement. On sait « d’où il parle ». Sa conviction que l’Ukraine a déjà perdu la guerre n’en prend que plus de poids.
SAR commence par dire que les Occidentaux, les Européens en particulier, se sont aveuglés sur la Russie et surtout sur Poutine, qui n’avait selon eux aucun intérêt à attaquer, mais qui a pourtant attaqué en février 2022. La plupart des propagandistes, qui sont aussi idiots que malhonnêtes, prédisaient un effondrement de la Russie. Trois ans plus tard, ils ont préféré pérorer sur les victoires israéliennes.
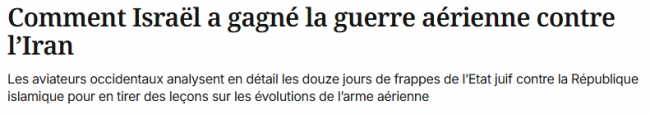
C’est le cas de L’Opinion, ce jeudi 16 juillet 2025, alors que les spécialistes américains admettent que de nombreux bâtiments militaires ont été durement frappés par les missiles iraniens.
Le conflit entre l’Iran et Israël, dite « guerre des 12 jours », a débuté dans la nuit du 12 au 13 juin par l’opération israélienne « Rising Lion » visant les programmes nucléaire et balistique iranien, puis les États-Unis ont procédé à des frappes le 21 juin, avant d’imposer un cessez-le-feu. Celui-ci tient toujours et pourrait déboucher sur une reprise des négociations. Le conflit aurait causé la mort d’un millier de personnes en Iran et de moins d’une trentaine en Israël.
@bravosport64 Selon les Forces de Défense Israéliennes 1226 personnes sont tombées pendant le conflit Israël Iran #israel #iran #info ♬ son original - Bravosport
Passons à l’analyse du conflit ukrainien et ses similitudes avec la guerre de positions d’il y a un siècle.
Cela fait déjà très longtemps qu’en Europe, la guerre est perçue comme toujours défensive, y compris chez l’attaquant ! C’est en cela que ce conflit est extrêmement intéressant à lire au prisme de 1914-1918. À l’époque, absolument tout le monde, déjà, se défendait ! Chacun en était profondément persuadé, qu’il s’agisse des dirigeants ou des opinions publiques. […]
Il y a peu d’exemples historiques de cette forme de guerre, très récente, car elle exige des armements qui n’ont été disponibles qu’à la fin du XIXe siècle. Structurellement, il s’agit d’une guerre de siège, mais menée en rase campagne sur des centaines de kilomètres. Il n’y a eu que trois conflits de ce type : la Grande Guerre (de la fin 1914 jusqu’au printemps 1918, pas au-delà) ; la guerre Iran-Irak (de 1980 à 1988) ; la guerre d’Ukraine (à partir d’avril 2022, pas avant).
Comme d’habitude, on va citer quelques paragraphes intéressants de l’article payant, sans aller trop loin, pour ne pas réveiller les autorités de chez Dassault.
Quels sont les invariants d’une telle guerre ?
Le point principal est la supériorité de la défensive sur l’offensive. Si cela n’avait pas été le cas, l’Ukraine aurait été battue depuis longtemps. Pendant la Première Guerre mondiale, déjà, il fallait franchir un « no man’s land » saturé de barbelés, l’une des armes les plus efficaces du début du XIXe siècle. Puis, il y a eu les champs de mines, qu’on a vus en Iran-Irak et que l’on voit aussi en Ukraine. C’est une barrière d’interdiction d’une compacité extraordinaire. Les Ukrainiens s’y sont heurtés à l’été 2023 lors de leur contre-offensive ratée, et les Russes depuis 2024. Ainsi, on ne peut pas percer sur des dizaines de kilomètres de large et briser le front adverse. On observe une sorte de régression dans les trois conflits. En Ukraine, les hélicoptères et les avions volent très peu au-dessus et au-delà de la ligne de front. Il n’y a pas non plus de grandes offensives blindées. Jamais on n’a observé quelque chose de similaire à la bataille de Koursk de 1943. Ainsi, le combat repose-t-il massivement sur l’infanterie.
SAR explique que la guerre de positions donne l’avantage à celui qui possède l’artillerie la plus puissante avec la production de munitions la plus importante. Mais cet avantage a été, au début du conflit (en 2022), contré par l’utilisation des drones ukrainiens. Cependant...
Les drones ont pris l’ascendant sur l’artillerie au cours de l’année dernière, vérifiant cette vieille règle clauzewitzienne que la guerre est un caméléon et que la vitesse d’adaptation est cruciale dès lors que les économies industrielles sont lancées à plein régime.
Les marqueurs de SAR vont tous dans le sens d’une défaite ukrainienne quasi totale, même si elle ne se voit pas sur le champ de bataille.
J’ajouterai une autre caractéristique de la guerre de position : on ne discerne pas immédiatement la défaite quand celle-ci se profile. Elle est longue à apparaître. Ce n’est pas comme à Stalingrad, où il y a un vaincu qui quitte le champ de bataille et un vainqueur qui l’occupe. Ce n’est pas comme la blitzkrieg de mai-juin 1940. Dans une guerre de position, ce sont deux corps de bataille qui, l’un contre l’autre, s’usent lentement. À la fin seulement, il apparaît que l’un s’est usé plus vite que l’autre.
Le parallèle avec l’Allemagne de 1918 est frappant et explique sûrement les errances des ânes de LCI :
En réalité, la défaite allemande est certaine depuis juillet-août 1918. Elle a eu lieu, mais elle n’est pas encore apparente. Depuis l’été, l’état-major allemand le sait très bien et demande le lancement de négociations. Sauf que le pouvoir politique ne le comprend pas, l’opinion publique allemande non plus et ne le comprendra jamais. Cette non-compréhension de la défaite de 1918 sera l’une des raisons de la poussée du nazisme.
SAR, qui est inquiet pour Kiev, pousse l’analogie entre l’avancée russe en 2025 et le recul allemand de 1918 :
Les risques d’une offensive russe en Ukraine, cet été, m’inquiètent : compte tenu de la disproportion des forces, pourrait-elle briser le front ? On entrerait alors dans une autre configuration, car toute rupture du front risquerait de produire un effet moral puissant sur les forces armées ukrainiennes, sur le pouvoir politique et sur l’opinion publique.
Kiévien convaincu, il garde un espoir sur l’après-guerre :
La bonne question n’est pas de savoir si l’Ukraine a perdu la guerre, ça me paraît malheureusement trop évident, mais de savoir jusqu’où elle va la perdre. Sur la base du rapport de force actuel, ou bien sur celle d’un rapport de force plus défavorable encore ? Cela déterminera si la défaite ukrainienne représente, ou non, une victoire russe sur le plan stratégique. Car la situation de la Russie au sortir de la guerre, même si elle est victorieuse tactiquement, pourrait s’avérer extrêmement difficile. C’est le plus long terme qui nous le dira, comme toujours avec les guerres. La position de vainqueur et de vaincu s’inverse parfois de manière étonnante…
Il est vrai que l’équilibre des forces n’est plus qu’un souvenir. Le boxeur russe, qui a encaissé des coups, est toujours debout, et continue à en donner, à l’image d’Ilia Topuria :
Mais, depuis, les Russes sont repassés à l’offensive. Dorénavant, la balance des forces est en leur faveur, et de plus en plus semble-t-il. Ils ont pour eux leurs terribles bombes planantes, mais aussi des drones filoguidés qu’ils maîtrisent mieux et plus intensément que les Ukrainiens. Quant aux drones à longue portée, à l’origine iraniens, ils en tirent désormais plusieurs centaines par jour. Kiev craint qu’ils franchissent le chiffre quotidien du millier ! Les défenses ukrainiennes, en face, sont saturées. Surtout, il y a la puissance démographique de la Russie qui compte 144 millions d’habitants quand l’Ukraine en comptait 40 millions avant-guerre et aujourd’hui beaucoup moins. C’est terrible à dire, mais quand le négociateur russe à Istanbul a demandé aux Ukrainiens combien de temps ils étaient prêts à se battre, en ajoutant que les Russes pouvaient se battre un, deux, trois ans, voire éternellement, il y avait malheureusement quelque chose d’assez exact dans cette déclaration.
SAR insiste, malgré son parti pris total, sur la résilience russe :
L’héroïsme ukrainien, qui nous a été profondément sympathique – et à juste titre ! –, nous est apparu comme une promesse de victoire, comme si la victoire obéissait à une forme de morale. Mais la guerre n’a strictement rien à voir avec la morale ! Quant à la Russie, oui, Dieu sait qu’on a moqué ses échecs initiaux, absolument spectaculaires. Mais on a oublié que c’était le pays de Stalingrad et de Koursk, et qu’il existe dans ce pays une capacité d’adaptation absolument extraordinaire. La Russie a gravi la « learning curve » militaire assez lentement, mais elle l’a gravie : les forces russes auxquelles les Ukrainiens se sont heurtés à l’été 2023 n’étaient plus du tout celles de 2022, et celles d’aujourd’hui moins encore. C’est cette réalité que nous ne voulons pas voir.
Nous n’avons pas non plus voulu admettre que la propagande poutinienne – toutes ces références à la Grande Guerre patriotique et à la soi-disant dénazification de l’Ukraine – pouvait être profondément intériorisée par de larges couches de la population russe.
Et il termine sur le cauchemar des Occidentaux, donnant du grain à moudre aux pro-guerre Starmer et Macron : pour lui, une Russie vainqueur n’a aucune raison de s’arrêter aux frontières de l’Ukraine.
Nous n’arrivons pas à imaginer qu’une fois que la Russie aura gagné la guerre d’Ukraine – et on ne sait pas exactement en quels termes et jusqu’où elle va la gagner –, elle pourrait décider de la poursuivre. Cette hypothèse reste en dehors, pour l’instant, de notre horizon d’attente. Qu’il y ait des stratèges, des militaires qui y réfléchissent, c’est heureux, mais il me semble que d’un point de vue collectif, nous n’arrivons pas à concevoir que la Russie pourrait commencer à tester l’article 5 de l’Otan en s’attaquant, par exemple, à l’Estonie ou à la Lituanie. On sait que c’est possible, mais c’est, en tout cas en Europe occidentale, une pure hypothèse théorique. Le déni de guerre domine, encore et toujours. Jusqu’à quand ?













 et
et  !
!