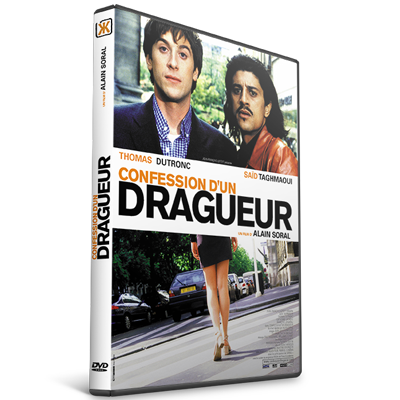Le cinéma français, depuis qu’il n’est plus le noble divertissement destiné au peuple, avec son culte du héros positif, a sombré dans le totalitarisme égalitariste. Toute sa mécanique, que ce soit au niveau production, réalisation, acting et promotion, est désormais tournée vers un objectif : le camouflage de la doxa ultralibérale, dite aussi droite du travail (hiérarchie, compétition, individualisme, esclavage), derrière une gauche des valeurs (laxisme, vulgarisme, indéterminisme, déresponsabilisation, sexualisation). Voilà pourquoi ce cinéma transpire autant la psychanalyse de grand bourgeois : c’est la culpabilité d’en haut refourguée à la France d’en bas. Que nous finançons.
Aristos kratos

« Notre » cinéma a alors pris le chemin de la proximité, chère à « nos » hommes politiques, un concept qui date de la déchirure peuple/élite, produit de 35 ans de surplace mitterrando-chiraquien (UMPS). Le 7ème Art n’est plus vecteur de rêve, de modèle(s), de transcendance, mais de banalité, de rabaissement, d’humiliation. Comme si les réalisateurs avaient voulu se rapprocher du peuple en se rapprochant de la laideur. La beauté étant considérée en creux comme une injustice naturelle, une aristocratie, rare par définition (ce qui fait paradoxalement toute sa valeur), elle a été éradiquée plus ou moins consciemment des images.
Ayant perdu de son impact auprès du grand public, qui se déplaçait pour « ses » monstres sacrés, le cinéma a limité les dégâts par la surconsommation (cartes et multiplexes). Monstres qui, lorsqu’ils n’étaient pas plastiquement attirants, rayonnaient d’un charisme puissant en incarnant des valeurs ultra viriles (Gabin, Delon, Ventura, Belmondo) ou ultra féminines (Signoret, Bardot, Schneider, Deneuve), loin, très loin de la théorie uniformisatrice transgenre. Sont alors arrivés les films dits sociaux, c’est-à-dire terre-à-terre, glaiseux, composés de comédiens à identification immédiate, c’est-à-dire non-beaux, par souci de réalisme, par refus d’élévation, par conviction antireligieuse : l’horizontalité contre la verticalité.

- Boudin 1 – Belle 0
Et quand le cinéma contemporain convoque une beauté, c’est pour la rabaisser, la punir, la salir. Voyez la sublime Carole Bouquet de Trop belle pour toi, battue par une gravosse quelconque, Josiane la Balasko. Un contre-pied du fils Blier, qui transgresse ce qu’il peut, et abat des statues, à défaut de son père. Ou la sensuelle Monica Bellucci, qui fait des apparitions dans un seul registre. « Je campe à la fois la maman et la putain », explique-t-elle au Figaro Madame. La putain, on voit bien, mais la maman ? Quant à la fillede fesse-à-claques Léa Seydoux, son potentiel charmant est déjà souillé par un porno lesbien. Et Jean Dujardin, sorte de Sean Connery français, à qui l’on inflige des rôles de couillon paumé (Brice de Nice, OSS 117, 99 Francs, The Artist, Les Infidèles) ou de mourant (Les Petits Mouchoirs, Le Bruit des glaçons). Muscle ton jeu, Jean ! Certes, Dujardin figure dans un Scorsese et un Clooney, mais pas en premier rôle.
On ne reviendra pas sur le tournant de la « Nouvelle Vague », qui a achevé le cinoche français d’après-guerre, à coups de Cahiers du cinéma, de déstructuration (ça fait plus chic que destruction), de branlette intellectuelle pseudo-maoïste, de truffautage et de godardisme. En fait, le signe de l’américanisation du pays, sous le masque d’une (r)évolution culturelle qui annonçait des changements cruciaux : la fin de l’indépendance nationale, le début des revendications catégorielles, la victoire de la consommation sur la production, et la victoire du libéral-socialisme face au communisme. Les Américains ont beaucoup aimé la Nouvelle Vague, tu m’étonnes.
Dany Boon & Yolande Moreau ont remplacé Alain Delon & Brigitte Bardot

Il y a eu glissement, c’est évident. Les grands acteurs, considérés il y a cinquante ans comme des demi-dieux, ont disparu. Le cinéma n’en produit plus, du moins chez nous. Comme le paysan soviétique qui décide d’arrêter de faire de l’asperge, pour se lancer dans le navet… sur décision du Parti. Pour une raison toute simple : les valeurs morales sur lesquelles la majorité des gens (honnêtes et donc pauvres) est d’accord, et qui sont le travail, la solidarité, le courage, la patience, le pardon, l’amour, le respect, la droiture, le sens du collectif, bref, les valeurs religieuses, ne sont pas celles qui règnent dans le monde du cinéma en particulier, et dans la société en général. Et qui rendent pourtant le monde supportable. Si elles existent, c’est parce qu’elles résistent. Ce ne sont pas les valeurs véhiculées par les médias, qui prônent plutôt l’individualisme, la cupidité, la compétition, le mensonge, la trahison, la lâcheté, le calcul, et la démagogie. Le vice contre la vertu, tout simplement.

Il n’y a qu’à regarder des émissions de télé-réalité – cette sociologie qui crève l’écran –, très utiles de ce point de vue : les candidats, sélectionnés sur une base intellectuelle limitée, mobilisent comme ressources de survie les antivaleurs décrites plus haut. Ces ânes sont promus (le temps de leur utilisation par le système) uniquement pour asséner aux autres ânes qui les suivent, que les valeurs chrétiennes sont mortes, ringardes, nuisibles à la réussite individuelle, voire à la gloire (rire). Le système médiatique englobant presse, télé et cinéma, il était normal que le tout soit cohérent. Et le tout est cohérent.
Une poignée de films « moraux » est subtilement conservée, à l’instar des animaux dans les zoos – alors que le massacre de leur espèce a été sauvage –, pour entretenir artificiellement ces valeurs positives dans l’esprit des dominés, à seule fin de mieux les duper, valeurs auxquelles plus personne ne croit dans la dominance politico-médiatique. La morale, c’est pour en bas. D’où le sentimentalisme, le misérabilisme, l’humanisme niais, exaltés par la chaîne des scénaristes et réalisateurs, censés faire croire à l’empathie de l’élite pour « son » peuple, ce résidu de paternalisme.
Parmi les « idiots utiles » choisis et promus pour entretenir l’illusion, il y a les frères Dardenne.
Les Dardenne, rois du film d’épouvante… sociale
Invités permanents au Festival de Cannes, quel que soit leur film, qui focalise toujours sur l’hyper-misère, les deux Belges cultivent une idée étonnante du peuple, à mi-chemin entre l’ouvrier décérébré de Zola et le romanichel organiquement délirant.

- Pauvros et Pauvrasse jubilent car ils ont le même blouson
Les Dardenne, ex-producteurs de documentaires, sont les rois – Ken Loach mis à part – du cinéma engagé à travers la fiction. Les Dupont et Dupond de la déchéance électrisent les mainstream media avec leur première Palme d’or en 1999, Rosetta, histoire d’une semi-goldu qui veut sauver sa mère bourrée dans la caravane (on dirait un rap délirant de Seth Gueko), avant de récidiver en 2005 avec L’Enfant, une œuvre sur les sous-prolétaires victimes de leurs mauvais instincts. Bien sûr, toute la dimension militante droitdelhommiste antilibérale échappe aux SS sans cœur qui rigolent, mais on peut dire que les Dardenne font dans le film de genre : à la place du requin qui mord tout le monde, c’est le chômage, l’alcool, ou la saloperie intrinsèque du pauvre, attention, induite par la société, responsable de tous les maux, malgré quelques fulgurances christiques. Tous ces maux et vices qui collent au cul du peuple depuis des lustres. On aurait apprécié une critique du libéralisme d’un niveau un peu plus élevé, mais chacun fait ce qu’il peut.
Entre autres, les Dardenne ont produit Le Couperet, réalisé par Costa Gavras, risible bouse sur la vie de l’entreprise, qui a le mérite de montrer que la Grande Famille du Cinéma fantasme complètement le réel, à défaut de le connaître. Misérabilisme n’est pas lucidité, et dans le cas présent, la misère reste une excellente cash-machine pour les frangins, un peu comme chez ce gros multimillionnaire de Mike Moore. Poverty is money !
La fiction ayant montré ses limites malgré le push marketing, en termes d’entrées (380 000 pour L’Enfant, 690 000 pour Rosetta, moins qu’une merde d’Éric & Ramzy) et de crédibilité, le nouveau cinéma social opte pour le docufiction, ou docudrama plus cru, plus vrai, plus moche. La page Dardenne est… tournée.
Louise Wimmer dans ta face, sale bourge !
Louise Wimmer, sorti en 2012, réalisé par Cyril Mennegun et produit par Bruno Nahon, croule sous les récompenses et sélections. La critique est unanime, dirait Tante Ruquier. La preuve, Marjolaine Jarry, du Nouvel Obs :
« En ces temps de crise qui écrase et qu’on voudrait faire passer pour une fatalité, “Louise Wimmer” est un cri de révolte qui porte loin. »
Sûr que ce cri va aider les pauvres à s’en sortir, en leur mettant bien la tête sous l’eau. Car il y a Gilles, inconnu, légèrement moins euphorique :
« Une tranche de vie de merde comme on peut en voir régulièrement dans les journaux télé et autre documentaires qui font dans le voyeurisme. Un film pessimiste ou l’ennui prend le dessus mais qui finit heureusement sur une lueur d’espoir. A éviter sous peine de dépression aiguë, ce n’est pas le genre de film que je recherche quand je vais au cinéma. » (Source Allociné)

- Le public attend que Louise finisse sa bière
Cyril Mennegun, issu comme les Dardenne du docu social, trace le portrait d’une cinquantenaire en noyade, un peu femme de ménage, un peu mère, un peu pute, un peu moche, un peu alcoolo, un peu SDF. Un peu chiante surtout, comme le film, qui aurait mérité un format de 13 minutes dans Envoyé spécial sur le quotidien d’une vraie femme de ménage. Cela aurait suffi pour la démonstration que « la crise y en a qui rigolent pas tous les jours bande de nantis ».
Le pire, c’est le happy end, qui déculpabilise les bourgeois à la manœuvre. On met évidemment de côté la « performance d’acteur » de Corinne Masiero, qui n’hésite pas à se mettre à nu pour les besoins de la bourgeoise rongée de remords : vois le corps décharné de l’ouvrier, la victime christique du libéralisme ! Vois les côtelettes du peuple (et aussi un peu ses maigres nichons) ! Regarde ce que tu as fait, salaud !
Et quand Louise fait l’amour, elle le fait avec férocité, voracité, comme la Vie qui ne renonce pas. Voilà la nouvelle beauté, splendeur de la laideur. Nul doute que le Mennegun est appelé à remplacer les Dardenne, trop surréalistes dans le glauque, chez des producteurs de long-métrages socio-pédagogiques. Car dans le zoo, il n’y a pas deux places pour le même animal.
Quand la paupérisation du sujet force la paupérisation formelle
Dans le nouveau « drame social » (un pléonasme, le social étant un drame), il y a des invariants. Une histoire sans rebondissements – on rappelle accessoirement que le cinéma est mouvement – en lieu et place des scènes un diaporama de la grisaille quotidienne, des plans fixes à décrocher la mâchoire, tout l’arsenal cinématographique de l’empathie pathologique dans le noble but d’émouvoir le chaland. La lenteur est censée donner de la sobriété à l’ensemble ; c’est évidemment tout le contraire qui se passe. L’entreprise culpabilisante (assister à la misère sans pouvoir agir, être réduit à l’impuissance par l’image, et donc culpabiliser… ou jouir de la misère de l’autre) fonctionne malgré tout sur un public rendu honteux de ses choix par trop populaires. Mais au détriment de l’amour du cinéma, devenu cours de sociologie bourdivine en amphi.

- Savage Kid (États-Unis)
Pourtant, une seule scène de la série américaine Breaking Bad a plus d’impact social sur le spectateur que les 80 minutes de Louise Wimmer : il s’agit du moment où le comparse du chimiste pénètre dans une maison dévastée, à la recherche d’un sac de « crystal meth » qu’un couple de dépravés lui a volé. Quand soudain, un enfant, sale, seul, silencieux, s’assoit sur le fauteuil déglingué et regarde, hypnotiquement, une vieille télé. Tout est dit, sans pathos. L’image d’une Amérique abandonnée, fabriquant des enfants sauvages, qui dérange vraiment.
Heureusement, la France, dans le genre social-gore, tient avec Nord depuis 20 ans un record qui n’est pas près d’être battu.
Nord, ou la Palme d’or… dure
La crêpe Chômage-Handicap-Inceste-Alcool… c’est la complète Nord-Pas-de-Calais !

- Duo comique calaisien (1992)
Savourez le résumé de Télérama :
« Bertrand vit à Calais, dans le silence d’une famille désossée. Son père noie sa tristesse dans l’alcool, sa sœur handicapée mentale subit l’immobilisme de son corps, sa mère végète tristement devant la télévision. Bertrand, lui, sèche les cours du lycée pour aller pêcher en mer. »
Et la suite sur le site de Première :
« On oblige le père à faire une cure de désintoxication, en vain. De retour à la pharmacie, il se trompe dans une préparation, un enfant en meurt. Bertrand cherche son père pour le tuer et en finir. Il le trouve, ils se parlent pour la première et dernière fois. Le père se tue mais Bertrand est accusé et emmené en prison. »
On aurait voulu écrire un faux pitch caricaturant les clichés sur le NPDC, on n’aurait pas fait mieux. Nord, de et avec Xavier Beauvois, est sorti du néant en 1992. Échec commercial programmé, il n’aura pas bénéficié de l’argent du Conseil régional, 600 000 euros de subventions qui seront accordés aux Ch’tis seize ans plus tard (pour seulement 20 479 826 entrées). On se demande bien pourquoi. Si le public a boudé, la profession a reconnu l’un des siens : Beauvois rafle depuis prix sur prix à Cannes, et la Palme ne lui échappera pas longtemps.
Le cas Daniel Auteuil, meilleur acteur français… pas très beau

Daniel est souvent cité comme le meilleur acteur français… par le milieu et la presse spécialisée. Il a reçu douze nominations et deux Césars dans la catégorie « meilleur acteur », plus un prix d’interprétation à Cannes. Il excelle notamment dans les scènes dramatiques où il fait les gros yeux, mélange d’enfant stupéfait et d’adulte souffrant. Il a explosé médiatiquement en incarnant Ugolin dans la saga Jean de Florette réalisée par Claude Berri, véritable parrain du cinéma français pendant quarante ans. Un Ugolin laid, mais avec du « bien », qui n’arrivera pas à gagner l’amour de Manon (il se rattrapera dans la vraie vie en attrapant la vraie Emmanuelle Béart). Attention, les symboles ont un sens. Daniel n’est pas spécialement beau, mais compte à son actif vingt-cinq films millionnaires en entrées, et gagne beaucoup de sous. Malheureusement, il demeure inexportable, contrairement à Jean Dujardin.
Étonnant, non ?













 et
et  !
!