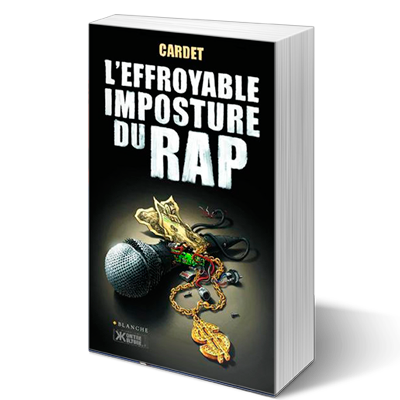Le livre de Mathias Cardet n’a jusqu’à présent laissé personne indifférent. Toute la presse gauchiste, branchouille et soi-disant indépendante n’a pas hésité à stigmatiser cet essai, rappelant du même coup que son éditeur n’était autre que l’insolent Alain Soral. De là à trouver de la propagande fasciste, il n’y aurait donc qu’un pas ! Mais soyons sérieux le temps d’un article… C’est ainsi que Diktacratie, se refusant de faire le jeu d’un quelconque parti, s’est appliqué à lire plume à la main ce livre noir du rap pour en faire le plus objectivement possible sa propre synthèse.
C’était il y a moins de 50 ans. Les ségrégations raciales sévissaient encore brutalement aux États-Unis. De Martin Luther King au Black Panther Party d’Huey P. Newton, les contestations y étaient nombreuses et l’insurrection à tout moment possible. Le pays semblait au bord de la guerre civile. C’est pourquoi les pouvoirs en place ont œuvré sournoisement pour préserver leurs privilèges oligarchiques tout en proclamant plus d’égalité civique… En 1966 par exemple, le Projet 100 000 du secrétaire à la Défense Robert McNamara permit ainsi aux plus pauvres – entendez aux Noirs – d’intégrer en masse l’armée pour ensuite aller animer les premières lignes du conflit vietnamien. La protestation sur le sol américain se fit donc légitimement plus radicale.
Comment alors la rendre moins nocive tout en la laissant s’exprimer ?
Eros and Civilisation
Rappelons d’abord qu’à la fin des années 60 un Noir semblait l’égal d’un Blanc s’il partageait son niveau de vie. En effet, le capitalisme générait aussi de l’égalité… mais à partir d’un certain statut social ! Une lutte des classes inversée en quelque sorte ! Reste que pour atteindre ce statut, une petite révolution restait nécessaire. C’est là qu’intervient la célèbre Angela Davis. Figure de proue d’un marxisme travesti, cette idéologue proposa justement la sublimation de la lutte des classes sur le modèle marcusien. Autrement dit via une dialectique libérant nos plaisirs primaires.
Le ghetto noir semblait le berceau idéal pour cette révolution hédoniste. En effet si l’afro-américain trouvait de quoi jouir dans ce qu’il entreprenait là où il était, il commencerait à pouvoir entrevoir son émancipation ! On comprend mieux désormais le succès, début des années 70, des films militants de la Blaxploitation comme Sweet Sweetback’s Baadasssss Song ou Superfly avec des Noirs armés, gros baiseurs et dealers à la cool. Il s’agissait tout simplement de glamouriser une certaine image de la lutte afro-américaine pour la rendre plus inoffensive.
Mais l’arrivée de blockbusters comme Les Dents de la mer ou Star Wars allait bouleverser la donne. La subversion tenta alors de basculer dans d’autres contrées… Cette fois-ci plus urbaines.
« Paix, amour, unité et… fun ! »
1973. New York, West Bronx, une rue barricadée de chaque coté : une block party ou une fête disco-funky animée par un DJ. Pour pimenter la danse on installa une deuxième platine, puis un « maître de cérémonie » (MC’s) balança son verbe. De quartier en quartier le flow sembla prendre de l’ampleur…
Afrika Bambaataa, alias Kevin Donovan, fonda alors la Zulu Nation. Son message : « Peace, Love, Unity and Having Fun ! » Ou comment envoyer les Noirs du ghetto progressivement dans les bras des promoteurs du capitalisme du désir. Début des années 80, Zulu Nation se produira même au fameux Roxy sous le regard fasciné de la bourgeoisie bohème new-yorkaise.
Rappelons par ailleurs que débutent alors les années Reagan, ces années de récession où l’ultralibéralisme de Milton Friedman orchestre la paupérisation de l’Amérique. Aussi, les premiers à trinquer sont bien sûr les quartiers pauvres. Les rappeurs arrivent à point nommé donc, pour jouer les idiots utiles dénonçant une situation dont ils sont pourtant les produits. En effet leur but c’est avant tout de vendre – c’est ainsi que fonctionne la machine libérale –, et ceux qui ont le pouvoir d’achat restent les Blancs ! Voilà pourquoi un rap markété, métissé, et consensuellement agressif… bref, idéal pour faire un carton sur MTV ! Avec Run DMC et Beastie Boys comme parfaits boute-en-train singeant une posture rebelle noyée dans un discours universaliste et offrant à la jeunesse américaine la catharsis idéale pour oublier la dictature du capital…
C’est alors l’occasion pour le jeune promoteur et financier Lyor Cohen d’insuffler dans cette musique une dimension publicitaire, histoire de vendre plus que de la musique… Des baskets par exemple (My Adidas de Run DMC) !
De Public Enemy à Jay-Z
Reste qu’à cette même époque le discours explicitement radical d’un Public Enemy excitait encore suffisamment l’auditeur pour qu’il continuât d’acheter des disques en grande quantité. Les promoteurs, percevant le succès croissant de ce nouveau rap militant, doublé d’une fascination névrotique de la jeunesse pour un film comme Scarface, n’hésitèrent pas à construire une mythologie exagérant la dimension illicite de certains de ces rappeurs…
Nous sommes à la fin des années 80, c’est l’aube du gansta rap ! Le manager Jerry Heller associé au dealer Eazy-E va alors distiller un surplus de sexe et de violence au sein d’un rap prétendu de gangsters, parce qu’issu en partie des quartiers chauds de Los Angeles. Plus la vitrine est crapuleuse et censurable, plus c’est bénéfique pour les ventes. Comble de l’imposture avec l’ordurier mais inoffensif Snoop Doggy Dog, déifié de la sorte par l’ancien partenaire de Heller et Eazy-E, l’incontournable Dr. Dre.
Viendra par ailleurs se greffer en contrepoint un rap dit légitime, parce qu’authentique (Mobb Deep) où de soi-disant vrais gangsters utiliseront la rue comme un immense terrain de promotion à peu de frais (autocollants, affiches, tracts…).
On l’aura bien compris le rap aux étiquettes sulfureuses n’est en définitif qu’un immense tremplin marketing pour vendre toujours plus. Un rap aux déviances bling-bling alliant idéologies du fric et invectives de bandits. Un rap pour convertir les esprits au néolibéralisme. C’est ainsi que des artistes comme Tupac et Notorious B.I.G. hisseront dès l’année 1996 le rap comme musique numéro un de l’industrie du divertissement. Mais l’assassinat respectif de ces protagonistes du gansta rap fut le revers inéluctable de ce succès ! Restera alors Puff Daddy, plus opportuniste, suivis entre autres par Eminem et 50 Cent, aux mythologies toujours plus consommables… La palme, quand même, pour Jay-Z dont même le président Obama, alors en campagne, se réclamera et dont Time magazine présentera comme l’un des hommes les plus influents de notre planète, au même titre qu’un Bill Gates !
Rapattitude française
France. Fin des années 80. Nos banlieues sont laissées quelque peu à l’abandon par un système ne jurant que par la réussite de son entreprise libérale. Le terrain est donc propice à cette culture urbaine qui conteste tout en nous divertissant. Ainsi l’émission Deenastyle sur Radio Nova saisira l’opportunité pour faire découvrir des groupes comme NTM, Assassin ou Ministère A.M.E.R.
Par ailleurs dès l’année 1990 une compilation inspirée – Rapattitude – propulsera le mouvement hip-hop aux meilleures ventes de l’industrie musicale française pour la décennie à venir.
Un petit coup de pouce de Toubon avec sa loi imposant 40 % de chanson française, une radio vouée corps et âme à la diffusion de cette musique – Skyrock pour ne pas la nommer –, et l’affaire était dans les bacs ! Autant de moyens mis en œuvre pour propager ce bon vieux rap français ! Rien de mieux pour nous divertir, nous énerver puis... nous asservir.
Bref une propagande orchestrée à la perfection par nos parangons de l’ultralibéralisme : ici un rap faisant l’éloge du shit pour mieux nous abrutir ; là un autre, plus systématique, célébrant le culte de la réussite individuelle comme seule issue de la crise sociale et économique. Le but ? Résorber toute entreprise solidaire et toute cohésion des forces vives pour devenir le genre de petit bourgeois capitaleux capable de satisfaire ses désirs narcissiques dans l’accaparement d’objets seuls garants d’une réelle individualité.
Paradoxalement, des modèles prônant une standardisation des banlieues et multipliant du même coup une frustration pour la majorité, condamnée à se contenter de ce qu’elle n’aura jamais. C’est là toute la perversion de ce rap français qui inhibe une violence générée par ce qu’il fait miroiter !
« Je veux pas brûler des voitures, mais en construire, puis en vendre. » – Kery James
Ou comment consommer de la fausse révolution en omettant d’accomplir la vraie !
En définitive le discours du rappeur conduit uniquement à l’acte d’achat. Ainsi son succès équivaut à son degré de soumission aux oligarchies marchandes et sa contestation se réduit à un manque à gagner et non à un monde à changer.
Détourner les colères légitimes ; ne jamais mettre le système en danger ; maculer la langue ; promouvoir une culture de masse nocive et abrutissante ; travestir les chamailleries de cage d’escalier en insoumission réelle ; contrôler le temps libre de la jeunesse ; relayer un clip à la manière d’une publicité ; mutiler l’islam pour le rendre compatible avec le mondialisme… Voilà, parmi d’autres, une série de symptômes relevant plus de la propagande libérale que de la syntaxe musicale !
Le rap est devenu une arme d’asservissement massif exaltant un monde iconisé où l’importance de chacun est relative à son degré de représentation dans le système. L’alternative est simple : soit se soumettre pour exister comme acteur de la mondialisation, soit s’autodétruire. Resterait peut-être l’issue de s’unifier ? Malheureusement le nous s’est délié pour devenir un ensemble de je… « de jeux, comme divertissements ».













 et
et  !
!