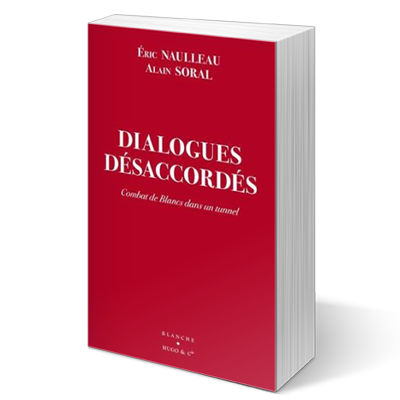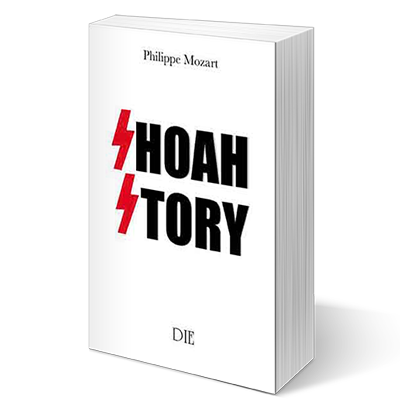« Pourquoi Godard n’a de cesse de vouloir prouver à tout le monde que les juifs ne sont pas vraiment bons, c’est son problème. Mais ce faisant il pose quand même une bonne question. »
Sauve qui peut (la vie)
De Francis Ford Coppola, à Martin Scorsese en passant par Wong-Kar Wai, Bertrand Blier, Gaspar Noé, Brian de Palma ou bien sûr Quentin Tarantino, qui lui a dédié sa boite de production, le travail de Jean-Luc Godard a influencé les cinéastes du monde entier et beaucoup reconnaissent avoir une dette envers lui.
Ce serait un « cinéaste pour les cinéastes » selon l’expression d’Oliver Stone. Bien que le grand public ne se déplace pas pour ses œuvres, trop peu narratives, de prime abord abstraites, tutoyant ainsi la caricature honnie du « cinéma intello » qu’il a lui-même contribué à façonner, les professionnels comme les critiques lui reconnaissent cette qualité de laboratoire vivant, d’innovation du langage cinématographique, touchant à des questions pertinentes concernant l’expression audiovisuelle et autres représentations des images en mouvement (c’est autant un féroce critique de la télévision que du cinéma hollywoodien).
Le 13 novembre 2010, il était convenu de lui décerner un oscar pour sa contribution au cinéma [1] mais la presse américaine a résolument décidé de faire son procès pour antisémitisme afin d’intimider les votants de l’académie à revenir sur leur décision. Antoine de Baecque, son récent biographe, regrette d’ailleurs que personne, parmi l’élite politico-culturelle française (ministre de la Culture, acteurs ayant travaillé pour Godard, CNC…) n’ait publiquement soutenu le cinéaste. Godard n’en a que faire : il n’ira même pas à Hollywood, pas de visa et pas l’envie : l’Oscar ne représente rien pour le Franco-suisse. Anne-Marie Miéville, sa compagne, dira que « de toute façon il se fait vieux pour ce genre de chose. Vous l’imaginez faire tout ce chemin pour un morceau de métal ? »
Sont-ce ses propos provocants sur l’industrie du spectacle qui ont refroidi la presse (« Hollywood a été inventé par des gangsters juifs » ou bien « ces producteurs émigrés d’Europe centrale ayant compris que faire un film, c’est produire une dette ») ou bien ses positions pro-palestiniennes durant les années 70 qui froissent autant la susceptibilité de ses détracteurs ? (« Si je voulais me suicider, j’irais en Israël ou en Afghanistan, avec dans la sacoche des livres à la place des bombes, mais la police ne le saurait pas. Et je demanderais à l’ennemi qu’il m’accompagne, pour qu’on dise “Ils se sont suicidés pour la paix. Ils n’ont pas fait un défilé contre la guerre, ils sont morts pour la paix”. »). Ou l’époque, qui devient de moins en moins encline à faire fi des provocations du Franco-suisse, de plus en plus crispée et peu prompte à la désacralisation des valeurs modernes, renforçant ainsi de nouveaux tabous ?

« Six millions de kamikazes »
Dans Morceaux de conversations avec Jean-Luc Godard, filmé par Alain Fleisher, le cinéaste de la nouvelle vague aurait tenu des propos très polémiques, en partie écartés au montage, dont certains portent sur les deux films de Claude Lanzmann, Shoah et Tsahal. Lors d’une pause durant cette interview, Fleisher raconte que Godard aurait glissé en aparté à son ami et interlocuteur Jean Narboni , ex-rédacteur des Cahiers du cinéma :
« Les attentats-suicides des Palestiniens pour parvenir à faire exister un État palestinien ressemblent en fin de compte à ce que firent les juifs en se laissant conduire comme des moutons et exterminer dans les chambres à gaz, se sacrifiant ainsi pour parvenir à faire exister l’État d’Israël. »
En mourant dans les camps, ces juifs auraient pour Godard, sauvé Israël :
« Au fond il y a eu six millions de kamikazes [2]. »
Une parole qui va pourtant moins loin que les paroles excessives du Rabbin Rav Ron Chaya, affirmant que « les bienfaits de la Shoah, c’est inimaginable ». Mais pour la brigade de la Mémoire, c’en est trop, et le Franco-suisse à la voix traînante est flashé en pleine récidive : la première fois, ce fut en 1974, lorsque, illustrant sa notion du montage comme vision comparative de l’histoire, il faisait chevaucher dans Ici et ailleurs une image de Golda Meir, Premier ministre israélien, avec celle d’Adolf Hitler. À l’origine, cela provient d’une commande que Godard et Anne-Marie Miéville reçoivent du comité central de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) pour un film sur le camp palestinien d’Amman en Jordanie. Suite au « Septembre noir », le projet de film signé par le Groupe Dziga Vertov et intitulé Jusqu’à la victoire est mis de coté. Quatre ans plus tard, ces images sont reprises avec désormais pour titre Ici et ailleurs et le malentendu peut commencer (de nouvelles traductions de l’arabe parlé par les protagonistes filmés à l’époque laissent apparaître une réalité manipulée à plusieurs niveaux). Dans Sauve qui peut (la vie), un personnage parlait d’indépendance dans ces termes :
« Personne n’est indépendant (…) les putes, les dactylos, les bourgeoises, les duchesses, les serveuses, les championnes de tennis, les collégiennes et les paysannes. Il n’y a que les banques qui soient indépendantes et les banques c’est des tueurs… »
Il est fort possible d’y voir le renoncement du cinéaste, doublé de regrets…
L’engagement pour la cause palestinienne
Prenant fait et cause pour la Palestine, l’auteur d’Une Femme est une femme s’est maintes fois plu à rappeler que, dans les camps nazis, les détenus au seuil de la mort étaient désignés sous le terme de « musulmans » (« La Guerre au Moyen-Orient est née dans un camp de concentration le jour où un grand clochard juif avant de mourir s’est en plus fait traiter de musulman par un quelconque SS »), sous-entendant que les victimes d’hier sont devenus les bourreaux d’aujourd’hui. Sur le même mode, Godard dira :
« Le peuple juif rejoint la fiction, le peuple palestinien le documentaire. »
Ces phrases ont pourtant eu une résonance forte dans le monde du cinéma, car le réalisateur israélien Ari Folman, en 2008 dans Valse avec Bachir, appliquera cette leçon d’histoire et de cinéma à la lettre dans sa réalisation, en montrant l’opération « Paix en Galilée » du Liban en 1982 comme un rêve en animation (la fiction) et se terminant avec des images de reportage montrant les dégâts dans la communauté palestinienne (le documentaire). Le réalisateur israélien ira plus loin en faisant dire à un de ses personnages qu’ « ils (Tsahal) sont devenus pire que les nazis », sans que personne ne freine sa venue à Hollywood afin de réaliser Le Congrès. De plus en plus apparaît sur un même sujet la parole autorisée et la parole de goy, suspecte, évidemment.
Un projet de film a été envisagé avec Marcel Ophuls (réalisateur du Chagrin et la pitié) : ce dernier devait jouer un Israélien et Godard un Palestinien dans un appartement censé représenter Israël. L’Israélien aurait dit : « Dieu m’a élu, cet appartement est le mien » et le Palestinien aurait répliqué, mais le projet ne s’est jamais monté. Autre projet en 2006, rapporté par son biographe américain Richard Brody : Godard propose à BHL de tourner avec lui Terre promise en Israël en emmenant avec eux… Tariq Ramadan [3]. À la suite de blocages financiers et de problèmes d’emploi du temps, le projet tombe une fois de plus à l’eau. Il conjurera cette impossibilité de parler de la Palestine dans Notre musique, où il laisse le poète palestinien Mahmoud Darwich dire à la caméra :
« Notre malheur et notre chance c’est d’avoir été en guerre avec les juifs. Notre malheur, parce que vous nous avez vaincus. Notre bonheur, parce que vous avez fait notre renommée [4]. »

À la recherche de la « bobine perdue » : le cœur de la discorde avec Claude Lanzmann
Godard a toujours été obsédé dans son travail d’archiviste de l’histoire du cinéma, de trouver la bobine de film qui montrerait les camps de concentration et les méthodes d’extermination des juifs :
« Il m’a semblé qu’avec le Cinéma soi-disant libéré, la première des choses à montrer aurait du être les camps. (…) Je suis convaincu que les Allemands ont tout filmé, c’étaient des maniaques, des fous du stockage. »
Celui qui se plait à dire que l’Ancien Testament est un « texte totalitaire » a toujours eu le souci de rendre compte du désastre de l’Histoire et de ses totalitarismes en cherchant à montrer, décrypter par l’image pour mieux comprendre.
Une évidente nécessité qui poussera le cinéaste à chercher encore et toujours la bobine qui montrerait l’horreur industrielle des camps de la mort :
« Je n’ai aucune preuve de ce que j’avance, mais je pense que si je m’y mettais avec un bon journaliste d’investigation, je trouverais les images des chambres à gaz au bout de vingt ans […]. Il ne s’agit pas de prononcer des interdictions comme le font Lanzmann ou Adorno, qui exagèrent parce qu’on se retrouve alors à discuter à l’infini sur des formules du style “c’est infilmable”, il ne faut pas empêcher les gens de filmer, il ne faut pas brûler les livres, sinon on ne peut plus les critiquer. Moi je dis qu’on est passé de "plus jamais ça" à "c’est toujours ça" et je montre une image de La Passagère de Munk et une image d’un film porno ouest-allemand où on voit un chien qui se bat avec un déporté, c’est tout : le cinéma permet de penser les choses. »
Claude Lanzmann, à l’inverse de la démarche de Godard, a publié le 3 mars 1994 un article dans Le Monde sous le titre « Holocauste, la représentation impossible » [5]. Le réalisateur y fit une célèbre déclaration, selon laquelle il détruirait tout éventuel enregistrement de la chambre à gaz en fonctionnement, ce qui eut pour conséquence une polémique entre les deux réalisateurs : l’un défendant la vérité par l’image, l’autre la vérité par le témoignage, le « ce qui ne peut pas être dit » de Wittgenstein devient aux yeux de Godard un « il vaut mieux voir que s’entendre dire » clamant que l’image c’est comme une preuve dans un procès. Les pourfendeurs habituels du négationnisme se sont montrés étrangement silencieux sur les propos de Claude Lanzmann, malgré leur violence et leur désir (grave) de destruction d’archive(s) de l’Histoire, accusant de manière inversée Jean-Luc Godard de faire en fait du négationnisme. Miroir, mon beau miroir…

Nouvelle vague contre vieux clapotis
Voulant illustrer ce célèbre adage qu’une image vaut mille mots, le cinéaste en a d’ailleurs rajouté une couche sur le conflit israélo-palestinien :
« L’autre jour, je regardais mon ami Sanbar, qui parlait sur LCI avec l’ambassadeur israélien. Ils discutaient de Gaza. Dans le coin de l’image, on voyait une photo de la carte de la bande de Gaza. L’Israélien disait qu’il faudrait quitter cette bande parce qu’il y a 1 million de Palestiniens et 7 000 Israéliens. La bande de Gaza était en rouge, avec une partie bleue pour les Israéliens. On aurait dû voir que les 7 000 personnes avaient 35 % de ce qu’avaient le 1 million. Alors regardons ça, et après, voyons ce qu’on sait dire. Mais le rapport à l’image n’a pas été fait. On a peur de l’image. On préfère un déluge de paroles. »
Pour montrer qui est spolié et qui est la vraie victime dans ces débats incessants autour de la question israélo-palestinienne, la carte de l’évolution de l’État d’Israël de 1967 à aujourd’hui serait nettement plus parlante que les mots qui accompagnent cet état de fait. Un proverbe arabe dit que le bon pédagogue transforme l’oreille en œil ; le problème actuel est que notre époque empêche de faire ce travail sous l’avalanche de commentaires médiatiques. Godard renchérit :
« La télé c’est comme un robinet : ça coule en continu, suffit de verser le poison dedans… »
Pour que les images nous parlent, l’historien de l’art Didi-Huberman oppose la tradition de Blanchot, Bataille et Giorgio Agamben et rappelle que toute image est à la fois voile et déchirure. Il faut travailler les images en tenant compte de leur phénoménologie, à savoir, les composer avec d’autres documents, les interpréter à partir de circuits dialectiques. C’est précisément ce que fait Godard dans ses Histoire(s) de cinéma. Le réalisateur s’obstine à monter sans crainte les archives, non pas par assimilation indistincte ni par la fusion ou destruction de leurs éléments, mais en imaginant les images dans une relation dialectique avec des éléments divers tout en cherchant à créer du sens. Il s’efforce de montrer à partir de ces images la différence et la relation qu’elles établissent avec tout ce qui les entoure dans une occasion donnée.
Co-existent donc sur ce sujet différentes stratégies pour comprendre et représenter par le biais des images. Chacune comporte une décision éthique, politique et idéologique qu’implique à son tour une lecture déterminée du passé, du présent et des futurs possibles. On peut simplifier ces lectures en deux options :
![]() la première, celle de Lanzmann, réduit l’intérêt de l’image au sentiment propre et endogène qu’elle peut provoquer, et oublie l’insertion de celle-ci dans une réalité plus large tout en évitant de penser l’image comme terrain politique, de la lire dans son histoire ;
la première, celle de Lanzmann, réduit l’intérêt de l’image au sentiment propre et endogène qu’elle peut provoquer, et oublie l’insertion de celle-ci dans une réalité plus large tout en évitant de penser l’image comme terrain politique, de la lire dans son histoire ;
![]() la seconde, celle de Didi-Huberman et de Godard, propose un regard contextuel, actif et même inquisitif ; une lecture phénoménologique faisant appel au montage pour faire sortir les différences et mettre en évidence ce qui ne pourrait pas être perçu dans les images brutes originales tout en assimilant le montage et la pensée : il est ce qui nous permet de voir.
la seconde, celle de Didi-Huberman et de Godard, propose un regard contextuel, actif et même inquisitif ; une lecture phénoménologique faisant appel au montage pour faire sortir les différences et mettre en évidence ce qui ne pourrait pas être perçu dans les images brutes originales tout en assimilant le montage et la pensée : il est ce qui nous permet de voir.
Godard nous parle de la présence de l’Holocauste dans toutes les images de l’Histoire et argumente qu’il faudrait relire le passé, conditionné par ce principe. C’est ainsi que le cinéma reprendrait la responsabilité qui lui correspond et que les images seraient enfin imaginables en donnant lieu à la possibilité de penser tout génocide. Toutefois, afin de dépasser les tragédies du passé, le cinéaste a une formule bien à lui :
« Il n’y a pas que le devoir de mémoire dans la vie, il y a aussi le droit à l’oubli. »













 et
et  !
!